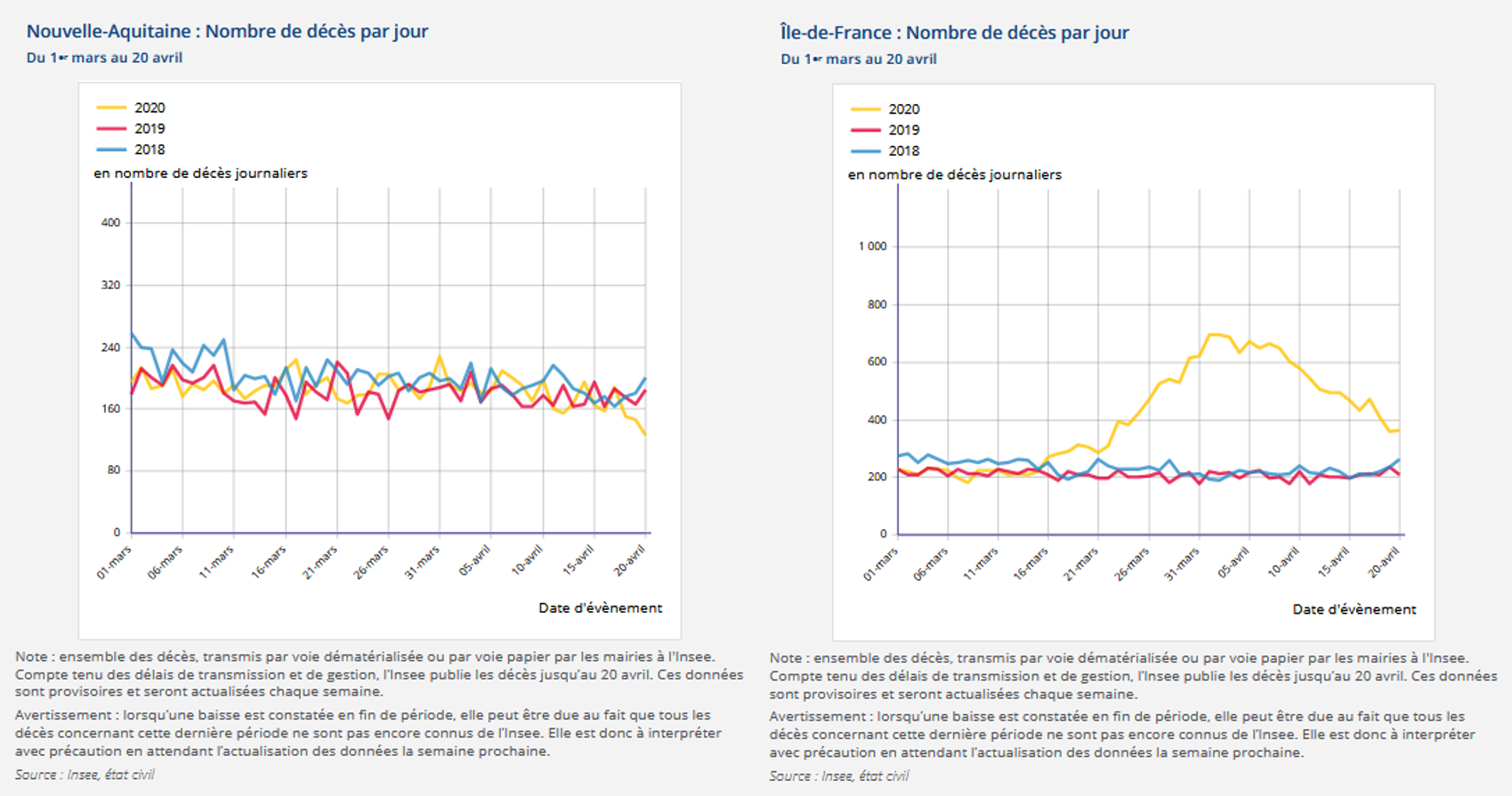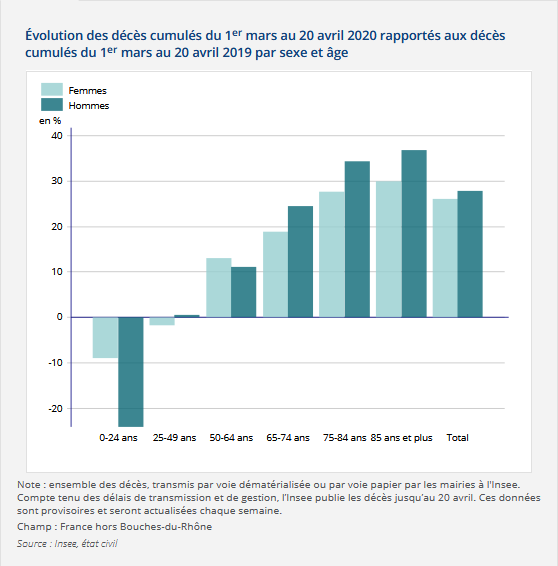L’Insee a proposé il y a quelques mois un nouveau zonage du territoire français en “aires d’attraction des villes”, qu’il vient de remobiliser pour distinguer différents types de territoires ruraux (le rural sous l’attraction d’une ville et le rural hors attraction d’une ville en quelque sorte, j’y reviens plus loin). Or, cela pose un problème particulièrement important : les aires d’attraction des villes, en effet, ne sont pas des aires d’attraction des villes.
Je précise le problème : l’Insee s’est appuyé sur un indicateur et des procédures de calcul pour définir un nouveau zonage du territoire, suite à quoi il a décidé de donner un nom à ce zonage. Or, il y a un écart abyssal entre ce qui est mesuré et le nom attribué.
Ceci est tout sauf neutre : une fois le zonage défini, ce que vont retenir la plupart des personnes, c’est le nom retenu, pas l’indicateur sous-jacent, ni la procédure de calcul. Si je vous dis par exemple que la commune où vous résidez est dans l’aire d’attraction de telle ville, vous allez imaginez des choses, cela va contribuer à forger vos représentations des territoires et des relations qu’ils entretiennent entre eux. Tiens, prenez quelques instants avant de poursuivre la lecture de ce billet : qu’est-ce que vous imagineriez de ce qu’il pourrait y avoir comme relations entre votre commune de résidence (où celle d’une de vos connaissances si vous résidez dans une “grande” ville) et la “grande” ville d’à côté, si je vous dis que votre commune de résidence (où celle de votre connaissance) est dans l’aire d’attraction de cette ville ? Jouez le jeu vraiment… ça y est ? Bien, poursuivons.
En fait, si l’on commence à lire la définition des aires d’attraction des villes, on se rend compte que l’objectif initial de l’Insee est ambitieux et vise en effet à identifier ce que l’on pourrait bien appeler des “aires d’attraction des villes” :
L’aire d’attraction d’une ville est un ensemble de communes (…) qui définit l’étendue de l’influence d’un pôle de population et d’emploi sur les communes environnantes
Sauf que cela n’est pas simple à mesurer, car l’influence peut être multidimensionnelle : si vous avez vraiment joué le jeu, vous vous êtes peut-être dit que si votre commune est dite dans l’aire d’attraction de la ville d’à côté, c’est sans doute parce que beaucoup de personnes de votre commune vont y faire leur courses, ou vont y travailler, ou bien c’est là qu’ils se rendent pour aller au cinéma, ou pour pratiquer telle ou telle activité sportive, ou s’impliquer dans telle ou telle association,ou pour se soigner, ce genre de choses.
En fait non, trop compliqué à mesurer et on n’a pas toutes les données. Donc l’Insee s’est appuyé sur un seul indicateur : les mobilités domicile-travail. Une commune va être considérée comme appartenant à l’aire d’attraction d’une ville si 15% au moins des habitants de cette commune en emploi travaillent dans cette ville. C’est très bien précisé dans la définition de l’Insee, bien sûr, mais je ne pense pas que les journalistes ou les politiques qui vont mobiliser les études parlant d’aire d’attraction de telle ou telle ville vont prendre le temps de revenir à la définition :
L’aire d’attraction d’une ville (…) définit l’étendue de l’influence d’un pôle de population et d’emploi sur les communes environnantes, cette influence étant mesurée par l’intensité des déplacements domicile-travail (souligné par moi)
Premier problème, donc, la méthode retenue par l’Insee ne permet au mieux de ne mesurer qu’une seule chose : l’attraction éventuelle exercée par une ville sur des communes environnantes vis-à-vis de l’emploi. Oubliez donc l’idée que cela mesure l’influence de la ville sur les lieux où les gens vont faire leurs courses, vont au cinéma, pratiquent leurs loisirs, vont se soigner, … , ce n’est pas le cas.
Mais ce n’est pas le seul problème. Ce dont dispose l’Insee, ce sont de données sur les individus en emploi, la commune où il résident et la commune où ils travaillent. Comme expliqué plus haut, dès lors que 15% des individus de telle commune travaillent dans telle ville, on va rattacher la commune à la ville. Mais on ne sait absolument rien de la trajectoire de ces individus, des raisons qui font qu’ils habitent à tel endroit et qu’ils travaillent à tel autre. Pourtant, le terme retenu par l’Insee, celui “d’attraction”, n’est pas neutre : il sous-entend que les individus qui résident dans telle commune ont été attirés par la commune où ils travaillent, pour l’emploi. Or, on n’en sait rien, derrière un fait, “monsieur ou madame X réside à tel endroit et travaille à tel autre”, peut se cacher tout un ensemble d’histoires différentes.
Prenons l’exemple d’un jeune couple en fin d’études universitaires, qui réside sur Bordeaux (ou sur Toulouse, ou sur Poitiers, …, pensez à la ville que vous souhaitez). A la fin de leurs études, ils trouvent du travail dans leur commune de résidence. Quelques années plus tard, ils ont un enfant, leur logement est trop petit, ils veulent en changer pour un logement plus grand. Problème, les prix sont trop élevés sur Bordeaux, ils décident donc de louer ou d’acheter un logement dans une commune à distance de Bordeaux mais continuent d’y travailler. Supposons qu’ils soient assez nombreux dans le même cas dans leur nouvelle commune de résidence (allez, disons au moins 15% des personnes en emploi). Cette commune sera alors dite dans l’aire d’attraction de Bordeaux. Mais si on y réfléchit, et si cette petite histoire résume la tendance dominante, on ne devrait pas parler “d’aire d’attraction de la ville”, mais “d’aire de répulsion de la ville” (“d’aire de répulsion résidentielle de la ville” si on veut être plus précis) : la ville n’a pas attiré pour l’accès à l’emploi, elle a repoussé pour l’accès au logement, en raison de prix trop élevés. Pourquoi l’Insee n’a pas choisi de baptiser son zonage “aire de répulsion des villes” ? Cela aurait été tout aussi cohérent (donc tout aussi réducteur et tout aussi trompeur).
On peut prendre une autre petite histoire : en fait, le couple dont je viens de parler avait les moyens d’accéder à un logement sur Bordeaux, mais ils avaient envie de s’installer à la campagne, dans une commune dite rurale, pour des raisons qui leur sont propres (et qui peuvent elles-mêmes être très diverses). Ils ont donc décidé d’y louer ou d’y acheter un logement. Idem, supposons que ce type de processus domine : on ne devrait pas parler d’aire d’attraction de la ville, mais “d’aire d’attraction du rural”, plus précisément “d’aire d’attraction résidentielle du rural”.
Le terme “aire d’attraction des villes” englobe en fait tous ces phénomènes, sans que l’on sache l’importance respective de chacun. On peut sans grand risque de se tromper se dire que ces différents processus sont à l’œuvre (la ville attire, la ville repousse, la campagne attire, la campagne repousse, du point de vue de l’emploi, ou du point de vue du travail) et que leur importance relative est sans doute variable dans le temps et dans l’espace. Des études permettant de révéler et de quantifier la diversité des trajectoires à la fois géographiques, résidentielles et professionnelles des individus seraient dans cette perspective particulièrement intéressantes (si certains ont vu passer des choses, je suis preneur). En attendant, aucun des termes que j’ai proposé ne permet d’embrasser cette complexité du monde social, donc autant ne pas l’y réduire.
Quelle alternative ? L’Insee aurait dû retenir un terme plus neutre, pour ne pas biaiser les représentations des acteurs.A minima, il aurait mieux valu parler “d’aires d’influence des villes” que “d’aires d’attraction des villes”, pour signifier que l’influence peut être positive (ce que laisse penser le terme “attraction”) ou négative (“répulsion”). C’est d’ailleurs un peu ce que vient de faire l’Insee pour caractériser la diversité des mondes ruraux : l’institut a croisé la nouvelle définition du rural (qui pour le coup me semble satisfaisante, j’en parle ici) au zonage en aires d’attraction des villes, mais, curieusement, il ne parle pas de “rural sous l’attraction d’une ville”, mais de “rural sous l’influence d’un pôle”. Le terme d’attraction a disparu, remplacé par celui d’influence, et on ne parle pas de “la ville” mais “d’un pôle”, alors pourtant que c’est bien le zonage nommé “aires d’attraction des villes” qui a été utilisé. Ajouter immédiatement et systématiquement “sous l’influence d’un pôle d’emploi” aurait été encore un peu mieux. On aurait alors un zonage en “aires d’influence des pôles d’emploi” plutôt qu’en “aires d’attraction des villes”. Convenez que ce n’est déjà pas pareil quand on entend ces termes.
Ce n’est cependant pas suffisant, car cela reste urbano-centré (c’est forcément “la ville” ou “le pôle” qui influence). Si l’on veut être précis et nommer ce que mesure véritablement l’Insee, le zonage devrait s’appeler quelque chose comme “aires légèrement préférentielles domicile-travail”. Je dis “légèrement préférentielle”, car le seuil de 15% est relativement bas (en creux, en effet, cela signifie que jusqu’à 85% des personnes en emploi ne travaillent pas dans la ville d’à côté). Retenir le terme “domicile-travail” signale qu’on ne s’appuie que sur des données qui résument le lien à l’emploi, à travers des données sur les mobilités domicile-travail, pas sur d’autres liens, qui sont potentiellement nombreux, et qu’on ne sait pas si c’est le lieu d’emploi qui a été décisif, ou le lieu d’habitation. Enfin, je n’emploie pas le terme d’attraction, ni de répulsion, car on ne sait pas ce qui se cache derrière les choix de lieux de résidence et de travail des personnes concernées. S’agissant de la volonté de caractériser la diversité du monde rural, on ne devrait pas parler de “rural hors influence d’un pôle” ou de “rural sous l’influence d’un pôle”, mais de “rural situé au sein d’une aire (légèrement) préférentielle domicile-travail” et de rural situé en dehors de telles aires.
Peut-être peut-on trouver mieux comme termes, mais vous comprenez l’idée. Et j’insiste, ce n’est pas une question anecdotique : les mots ont du sens, ils influent sur les représentations des acteurs, notamment des politiques, qui vont, sur la base de leurs représentations, se forger une vision du monde et définir en conséquence des politiques publiques. Changer les mots, c’est changer les représentations et donc l’action concrète.