La publication ou la réédition de deux livres et d’un article en anglais sur la question du « désarmement moral » de l’entre-deux-guerres[1], ainsi que la teneur des comptes rendus publiés à leur propos[2], l’émission radiophonique sur France Culture[3] sur le pacifisme « à la française » ainsi qu’un article sur l’enseignement de l’histoire en France dans Histoire@Politique[4], montrent à quel point l’actualité façonne l’intérêt pour certains sujets. Les leçons de l’histoire du pacifisme sont-elles plus présentes et plus pressantes depuis quelques années, alors que des troupes françaises et britanniques participent à des combats à l’étranger? Les chefs des dictatures du Moyen Orient – Saddam Hussein, Mouammar Khadafi, Bashar al Assad – sont parfois assimilés à Hitler par les interventionnistes. Quant aux mouvements de protestation contre la guerre en Irak, en Afghanistan et les interventions de l’OTAN en Libye, ils cherchent un soutien moral, une caution intellectuelle à leur combat. Les historiens eux-mêmes sont-ils plus sensibles à ces questions ? Ou bien, seraient-ce les lecteurs et les éditeurs qui prêtent plus d’attention à la publication d’ouvrages sur l’histoire du pacifisme dans de telles circonstances? Ainsi, Deborah Buffton, dans son compte rendu de l’ouvrage de Mona Siegel, met en exergue « Les leçons d’aujourd’hui, la paix est patriotique » (The Lessons for Today : Peace is Patriotic)[5].
Durant la période de l’entre-deux-guerres, la démilitarisation des esprits qui accompagna la démilitarisation de la vie de la nation contribua à une redéfinition des concepts de patriotisme et de pacifisme en Angleterre et en France. L’apaisement, synonyme pour certains d’un manque de fermeté face à des tyrans, comme le pacifisme, une philosophie autant qu’une attitude, furent opposés au nationalisme et au patriotisme. La révision de la version belliciste de l’histoire et la présence de pacifistes engagés dans les rangs du corps primaire en France est le sujet de l’ouvrage de Mona Siegel, réédité en version brochée, par les Presses universitaires de Cambridge.
Au-delà de l’histoire des manuels[6], de celle des instituteurs et des institutrices courageux qui bravèrent leur autorité hiérarchique et la ligne « officielle » , l’ouvrage approfondit les travaux d’historiens de l’enseignement et de la profession d’enseignant, tels ceux de Jacques Ozouf, Antoine Prost, Paul Gerbod, André Bianconi et Jacques Girault[7]. Les travaux qui concernent ce volet, celui du pacifisme des instituteurs, débute véritablement en 1977 avec la publication d’un article au titre provocateur : « From Patriots to Pacifists: the French Primary School Teachers 1880-1940 », car l’article en lui-même traite essentiellement de la période d’avant 1914[8]. L’ouvrage de Mona Siegel a le mérite de constituer un récit des questions relatives au pacifisme enseignant entre 1914 et 1940, auquel un seul de ses prédécesseurs avait consacré un ouvrage[9]. Le point de départ de Mona Seigel se situe dans l’analyse faite par Marc Bloch de la débâcle de 1940[10] – bien que celui-ci examine l’instruction et la culture militaires plus que la société en général – et le procès que les historiens – essentiellement américains – qui écrivirent dans les années 1970[11] avaient plus ou moins explicitement fait de l’école, pour avoir sacrifié la fibre patriotique sur l’autel de l’internationalisme et pour avoir ainsi contribué à faire perdre son âme à la nation et l’entraînant dans le déshonneur. Mona Seigel énonce clairement au départ ses conclusions générales : les instituteurs ne sont pas au banc des accusés. Ils ont fortement contribué à développer la démocratie, la liberté et le patriotisme (p. 9-10). Six chapitres sont consacrés au patriotisme et au pacifisme à l’école pendant la Première Guerre mondiale[12], à la mémoire de la guerre à l’école, à l’internationalisme socialiste et au pacifisme féministe, aux manuels scolaires, à l’enseignement patriotique et à l’école face aux développements internationaux de 1933 à 1940. Ses travaux l’ont conduite dans les Archives départementales de la Somme, du Nord, de l’Yonne et de la Dordogne, départements où l’histoire de l’institution scolaire entre les deux guerres était restée en friche. Elle a consulté la presse pédagogique et syndicale, et sa bibliographie est fournie.
Le livre de Mona Seigel peut, cependant, sembler superficiel et anecdotique, par moments, comparé aux travaux qui ont été consacrés à des périodes plus restreintes ou à des approches qui approfondissent ce que les linguistes appellent la « situation d’énonciation » des instituteurs. Le contexte d’avant 1914 est éludé, alors que les instituteurs avaient déjà été accusés d’avoir contribué à une « crise du patriotisme », dès 1904-1905, au moment de la Séparation de l’Église et de l’État. La formation dans les Écoles Normales avant 1914 distilla un patriotisme humaniste dont Ferdinand Buisson fut le chantre, et dont laïcité, républicanisme et patriotisme pacifique furent les maîtres mots. Pour se convaincre de la nécessité d’examiner cette période en prélude, il suffit de se rappeler la motion votée au congrès de Lille de la Fédération des Amicales d’Instituteurs en 1905 : « Les instituteurs français sont passionnément attachés à la paix, ils ont pour devise: Guerre à la guerre: mais ils n’en seraient que plus résolus pour la défense de leur pays le jour où il serait l’objet d’une agression brutale[13] » . Ou encore, la motion adoptée à la Chambre des Députés en décembre 1912, pendant l’affaire du ‘sou du soldat’, « fermement convaincue d’ailleurs du patriotisme des instituteurs et résolue à défendre contre toute attaque notre enseignement primaire national, qui doit être dominé par le culte de la Patrie…[14] »
Les caractéristiques éminemment politiques de l’exercice du métier d’instituteur pendant la période paraissent peu présentes dans l’analyse que fait Mona Seigel. L’instituteur et, à un moindre degré, l’institutrice, fonctionnaires de l’État, étaient les porte-parole du gouvernement dans les villages et les quartiers auprès de la population qui n’avait que peu de contact avec d’autres représentants de l’autorité. Profondément laïques, souvent radicaux ou socialistes, défenseurs d’une certaine idée de l’égalité, dont ils étaient eux-mêmes la preuve vivante, ils étaient les défenseurs de la République sur le terrain, dans une France encore régie dans les communes par des notables, de gauche et de droite, où l’Église catholique restait puissante.
De même, est absente la distinction entre les pacifistes féministes et/ou socialistes, très minoritaires, et les patriotes qui pouvaient, comme Voltaire, être en désaccord avec le fond de l’argument mais défendre leur droit d’expression. D’où une confusion entre pacifistes – antimilitaristes, militants – et internationalistes wilsoniens. Louis Bouët d’un côté, leader syndicaliste de la très minoritaire Fédération de l’Enseignement – environ 3000 membres en 1913[15] – et, de l’autre, Emile Glay et André Delmas, secrétaires généraux de la Fédération des amicales, devenu Syndicat national des instituteurs – largement majoritaire avec 90.000 membres à la même date[16]. Or, qu’avaient-ils donc en commun?
Le manque de discernement entre les différentes tendances dans la presse professionnelle est également à regretter. Citer l’article de Marie-Louise Cavalier et de René Vivès, paru en 1933 dans L’Ecole libératrice, – organe officiel du Syndicat national – , au début de la conclusion (p. 221), article dans lequel ils expliquent vouloir « chasser les germes de la haine de l’esprit humain », sans avoir au préalable donné une idée du lectorat particulier à l’hebdomadaire, ni même avoir différencié cette publication du Manuel général et de L’Ecole et la Vie, cités ni l’un ni l’autre, alors qu’ils bénéficiaient d’une large diffusion, revient à attribuer à l’expression d’un pacifisme militant une audience bien plus grande que ce courant n’en réunissait réellement.
L’évolution de l’opinion au sein du corps enseignant revêt un aspect dynamique qui ne peut faire l’économie d’une interrogation de la place des instituteurs dans la société et dans l’échiquier politique de l’époque. Les quelques pages que Mona Siegel consacre à la féminisation du métier ne suffisent pas à combler cette lacune. Le « désarmement moral » de la France, que le Maréchal Pétain, chef du gouvernement de Vichy, et Marc Bloch, prisonnier de guerre en Allemagne, accusèrent différemment les instituteurs d’avoir pratiqué, ne peut pas être étudié sans l’apport des travaux sur les nombreux et divers mouvements d’anciens combattants, sur les courants pédagogiques et leur évolution (également absents de ces pages) ainsi que sur le pacifisme ambiant entretenu par les politiques eux-mêmes. Pour contextualiser les travaux de Mona Siegel, l’étudiant du pacifisme et du monde enseignant de l’entre-deux-guerres se référera utilement aux ouvrages d’Olivier Lourbes[17], d’Yves Santamaria[18] et de Norman Ingram[19].
De ce fait, le glissement du soutien du corps enseignant au patriotisme pendant la première guerre, aux wilsonisme de l’immédiate après-guerre, puis progressivement à l’antibellicisme, à l’antimilitarisme de la fin des années 1920, et au pacifisme engagé des années 1930, n’est pas expliqué, malgré le titre de l’ouvrage et le souhait de vouloir contribuer à la redéfinition des concepts, redéfinition attribuée aux enseignants. Selon l’auteur, le fait le plus remarquable qui ressort de l’étude de l’enseignement primaire à la fin des années 1920 et pendant les années 1930 est que la guerre semble ne pas être présente et ne refait surface que très occasionnellement (p. 153). De même, soupçonnés d’avoir (mal) influencé des milliers de futurs appelés, les instituteurs sont décrits comme détachés et distants de ces préoccupations. Mona Seigel disculpe donc les enseignants des charges qui avaient été portées contre eux. Le titre de l’ouvrage laisse planer plus qu’un doute. Sans doute la publication du livre en 2004, en pleine période de réflexion sur l’intervention des armées américaines et de leurs alliés en Irak et sur le refus de la France, à l’ONU, le 14 février 2003, d’accepter la guerre, a-t-elle influencé ce choix ? Le soupçon de lâcheté dont la France est accusée est difficile à laver et le lien entre politique et histoire est toujours par trop visible.
[1] Daniel Hucker, Public Opinion and the End of Appeasement in Britain and France, Ashgate, 2011, 304 pages ; Mona L. Siegel, The Moral Disarmament of France. Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, (édition broché 2011) 317 pages ; Robert Boyce, « The Persistence of Anglo-Saxonism in Britain and the origins of Britain’s appeasement policy towards Germany », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 15, septembre-décembre 2011.
[2] Sandi E. Cooper ; The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940 by Mona L. Siegel, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2004, Peace & Change, 31, 2, 253-276; John S. Hill, « The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940 », (Book review), Canadian Journal of History, Spring-Summer 2007; Antoine Prost, « Compte rendu de Mona L. Siegel, The Moral Disarmament of France. Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940, 2004 », Le Mouvement Social, http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1120, consulté le 20 décembre 2011 ; ou encore John Hellman, « The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940 », (Book review), The Historian, March 2007.
[3] France Culture, « La fabrique de l’Histoire : Sur les chemins du pacifisme à la française », 1/4, 28.05.2007.
[5] Deborah D. Buffton, Review of Siegel, Mona L., The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism, and Patriotism, 1914-1940, , H-Women, H-Net Reviews, September, 2005, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=10882, consulté le 20 décembre 2011.
[6] Christian Amalvi, « La guerre des manuels autour de l’école primaire en France 1899-1914 », Revue historique, 1979, oct-déc., 532, 359-398.
[7] Jacques Ozouf, Nous les maîtres d’école, Julliard, 1967 ; Jacques Ozouf, Mona Ozouf, La République des Instituteurs, EHESS, 1992; Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France 1800-1967, Colin, 1968 ; André Bianconi, L’Idéologie du Syndicat national des instituteurs de 1920 à 1939, IEP Toulouse, 1984 ; Paul Gerbod, Les enseignants et la politique, PUF, 1976 ; Jacques Girault, Instituteurs, professeurs: Une culture syndicale dans la société frandçaise (fin XIXe-XXe siècle), Presses de la Sorbonne, 1996.
[8] Journal of Contemporary History, 12 (1977), 413-434.
[9] Olivier Lourbes, L’école et la patrie. Histoire d’un désenchantement 1914-1940, Paris, Belin, 2001.
[10] Marc Bloch, L’étrange défaite, Société des Éditions Franc-Tireur, Paris, 1946.
[11] Stanley Hoffman, « Le désastre de 1940 », L’Histoire, 10, mars 1979, réédité dans L’Histoire, Études sur la France de 1939 à nos jours, Seuil, 1985 ; Eugen Weber, The Hollow Years : France in the 1930s, Norton, 1994 ; Barnett Singer, « From Patriots to Pacifists: The French Primary School Teachers, 1880-1940 », Journal of Contemporary History, 12, 1977, 413-434.
[12] Voir à ce titre, Susan Trouvé-Finding, « French State Primary Teachers during the First World War and the 1920s: Their Evolving Role in the Third Republic », Thèse de doctorat (Ph.D.), Université de Sussex, 1987, 464 pages ; Stéphane Audouin-Rouzeau, La guerre des enfants. 1914-1918. Essai d’histoire culturelle, Paris, Armand Colin, 1993.
[13] Cité dans François Bernard, Louis Bouët, Maurice Dommanget, Gilbert Serret, Le Syndicalisme dans l’Enseignement. Histoire de la Fédération de l’Enseignement des Origines à l’Unification de 1935, Grenoble, IEP, 1966 [1938], vol.1, p.18-19, p.23.
[14] Journal officiel, 13 décembre 1912.
[15] François Bernard, Louis Bouët, Maurice Dommanget, Gilbert Serret, Le Syndicalisme dans l’Enseignement. Histoire de la Fédération de l’Enseignement des Origines à l’Unification de 1935, Grenoble, IEP, 1966 [1938], vol.1, p.189.
[16] Annuaire de la Fédération des Amicales, Bulletin général de la Fédération des Amicales, 3, mars 1913.
[18] Yves Santamaria, Le pacifisme, une passion française, Paris, Colin, 2005, 352 pages.
[19] Norman Ingram, The Politics of Dissent, Pacifism in France 1919-1939, Oxford, Clarendon, 1991.
 Régis Franc, London prisoner, Fayard Récit, 2012.
Régis Franc, London prisoner, Fayard Récit, 2012.

 Publication d’un dossier sur L’Ecosse, l’Irlande, et le pays de Galles : vers un royaume « dés-uni » « ? avec des articles de collègues des universités de Bordeaux, Valenciennes, et l’ENA-IRIS, membres du CRECIB (voir liens) dans
Publication d’un dossier sur L’Ecosse, l’Irlande, et le pays de Galles : vers un royaume « dés-uni » « ? avec des articles de collègues des universités de Bordeaux, Valenciennes, et l’ENA-IRIS, membres du CRECIB (voir liens) dans Pour aller plus loin:
Pour aller plus loin:
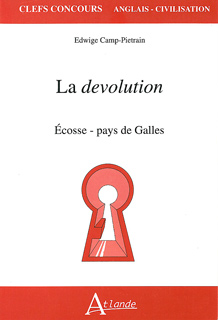
 Those who watched the Closing Ceremony of the London Olympics 2012 will have seen the Union Jack produced by Damien Hirst that was installed in the centre of the stadium. The crosses were used as ramps to the centre stage.
Those who watched the Closing Ceremony of the London Olympics 2012 will have seen the Union Jack produced by Damien Hirst that was installed in the centre of the stadium. The crosses were used as ramps to the centre stage.

 a publié une version remanié de l’article
a publié une version remanié de l’article 





 tlas géopolitique du Royaume-Uni (BAILONI M. et PAPIN D., 2009, Editions Autrement, Paris), Delphine Papin, Marc Bailoni, spécialiste de géopolitique à Nancy-Metz, Manuel Appert, géographe et urbaniste, Lyon, et Eugénie Dumas, cartographe, ont réussi un tour de force en publiant un nouvel ouvrage dans la collection Atlas aux éditions Autrement consacré à Londres, la « ville globale » (selon l’expression consacrée de
tlas géopolitique du Royaume-Uni (BAILONI M. et PAPIN D., 2009, Editions Autrement, Paris), Delphine Papin, Marc Bailoni, spécialiste de géopolitique à Nancy-Metz, Manuel Appert, géographe et urbaniste, Lyon, et Eugénie Dumas, cartographe, ont réussi un tour de force en publiant un nouvel ouvrage dans la collection Atlas aux éditions Autrement consacré à Londres, la « ville globale » (selon l’expression consacrée de