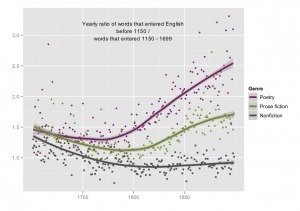2e JOURNEE D ETUDE “Patrimoine : Fonds Dubois” du 22 novembre 2012
Compte-rendu posté sur le site dédié créé pour servir de lien au chercheurs du projet : http://dubois.hypotheses.org/
 Cette deuxième journée d’étude consacrée à la valorisation du Fonds Dubois poursuit les travaux initiés lors de la première Journée d’études en date du 27 mars 2012 (voir le compte-rendu publié sur ce site dédié). Organisé par les laboratoires MIMMOC (EA 3812) de l’Université Poitiers et CRIHAM (EA 4….) bi-site Poitiers-Limoges, à la MSHS de Poitiers et la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, la journée a de nouveau réuni des universitaires anglicistes (11e section), des historiens (22e section), des spécialistes du Service commun de documentation et de la numérisation de l’Université de Poitiers, et des collègues des Universités de Paris 8, Paris-Diderot, Metz et Manchester (Royaume-Uni) spécialistes de l’histoire des échanges commerciales et intellectuelles du Royaume-Uni, de l’Europe et des Etats-Unis des 17e et 18e siècles.
Cette deuxième journée d’étude consacrée à la valorisation du Fonds Dubois poursuit les travaux initiés lors de la première Journée d’études en date du 27 mars 2012 (voir le compte-rendu publié sur ce site dédié). Organisé par les laboratoires MIMMOC (EA 3812) de l’Université Poitiers et CRIHAM (EA 4….) bi-site Poitiers-Limoges, à la MSHS de Poitiers et la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, la journée a de nouveau réuni des universitaires anglicistes (11e section), des historiens (22e section), des spécialistes du Service commun de documentation et de la numérisation de l’Université de Poitiers, et des collègues des Universités de Paris 8, Paris-Diderot, Metz et Manchester (Royaume-Uni) spécialistes de l’histoire des échanges commerciales et intellectuelles du Royaume-Uni, de l’Europe et des Etats-Unis des 17e et 18e siècles.
Participants : Nathalie Brémand, Responsable de la Bibliothèque Sciences Humaines et Arts, SCD, Directrice de rédaction de la BVPS, Université de Poitiers. Laurent Colantonio, MCF Histoire contemporaine, Université de Poitiers, CRIHAM (EA 4270). Susan Finding, Professeur de civilisation britannique, Directrice du MIMMOC (EA 3812), Directrice de la FE2C (FED 2447). Robert Mankin, PR, Université de Paris-Diderot, Directeur LARCA (LAboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones) (EA 4214). Philippe Minard, PR, Directeur d’études EHESS, Université de Paris 8, Co-directeur du laboratoire IDHE, UMR 8533- CNRS (excusé). Eric Planchon, Ingénieur de recherche, responsable Plateforme Ressources numériques, M.S.H.S. de Poitiers. Allan Potofsky, PR, Président REDEHJA, Institut Charles V, Université de Paris-Diderot. Siobhan Talbott, Hallsworth Research Fellow in Political Economy, University of Manchester. Anne-Sophie Traineau-Durozoy, Conservateur, Responsable du Fonds ancien, SCD, Université de Poitiers. Des étudiants du Master 1 Recherche Culture et société étrangères assistèrent à la journée.
Plusieurs volets de ce projet furent évoqués pendant la journée. En premier lieu, les pistes scientifiques. Susan Finding présenta “Auguste Dubois : sources pour une biographie intellectuelle – la république des professeurs?“, un répertoire des sources trouvées pour faire un travail sur le personnage d’Auguste Dubois, son oeuvre, son travail et sa vie de professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Poitiers au début du 20e siècle. Ces sources sont à la fois bibliographiques (IdRef SUDOC), historiques (Institut international d’histoire sociale, Amsterdam – Fonds Marcel Rivière, Fonds Kashnoor, Archives départementales – Faculté de Droit, et même le Fonds Dubois lui-même qui contient des pamphlets publiés par cette faculté), mais aussi ‘monumentale’

Maison d’Auguste Dubois, Poitiers
(la maison d’Auguste Dubois et sa tombe à Poitiers). Une biographie d’Auguste Dubois (Professeur de l’histoire des doctrines économiques à la Faculté de Droit de Poitiers au tout début du 20e siècle) et un travail sur la composition de sa collection (acquisition personnelle -parfois à l’étranger- d’ouvrages rares) éclaireront l’histoire intellectuelle, l’histoire des livres, l’histoire de l’université, mais aussi, l’enseignement de l’histoire économique en France.
Pour finir, Susan Finding a rappelé l’analyse faite par Steven Pincus, Bradford Durfee Professor of History, à l’Université de Yale, lors de sa présentation en mars dernier concernant la spécificité du Fonds en la comparant à la collection Goldsmiths-Kress qui l’a amené à conclure : “The Fonds DuBois is a phenomenally wide-ranging collection of political economic pamphlets for the eighteenth century. (…)The Fonds Dubois collection provides us with a remarkably strong selection of the output of the major political economic writers of the eighteenth century.”
Dr. Siobhan Talbott, Hallsworth Research Fellow in Political Economy, University of Manchester, chercheuse invitée financée par le laboratoire MIMMOC et la Région Poitou-Charentes au 2e semestre 2012-2013, présenta ensuite les objectifs de son projet de recherche et l’intérêt du Fonds Dubois pour ses recherches et pour la communauté scientifique en général.
Ses recherches sur le commerce extérieur britannique ont souligné des aspects des positions relatives nationale et internationale des nations britanniques qui sont en contradiction avec la dynamique que les chercheurs ont cru existaient normalement. L’union des royaumes en 1603, et celle des parlements anglais et écossais en 1707, sont considérées comme un indicateur de la supériorité économique et politique naturelle de l’Angleterre, alors que ‘une politique étrangère indépendante a disparu de l’autre côté de la frontière sous Jacques 1er après l’union des couronnes.’ Les historiens de la Grande Bretagne et de l’Europe moderne continuent à travailler avec cette idée, mettant en avant la prééminence de l’Angleterre sans vérifier les hypothèses sur lesquelles cette vision est basée. De plus, de telles investigations ont tendance à décrire l’histoire ‘anglaise’ plutôt que l’histoire britannique que J. G. A. Pocock, entre autres, encourage. Son travail cependant a suggéré que l’Écosse et l’Irlande ont maintenu des politiques économiques étrangères indépendantes et ont participé de façon autonome dans des conflits internationaux tels que la guerre de la Ligue d’Augsbourg (guerre de Neuf Ans) et la guerre de la Succession d’Espagne, ce qui soulève des interrogations concernant le positionnement relatif de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande sur la scène internationale.
sont considérées comme un indicateur de la supériorité économique et politique naturelle de l’Angleterre, alors que ‘une politique étrangère indépendante a disparu de l’autre côté de la frontière sous Jacques 1er après l’union des couronnes.’ Les historiens de la Grande Bretagne et de l’Europe moderne continuent à travailler avec cette idée, mettant en avant la prééminence de l’Angleterre sans vérifier les hypothèses sur lesquelles cette vision est basée. De plus, de telles investigations ont tendance à décrire l’histoire ‘anglaise’ plutôt que l’histoire britannique que J. G. A. Pocock, entre autres, encourage. Son travail cependant a suggéré que l’Écosse et l’Irlande ont maintenu des politiques économiques étrangères indépendantes et ont participé de façon autonome dans des conflits internationaux tels que la guerre de la Ligue d’Augsbourg (guerre de Neuf Ans) et la guerre de la Succession d’Espagne, ce qui soulève des interrogations concernant le positionnement relatif de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande sur la scène internationale.
Ce projet est conçu pour répondre à ces questions et comporte une analyse détaillée des alignements et associations internationales que les trois nations britanniques entretenaient, ainsi qu’un examen de la place relative de chacune dans l’économie et le pouvoir commercial des nations britanniques à l’étranger – en particulier avec la France, mais aussi avec l’Europe et le monde transatlantique – à l’époque moderne. Ce projet est soutenu par le financement de d’un contrat de recherche de trois ans, la Hallsworth Research Fellowship in Political Economy (University of Manchester, 2012-2015), pendant lesquels elle mènera des travaux au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.
Pendant les trois mois de chercheuse invitée à Poitiers, elle a l’intention d’utiliser le Fonds Dubois, dont le contenu est une mine pour ce projet de recherche. Quelques exemples sont les documents 374/1-14 sur le commerce étranger britannique, en particulier avec la France, à la fin de la guerre de Succession d’Espagne: les documents 435/1-2 and 1761/1-3 sur le commerce maritime des années 1750; documents 1705/2, 1708/1, and 1827-8, sur l’émergence d’une aristocratie dans les affaires en France, et des documents de la chambre de commerce et d’industrie, Rouen (1859/1-2). Les édits royaux, les actes du conseil d’état, en particulier ceux qui gèrent le commerce au début du dix-huitième siècle (collection 3253) sont d’un intérêt certain, ainsi que les oeuvres de Samuel Gale (1981/1-4), Daniel Defoe (2053/1-4),  Christopher Robinson (2397/1-4) et William Knox (2489/1-2), dont certains n’existent que dans ce fonds. Cette liste est loin d’être exhaustive et ne constitue que des exemples des ressources dont l’Université de Poitiers est le dépositaire et qu’elle utilisera pendant son séjour au printemps 2013.
Christopher Robinson (2397/1-4) et William Knox (2489/1-2), dont certains n’existent que dans ce fonds. Cette liste est loin d’être exhaustive et ne constitue que des exemples des ressources dont l’Université de Poitiers est le dépositaire et qu’elle utilisera pendant son séjour au printemps 2013.
Le travail qu’elle mènera contribuera à des publications dans des revues internationales de renom. Une étude pilote a déjà été publié dans Historical Research (2012) et été lauréat du Prix Pollard 2011 attribué par la Institute of Historical Research (Université de Londres) et l’éditeur universitaire Wiley-Blackwell.L’éditeur Pickering et Chatto publiera une étude intitulé Conflict, Commerce and Franco-Scottish Relations, 1560-1713. Ce séjour permettra également d’augmenter considérablement le travail déjà entrepris pour la création de la base de données qu’elle a initié : British Commercial Agents: a biographical database, 1560-1720, (Les agents commerciaux britanniques: base de données biographique, 1560-1720), qui sera publié en ligne pour l’utilisation par les chercheurs et le grand public. Elle contribuera enfin pendant ce séjour de trois mois à l’identification des priorités pour la numérisation du Fonds Dubois, et en collaboration avec les universitaires engagés dans ce projet, et aidera au développement d’un réseau international de chercheurs dans ce domaine autour de ce fonds.
En fin de matinée, au 2e étage de la Bibliothèque Droit-Lettres, la présentation du Fonds Dubois et d’un certain nombre d’ouvrages de la section concernant les ouvrages en anglais ou publiés au Royaume-Uni, par Mme Traineau-Durozoy, Conservateur, responsable du Fonds ancien du Service commun de documentation (SCD) de l’Université de Poitiers, fut l’occasion de comprendre la richesse de ce Fonds. Mme Traineau-Durozoy présenta également l’histoire du catalogage du Fonds. Ce sont les conservateurs et bibliothécaires qui en dressant les inventaires ont les premiers souligné les richesses du Fonds.
Mais la partie la plus riche de cet ensemble date des 18e et 19e siècles, avec un éclairage sensiblement différent, le 18e beaucoup plus économique et politique (commerce des blés, assignats, Compagnie des Indes, physiocratie…), le 19e davantage centré sur les courants socialistes et utopiques (saint-simoniens, fouriéristes, l’Icarie de Cabet, Proudhon, aussi bien que Robert Owen…).
Des ensembles particuliers méritent d’être signalés :
‑ les romans utopiques et voyages imaginaires (la collection complète des Voyages imaginaire, songe, visions et romans cabalistiques publiée par Charles Georges Thomas Garnier, mais aussi trois Thomas More, les Sévarambes de Veiras, les Galligènes de Tiphaigne de la Roche, Jacques Sadeur de Foigny, les Isles fortunées de Moutonnet de Clairfons, le Prince de Montberaud de Lesconvel, le Jacques Massé de Tyssot de Patot…).
‑ la collection de pamphlets en langue anglaise, soit environ 400 pièces sur l’Irlande, la politique, la banque, le commerce international, la South Sea Company, signés par (ou attribués à) William Petty, Davenant, Swift, Drapier, De Foe…
Jean-Paul Bonnet, Le catalogue des brochures du Fonds Dubois de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, 2000.
Les différents outils disponibles pour consulter le Fonds sont les suivants:
-Catalogue en ligne Université de Poitiers – SCD – Fonds ancien
-Inventaire et index (auteur, thèmes) des 3089 brochures (J-P. Bonnet, 2000).
-Catalogue, (Nathalie Rollet, mars 2001).
-Liste des périodiques et brochures : les socialismes utopiques.
-Ouvrages en langue anglaise traduits de l’anglais ou publiés en Grande-Bretagne 16e-19e siècles (avril 2008).
-Tableaux Excel chronologiques :
-Fonds Dubois – anglais
-Fonds Dubois – français.
Pour finir Mme. Traineau-Durozoy a présenté la liste des Acquisitions faites par le SCD avec les crédits Région Poitou-Charentes / MIMMOC sur les domaines “Economie, politique et société aux 17e et 18e s. dans les îles britanniques” pour servir d’usuels aux chercheurs venant travailler sur le Fonds.
En début d’après-midi, une visite à la plateforme des ressources numérique de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société permit aux chercheurs de se rendre compte des importants moyens techniques à disposition, notamment la dernière acquisition permettant de numériser en A0, en cours d’installation, présentée par Eric Planchon, Ingénieur d’études, responsable de ce service.
Mme Nathalie Bremand présenta la Bibliothèque virtuelle Premiers socialismes (BVPS) par mis en ligne sur le site de la SCD de l’Université, ce qui donna l’occasion à la réunion de poser des questions sur la conception du site, sur les choix opérés et des conseils sur le site projeté dans le cadre de ce projet.
Une discussion s’ensuit sur les priorités et les méthodes de travail. L’importance du travail de valorisation sans équipe dédiée paraît redoutable. Il faut continuer de chercher à faire connaître le Fonds par nos propres réseaux. Les professeurs présents envisagent d’envoyer des étudiants de Master et des doctorants utiliser le Fonds pour leurs travaux. Le travail individuel de chercheurs comme Steven Pincus et Siobhan Talbott, ne fera qu’accroître l’utilisation et la renommée du Fonds, permettant ainsi au projet de numérisation et de création d’une bibliothèque virtuelle de recevoir des appuis, voire à des projets scientifiques (ANR, GDR – cf le GDR 2136 France – Îles britanniques) thématiques autour du Fonds d’émerger.
Lors de la première journée d’étude, des actions avaient été projetées. Certains n’ont pas encore pu être initiées. Un certain nombre ont été déjà été effectuées :
1) prise de contacts : -avec le PRI Iles britanniques de l’EHESS, le Projet pluridisciplinaire Paris Diderot “Littérature pratique et l’imagination des savoirs”;
-Digital Humanities Congress 2012, University of Sheffield, 6th – 8th September 2012 – Susan Finding a assisté au congrès et contacté un certain nombre de participants dont des responsables de http://www.connectedhistories.org, de l’Institute of Historical Research, Londres).
2) création du carnet de recherche du réseau : dorénavant en opération dubois.hypothèse.org. Les membres du réseau sont invité à partager des informations via ce carnet en s’adressant à Susan Finding (Université de Poitiers).
3) solliciter l’intégration dans l’axe Patrimoine et Territoires (Patrimoine du passé) du CPER 2007-2013 Axe B : “Savoir, Sociétés, Images” puisque le projet émergeant correspond aux projets déjà établis Constitutions et circulation des savoirs. Le CPER en fin de parcours n’a pu accéder à la demande. Mais nous espérons pouvoir faire partie du prochain.
4) Susan Finding a soumis le projet de valorisation du Fonds à la MSHS comme projet à intégrer à l’axe 3 de la MSHS de Poitiers”Culture et patrimoine” avec le titre Fonds Dubois, les mots-clés : savoirs, circulations, collections, patrimoine intellectuel, humanités numériques, où les objectifs sont ainsi décrits :
la valorisation du Fonds Dubois (et accessoirement du Fonds ancien) en trois volets, la préservation, la communication et l’exploitation scientifique de l’ensemble. Les moyens : 1) répertorier les ouvrages spécifiques, créer une banque d’informations sur les éditions détenues à Poitiers ; 2) création d’une bibliothèque virtuelle (à l’instar de la Bibliothèque virtuelle des premiers socialismes et de la Bibliothèque virtuelle sur les Coutumiers du Centre-Ouest (dans le droit fil de l’idée de création d’un Portail BNF régional piloté par le SCD et de portails internationaux spécialisés 17e-18e siècles) ; 3) soutien et animation de projets de recherche autour du Fonds.
Cet axe, en cours d’élaboration (pour lequel Susan Finding, à la demande des deux porteurs du projet, est responsable du sous-axe “Monde de savoirs”) sera également la base des négociations autour du prochain CPER de l’Université de Poitiers.
La prochaine JE aura lieu en juin 2013 et réunira les deux chercheurs invités internationaux Steven Pincus et Siobhan Talbott, ainsi que les enseignants-chercheurs membres du réseau. La date précise sera annoncée ultérieurement.
Le prochain appel pour des candidatures de chercheur invité financés (voyage et frais de séjour) pour des périodes allant de 1 à 2 mois, ou de 3 à 6 mois (full professor/ post-doc) sera bientôt émis. N’hésitez pas à encourager des candidatures. Informations sur la page Research grants du carnet de recherche dubois.hypotheses.org.
Poitiers, le 29 novembre 2012, SF.
 et Susan Finding, professeur à l’Université de Poitiers.
et Susan Finding, professeur à l’Université de Poitiers. Clément Martin (Université Paris Diderot, LARCA) « From despot to despotism: evolution and diffusion of the concept in early 18th century Great Britain »
Clément Martin (Université Paris Diderot, LARCA) « From despot to despotism: evolution and diffusion of the concept in early 18th century Great Britain »




 Cette deuxième journée d’étude consacrée à la valorisation du Fonds Dubois poursuit les travaux initiés lors de la première Journée d’études en date du 27 mars 2012 (voir le compte-rendu publié sur ce site dédié). Organisé par les laboratoires MIMMOC (EA 3812) de l’Université Poitiers et CRIHAM (EA 4….) bi-site Poitiers-Limoges, à la MSHS de Poitiers et la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, la journée a de nouveau réuni des universitaires anglicistes (11e section), des historiens (22e section), des spécialistes du Service commun de documentation et de la numérisation de l’Université de Poitiers, et des collègues des Universités de Paris 8, Paris-Diderot, Metz et Manchester (Royaume-Uni) spécialistes de l’histoire des échanges commerciales et intellectuelles du Royaume-Uni, de l’Europe et des Etats-Unis des 17e et 18e siècles.
Cette deuxième journée d’étude consacrée à la valorisation du Fonds Dubois poursuit les travaux initiés lors de la première Journée d’études en date du 27 mars 2012 (voir le compte-rendu publié sur ce site dédié). Organisé par les laboratoires MIMMOC (EA 3812) de l’Université Poitiers et CRIHAM (EA 4….) bi-site Poitiers-Limoges, à la MSHS de Poitiers et la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, la journée a de nouveau réuni des universitaires anglicistes (11e section), des historiens (22e section), des spécialistes du Service commun de documentation et de la numérisation de l’Université de Poitiers, et des collègues des Universités de Paris 8, Paris-Diderot, Metz et Manchester (Royaume-Uni) spécialistes de l’histoire des échanges commerciales et intellectuelles du Royaume-Uni, de l’Europe et des Etats-Unis des 17e et 18e siècles.
 sont considérées comme un indicateur de la supériorité économique et politique naturelle de l’Angleterre, alors que ‘une politique étrangère indépendante a disparu de l’autre côté de la frontière sous Jacques 1er après l’union des couronnes.’ Les historiens de la Grande Bretagne et de l’Europe moderne continuent à travailler avec cette idée, mettant en avant la prééminence de l’Angleterre sans vérifier les hypothèses sur lesquelles cette vision est basée. De plus, de telles investigations ont tendance à décrire l’histoire ‘anglaise’ plutôt que l’histoire britannique que J. G. A. Pocock, entre autres, encourage. Son travail cependant a suggéré que l’Écosse et l’Irlande ont maintenu des politiques économiques étrangères indépendantes et ont participé de façon autonome dans des conflits internationaux tels que la guerre de la Ligue d’Augsbourg (guerre de Neuf Ans) et la guerre de la Succession d’Espagne, ce qui soulève des interrogations concernant le positionnement relatif de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande sur la scène internationale.
sont considérées comme un indicateur de la supériorité économique et politique naturelle de l’Angleterre, alors que ‘une politique étrangère indépendante a disparu de l’autre côté de la frontière sous Jacques 1er après l’union des couronnes.’ Les historiens de la Grande Bretagne et de l’Europe moderne continuent à travailler avec cette idée, mettant en avant la prééminence de l’Angleterre sans vérifier les hypothèses sur lesquelles cette vision est basée. De plus, de telles investigations ont tendance à décrire l’histoire ‘anglaise’ plutôt que l’histoire britannique que J. G. A. Pocock, entre autres, encourage. Son travail cependant a suggéré que l’Écosse et l’Irlande ont maintenu des politiques économiques étrangères indépendantes et ont participé de façon autonome dans des conflits internationaux tels que la guerre de la Ligue d’Augsbourg (guerre de Neuf Ans) et la guerre de la Succession d’Espagne, ce qui soulève des interrogations concernant le positionnement relatif de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande sur la scène internationale. Christopher Robinson (2397/1-4) et William Knox (2489/1-2), dont certains n’existent que dans ce fonds. Cette liste est loin d’être exhaustive et ne constitue que des exemples des ressources dont l’Université de Poitiers est le dépositaire et qu’elle utilisera pendant son séjour au printemps 2013.
Christopher Robinson (2397/1-4) et William Knox (2489/1-2), dont certains n’existent que dans ce fonds. Cette liste est loin d’être exhaustive et ne constitue que des exemples des ressources dont l’Université de Poitiers est le dépositaire et qu’elle utilisera pendant son séjour au printemps 2013. Hors un article dans les pages économiques de La Croix cet été (‘
Hors un article dans les pages économiques de La Croix cet été (‘ Cahiers du MIMMOC, en ligne sur une plateforme gérée par l’Université de Poitiers et en accès libre depuis six ans, sur le portail
Cahiers du MIMMOC, en ligne sur une plateforme gérée par l’Université de Poitiers et en accès libre depuis six ans, sur le portail