Il y a un an, nous annoncions la sortie d’un numéro de l’Observatoire de la société britannique consacré à la question de l’Economie britannique et le Brexit.
La finalité de la décision acquise depuis quelques semaines, la mise en ligne du numéro de décembre 2019, et la sortie du numéro de décembre 2020 de la revue, dédié à nouveau à la question, BREXIT AND ITS DISCONTENTS/ LE BREXIT, UN MALAISE SANS FIN ? sous la direction de Margaret Gillespie, Philippe Laplace & Michel Savaric, nous incite à republier l’introduction du numéro rédigé il y a douze mois.
Brexit, souveraineté nationale et mondialisation, Susan Finding, Observatoire de la société britannique, 24 | 2019 : L’économie britannique et le Brexit, p. 15-28 https://doi.org/10.4000/osb.3146
Depuis l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne en janvier 1973, un certain nombre de britanniques n’ont cessé de penser que l’entrée dans la CEE a eu un impact négatif sur l’économie du pays. Le passage au système métrique, décidé dès 1965, n’a fait que renforcer l’idée que l’économie de la première nation industrielle, son système impérial de poids et de mesures, tous deux séculaires, sont menacés par cette participation. Dans l’esprit de nombreux britanniques la décimalisation de la monnaie, à partir de février 1971, a contribué à la vision négative de l’impact, notamment sur la flambée des prix1. La demande – il y a quarante ans – d’une renégociation de la contribution britannique au budget européen par le nouveau Premier ministre, Margaret Thatcher, et ses déclarations péremptoires concernant le déficit démocratique des institutions européennes, reflétaient et entretiennent encore ce sentiment. En 2016, la contribution budgétaire britannique à l’Union européenne a été utilisée comme l’un des principaux arguments de la campagne en faveur du Brexit, ses partisans prétendant que les 350 millions de livres sterling hebdomadaires versés à l’UE – chiffre contesté – seraient consacrés au système public de santé (NHS), institution emblématique du système social britannique. Si l’entrée du Royaume-Uni dans l’union douanière, puis dans l’union politique et sociale, a posé problème aux britanniques, sa sortie, près de cinquante ans plus tard, ne pose pas moins de questions, notamment à propos son impact sur l’économie.
- 2 Timothy Whitton (dir.), Le Royaume-Uni de Theresa May, Observatoire de la société britannique, 21, (…)
- 3 Les coordinateurs de ce numéro adressent leurs remerciements aux laboratoires MIMMOC (EA 3812) et C (…)
Après un numéro de l’Observatoire de la société britannique consacré aux défis auxquels Theresa May devait faire face en accédant à la tête de l’exécutif en juin 2016, et deux numéros de la Revue française de civilisation britanniques sur le référendum de juin 2016 et les élections législatives de 20172, élections dont le Premier ministre espérait qu’elles lui donneraient une plus grande majorité et les coudées franches – mais qui en réalité ont produit un parlement sans majorité, incapable de dégager un consensus sur la difficile négociation des conditions du départ –, le numéro présent se penche sur l’économie britannique avant et après le Brexit et sur certaines questions épineuses qui se sont posées depuis le 23 juin 20163. L’éventuel impact de la sortie de l’UE sur l’économie britannique a peu joué dans la décision les électeurs de voter en faveur du Brexit, si ce n’est la fameuse contribution du Royaume-Uni à l’Union européenne, largement utilisée par les partisans du départ. Le gouvernement ne semble pas davantage avoir mesuré les conséquences économiques en déclenchant l’Article 50. Il semble toutefois que les conséquences économiques de cette décision politique soient multiples et profondes.
- 4 Les auteurs des articles dans ce numéro se trouvent dans la même position – bien moins grave certes (…)
À l’aune d’une nouvelle ère de relations internationales pour la Grande-Bretagne, une ère de reconfigurations politiques, sociales et économiques, sont réunis dans ce numéro des articles qui analysent l’impact du « Brexit ». Depuis le résultat-surprise du référendum de juin 2016, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus du Royaume-Uni. Les articles ont été rédigés pendant l’hiver 2018-2019, et révisés entre le moment où le parlement britannique a rejeté l’accord négocié entre le gouvernement britannique et l’Union européenne, le 15 janvier 2019, et la fin du délai imposé par l’activation de l’Article 50 par le Premier ministre, initialement le 29 mars 2019 (‘B-Day’). Ce délai se prolonge, prorogé jusqu’au 12 avril à cause de l’impasse à Westminster, et de nouveau, début avril, jusqu’au 30 octobre 2019. Ne souhaitant pas attendre le dénouement de la crise politique, constitutionnelle et existentielle que le résultat du referendum a déclenchée4, — ces lignes ont été rédigées en mars 2019, avant les atermoiements du départ de Theresa May et le choix de son successeur à la tête du Parti conservateur, et par conséquent du gouvernement — le présent numéro fait le point sur les débats autour de certaines questions économiques soulevées par la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
- 5 https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/30/food-prices-to-finance-what-a-no-deal-brexit-could (…)
- 6 Mike Hawes, président de la Society of Motor Manufacturers and Traders, Colin Stanbridge, président (…)
Le Brexit, quel que soit son format, — même si l’accord négocié est finalement voté, et même si le processus est arrêté ou si un délai supplémentaire pour aboutir à une sortie est demandé, et accordé — ne manquera pas d’avoir des répercussions sur un certain nombre d’institutions, de politiques et de méthodes de fonctionnement européens. En attendant de savoir l’accord négocié, signé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, est avalisé par le parlement (Deal ou No Deal ?), ou si une deuxième consultation du peuple sous forme de référendum ou d’élections législatives s’avère nécessaire, les acteurs de tous les secteurs économiques ont conduit des analyses prospectives, évalué les ajustements nécessaires et élaboré des plans pour faire face aux difficultés constatées : indisponibilité de main d’œuvre immigrée, délais de livraison prolongés, formalités administratives accrues, tarifs douaniers entraînant des coûts supplémentaires, valeur de la livre sterling incertaine, subventions agricoles évaporées… Les stratégies envisagées vont du déménagement du siège social dans un pays européen (secteur bancaire) où ailleurs (Dyson à Singapour ; Honda ; BMW pour la Mini) à la négociation bilatérale avec les autorités du pays concerné (Eurostar), de la création de stocks supplémentaires (fournitures, médicaments) à la création de filières de transport et de stockage dédiées (NHS, ferrys trans Manche)5. Devant les incertitudes quant au dénouement de la crise et sur la durée des négociations et des tractations parlementaires, de nombreux représentants de l’industrie et du commerce sont intervenus publiquement pour avertir le gouvernement des conséquences négatives qui se faisaient déjà sentir6.
Les articles dans ce numéro se classent dans trois catégories principales : le Royaume-Uni dans son ensemble ; le devenir de l’économie des régions à gouvernance autonome (Écosse et Irlande du nord) ; et le secteur financier. Les contributions font ressortir des questions fondamentales sur les prémices et le fonctionnement de la société britannique : la philosophie politique qui la sous-tend, la place des services et le poids de la finance dans l’économie britannique, les relations internes au Royaume entre les régions, et les relations extérieures du pays, sur le plan politique et économique. L’impact sur les relations extérieures ne se limite pas aux relations avec l’UE, mais aussi, conséquence du poids du secteur de la finance, avec les États-Unis.
Le Brexit et le Royaume-Uni : questions de philosophie politique
Les trois premiers articles envisagent le Royaume-Uni dans son ensemble et traitent de questions relevant de la philosophie politique et sociale. Céline Lageot retrace le processus constitutionnel de sortie de l’UE du Royaume-Uni. Ce faisant elle rappelle l’importance constitutionnel du principe de souveraineté parlementaire :
Alors que le Gouvernement a cru pouvoir passer outre le consentement du Parlement pour la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne, les juges de la Cour suprême sont venus arbitrer le conflit dans l’affaire Miller en janvier 2017, en rappelant la plénitude du principe de souveraineté parlementaire. Non seulement, et nonobstant le résultat du référendum de juin 2016, le Parlement a dû donner son approbation au déclenchement de la procédure de sortie, mais il devra en définitive autoriser la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Ce principe a mené, tant bien que mal, aux votes indicatifs du 26 mars 2019 censés faire connaître ce que le parlement, souverain, après avoir rejeté à plusieurs reprises l’accord ramené de Bruxelles par le Premier ministre, Theresa May, accepterait comme solution. Cette consultation a révélé surtout les profonds désaccords au sein des deux principaux partis politiques, et, par conséquent, n’a pu dégager une majorité en faveur d’aucune des propositions alternatives.
Dans sa contribution, Emma Bell souligne les principes qui prévalent chez les tenants du Brexit et les conséquences qui en découlent :
Bien que le Brexit soit parfois considéré par la gauche comme une opportunité de tirer un trait sur le néolibéralisme, notamment en facilitant la renationalisation des services publics, la droite du parti conservateur britannique le voit comme une vraie occasion de montrer la voie en matière de déréglementation afin de créer une utopie néolibérale au Royaume-Uni. […] Cependant, bien que la création d’une utopie néolibérale après le Brexit soit irréalisable, « le néolibéralisme réellement existant » devrait perdurer, les incertitudes économiques du Brexit plaçant les grandes entreprises dans une position de force vis-à-vis du gouvernement britannique.
L’expansion du secteur des services dans les quarante années précédant la crise de 2007, quasiment depuis l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE, a été significative. Si on ne peut imputer ce développement à l’adhésion au marché commun, la transformation de l’économie britannique suite au déclin industriel, accompagne l’expansion des échanges commerciaux avec l’Europe. Aujourd’hui, les services dominent l’économie et la vie des britanniques – les chiffres de 2016 montrent que 80 % des emplois sont dans les services publics et privés et seulement 12 % dans l’industrie, 1.5 % l’agriculture7. La place des services privés, et en particulier des services financiers, sera examinée dans des articles de la troisième partie. Louise Dalingwater analyse un aspect de l’impact du Brexit sur un pan du secteur public, le service public de santé :
L’un des défis les plus importants du post-Brexit est celui de la capacité du système britannique de santé publique (National Health Service) à retenir du personnel de santé qualifié. Le NHS a recours à des travailleurs étrangers pour combler le déficit chronique en personnel. Cet article montre pourquoi le NHS connaît actuellement une crise de recrutement et souligne comment la sortie du Royaume-Uni de l’UE pourrait aggraver le problème. Il examine ensuite l’impact potentiel du Brexit sur la présence de personnel européen dans le NHS. L’article examine pourquoi une évaluation de l’effet du Brexit sur cette crise de recrutement est difficile à effectuer. Enfin, il analyse les politiques mises en place par le Gouvernement britannique pour tenter de limiter les départs du personnel et pour remédier à la crise de recrutement.
- 8 Peter Walker and Anushka Asthana, « Second Brexit analysis leak shows harm of tighter migration rul (…)
La politique d’immigration du gouvernement conservateur aurait un effet négatif important sur l’économie, d’après des rapports officiels qu’on a tenté de garder secrets8. Si les politiques d’immigration ne sont pas directement liées à la sortie de l’UE, la perception du public et du personnel du NHS provenant de l’UE font ce lien entre les deux. Mieux contrôler ses frontières et l’immigration, on se le rappellera, fut un des arguments brandis par la campagne en faveur du Brexit.
Le Brexit et les régions à gouvernance autonome : les cas de l’Écosse et de l’Irlande du nord
- 9 Ian Jack, « North to south, the seeds of division in Brexit Britain were sown long ago », The Guard (…)
- 10 Sur Londres, voir Berbéri, C., « Londres : une ville plus favorable à l’euro que les autres villes (…)
Le résultat du référendum a souligné les faiblesses des relations inégales entre les différentes parties – régions et nations – du Royaume-Uni. Le décalage entre les régions anglaises ayant voté en faveur de l’UE – méridionales, prospères, cosmopolites – et les régions anglaises ayant voté en faveur du Brexit – au nord, au taux de chômage et de pauvreté élevé – reprend la division centenaire entre le nord industriel et le sud, centre administratif9, entre les régions et nations ‘périphériques’ et le centre du pouvoir, le cœur du Royaume – l’Angleterre et Londres10. Le résultat souligne également les attentes très différentes des nations composant l’Union et fait écho à l’évolution des vingt dernières années vers une autonomie plus grande de l’Écosse, mais aussi, dans une certaine mesure, du pays de Galles, et de l’Irlande du nord.
- 11 Site officiel de l’exécutif gallois : What impact will Brexit have on the Welsh economy? 13 April 2 (…)
On s’attend à ce que l’économie galloise soit touchée par le Brexit : au niveau de son PNB, du commerce, de l’investissement et des emplois. Entre trois scénarios possibles évoqués en 2018, le plus couteux pour l’économie serait une économie sans accord avec l’UE entièrement livrée aux règlementations de l’Organisation mondiale du commerce. Le moins couteux serait le statut quo (pas de Brexit), avec un accord type CETA comme solution intermédiaire11. En accord avec ces estimations, le 4 décembre 2018, l’Assemblée galloise s’est positionnée en adoptant une motion qui rejetait l’accord obtenu par le Premier ministre britannique, et proposait que le Royaume-Uni reste au sein de l’Union douanière et du marché commun. Ce vote n’a de valeur que symbolique, mais indique, une fois de plus, l’écart entre le gouvernement britannique – Tory – et les gouvernements autonomes de ces nations, ici, l’exécutif gallois travailliste.
En Écosse, on est tout aussi préoccupé par les retombés économiques de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Selon Gilles Leydier :
Le débat autour des enjeux économiques résultant du Brexit s’est déroulé en Écosse dans un contexte politique particulier, en raison notamment du vote largement majoritaire exprimé par les Écossais en faveur du « Remain » ; mais aussi de la revendication exprimée par le gouvernement nationaliste d’un traitement spécifique du cas écossais dans le cadre des négociations engagées avec les institutions européennes ; et, enfin, de la question posée par le rapatriement des compétences exercées conjointement par l’UE et les institutions décentralisées vers le territoire britannique.
Sa contribution « analyse comment les enjeux économiques ont alimenté le débat politique autour de l’autonomie écossaise au sein du Royaume-Uni et de la perspective indépendantiste, dans un climat général d’incertitude et d’inquiétudes multiples face aux conséquences attendues du Brexit. »
- 12 Marie-Claire Considère-Charon, « Brexit à l’irlandaise : vers la remilitarisation de la frontière ? (…)
En Irlande du nord, la situation est compliquée par d’autres facteurs. Philippe Cauvet analyse les retombées constitutionnelles et politiques du résultat du référendum britannique dans ce territoire en des termes qui replacent le débat dans la longue durée. La frontière entre le Royaume-Uni et l’Irlande, seule frontière terrestre de chacun des deux pays, pose des difficultés qui ne sont pas seulement économiques et administratives. Elle reste une question fondamentale depuis l’indépendance de l’Irlande, il y a un siècle. Le Brexit aura des conséquences du Brexit sur les relations entre les communautés en présence, conséquences qui pourraient même aller jusqu’au retour d’un contrôle militaire de la zone frontalière12. Selon Philippe Cauvet, le problème que pose la frontière est dû aux failles inhérentes à l’accord de paix. Ces failles seraient de deux ordres, l’une étant la nature du partage des pouvoirs, qui, au lieu de contribuer à la construction de relations de confiance et d’un consensus, a renforcé la polarisation sectaire en Irlande du nord ; l’autre faille se situant au niveau de la définition constitutionnelle incomplète des rôles du Royaume-Uni et de l’Irlande comme co-garants de l’Accord du Vendredi Saint.
- 13 European Committee of the Regions, Assessing the exposure of EU27 regions and cities to the UK’s wi (…)
En élargissant la perspective au-delà des régions britanniques, le Brexit ne sera pas sans conséquences pour plusieurs régions européennes ayant un fort niveau d’échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. Selon un rapport de mars 2018 par le Conseil européen des régions, à part les régions irlandaises, qui seraient impactées au même niveau que le Royaume-Uni, en raison de leur forte intégration économique, des régions néerlandaises, belges, françaises (la Bretagne et les Hauts-de-France particulièrement dans le domaine de la pêche), mais aussi italiennes et espagnoles, seraient particulièrement exposées aux conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’UE. Le rapport détaille les secteurs économiques qui seraient les plus touchées : les secteurs de l’automobile, l’agriculture, l’alimentaire, la chimie et l’industrie13.
Le Brexit et le secteur de la finance
Un secteur en particulier au Royaume-Uni, celui de la finance, a été un des premiers à se soucier des effets du Brexit sur les échanges. C’est ainsi que trois articles se penchent sur les questions financières – en examinant tour à tour l’impact sur la prédominance de la « City » dans la finance mondiale, sur les relations trilatérales Royaume-Uni – Europe – États-Unis, et sur les conséquences monétaires pour l’ensemble.
- ‘Next Steps in the “Special Relationship” – Impact of a US-UK Free Trade Agreement’, Testimony by D (…)
- La ville globale – New York – Londres – Tokyo, chez Descartes, 1996. Voir le résumé de son parcours (…)
« Depuis des décennies, le Royaume-Uni a été le portail stratégique vers l’UE pour les entreprises et institutions financières américaines14 » selon Daniel S. Hamilton, professeur à John Hopkins University, specialiste des relations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis. C’est ainsi que les relations entre les Londres et New York, centres financiers historiques, villes « bi-moteurs de l’économie mondiale » selon l’expression de Saskia Sassen15, sont l’objet de l’article de Martine Azuelos :
Alors que le danger que représente le Brexit pour Londres en tant que place tournante de la finance mondiale a suscité beaucoup d’inquiétudes, ses effets potentiels sur les liens étroits existant entre Londres et New York, et que suggère la création du néologisme « NY-LON », ont fait couler beaucoup moins d’encre. C’est de cette deuxième question que traite cet article, en la replaçant dans le contexte plus large des débats sur la « relation spéciale » entre l’économie du Royaume-Uni et celle des Etats-Unis et sur le rôle des places financières dans le processus de mondialisation. La première partie met l’accent sur la centralité des investissements directs étrangers (IDE) et de la finance dans la relation entre les deux économies nationales et sur le rôle qu’ont joué les deux places de Londres et de New York dans la mondialisation. La deuxième partie définit « l’espace de flux » constitué par les deux villes globales jumelles et les fondements institutionnels qui sous-tendent ces flux en s’attachant à démontrer que la mondialisation est « enchâssée » dans l’espace que constitue NY-LON et dans les institutions qui s’y sont développées. En se fondant sur ce cadre d’analyse, la troisième partie fournit quelques pistes permettant de comprendre quels pourraient être les effets du Brexit sur NY-LON et sur la mondialisation.
Se centrant plutôt sur Londres, l’article de Nicolas Sowels souligne les principaux défis posés par le Brexit aux services financiers basés au Royaume-Uni et les défis qui existent également pour l’Union européenne. Il soutient que :
« les institutions financières ayant anticipé la possibilité d’un Brexit sans accord, les risques les plus graves d’instabilité financière sont moindres. Cependant, à long terme, le Brexit soulève des problèmes réglementaires importants, car l’accès au marché européen fondé sur « l’équivalence » sera beaucoup plus difficile que l’accès automatique actuel fondé sur la reconnaissance mutuelle et les « droits de passeport ». Ce processus engendrera des côuts pour le Royaume-Uni comme pour l’UE. »
Les risques d’instabilité économique pourraient être évitées par la planification, pour l’instant, laissée aux bons soins des entreprises, mais peu assurée par le gouvernement, préoccupé par l’obtention d’un accord sur les conditions de sortie.
- 16 Report by the Comptroller General and Auditor General. Cabinet Office: Civil Contingencies Secretar (…)
À partir de juin 2018 – certains diront tardivement – le gouvernement a affecté un nombre important de fonctionnaires (6,000) à cette tâche, nommée ‘Operation Yellowhammer’, à laquelle 1.5 milliard de livres sterling ont été alloués. Devant la possibilité grandissante d’une sortie sans accord avec l’UE, un rapport établi par les services d’audit, publié en mars 2019, fait état des zones de risques de perturbation pour lesquels des plans devaient être mis en œuvre : les transports, les frontières (personnes et marchandises), la santé, l’énergie (et autres industries « critiques », dont les télécommunications), l’alimentation et l’eau, les britanniques dans l’UE, le droit, la finance, l’Irlande du nord, les territoires outre-mer et dépendances britanniques (y compris Gibraltar), la sécurité nationale16. On notera que plusieurs de ces domaines (droit, santé, finance, Irlande du nord) font l’objet d’analyses dans ce numéro.
Adoptant encore cette double perspective d’analyse des conséquences intérieures et extérieures de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, Christian Aubin et Ibrahima Diouf analysent « Les conséquences monétaires du Brexit » pour le Royaume-Uni, pour l’Union européenne, et pour la zone euro :
« Même si le Royaume-Uni n’appartient pas à la zone euro, le Brexit a des conséquences monétaires qui ne doivent pas être ignorées. Les inquiétudes liées à la sortie de l’UE ont fortement affecté la monnaie britannique. L’impact prévisible du Brexit sur l’activité économique conduit la Banque d’Angleterre à adapter sa politique monétaire pour arbitrer entre stabilité monétaire et stabilité réelle. Enfin, la fragmentation financière induite par le Brexit peut entraîner un dysfonctionnement de la zone euro. »
Dans cette perspective, peut-on encore parler d’une économie « nationale » ? Le discours politique concernant la question de souveraineté nationale semble bien faible lorsqu’on se rend compte de cette imbrication des économies. Le paradoxe réel que l’ensemble de ces contributions souligne est celui de la difficile réconciliation entre, d’une part, l’indépendance et la souveraineté nationale, et, d’autre part, l’interdépendance et les échanges commerciaux dans l’économie mondialisée, et, en fin de compte, entre le politique et l’économique.
Notes:
1 Voir par exemple, Dominic Sandbrook, dans le quotidien conservateur, le Daily Mail, 31 janvier 2011, « The day Britain lost its soul. How decimalisation signalled the demise of a proudly independent nation ».
2 Timothy Whitton (dir.), Le Royaume-Uni de Theresa May, Observatoire de la société britannique, 21, 2018. Signalons également deux numéros de la Revue française de civilsation britannique : Karine Tournier-Sol (dir.) Le Référendum sur le Brexit du 23 juin 2016, Revue française de civilisation britannique, XXII-2, 2017 ; Stéphanie Bory, Fiona Simpkins, Le Brexit et les élections législatives britanniques de 2017, Revue française de civilisation britannique, XXIII-2, 2018.
3 Les coordinateurs de ce numéro adressent leurs remerciements aux laboratoires MIMMOC (EA 3812) et CECOJI (EA 7353) de l’Université de Poitiers, au Centre de recherches en civilisation britannique (CRECIB) et aux collègues qui ont participé à la journée d’études tenue à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers (USR 3565).
4 Les auteurs des articles dans ce numéro se trouvent dans la même position – bien moins grave certes – que les britanniques, chefs d’entreprise, simples citoyens, vacanciers, qui ont dû remettre sans cesse des décisions importantes devant l’impossibilité de prédire l’avenir ou de savoir quelle réglementation sera en vigueur à court ou à moyen terme.
5 https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/30/food-prices-to-finance-what-a-no-deal-brexit-could-mean-for-britain.
6 Mike Hawes, président de la Society of Motor Manufacturers and Traders, Colin Stanbridge, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Londres, The Guardian, 15 janvier 2019 ; Tom Enders, Airbus CEO urges UK decision makers to avoid no-deal Brexit, Airbus, 24 January 2019, https://www.airbus.com/search.video.html?page=3&lang=en&newsroom=true.
7 https://www.bls.gov/emp/ep_table_201.htm.
8 Peter Walker and Anushka Asthana, « Second Brexit analysis leak shows harm of tighter migration rules », The Guardian, 31 janvier 2018.
9 Ian Jack, « North to south, the seeds of division in Brexit Britain were sown long ago », The Guardian, 2 février 2019.
10 Sur Londres, voir Berbéri, C., « Londres : une ville plus favorable à l’euro que les autres villes du Royaume-Uni ? », Observatoire de la société britannique [En ligne], 11 | 2011, http://journals.openedition.org/osb/1187 ; DOI : 10.4000/osb.1187.
11 Site officiel de l’exécutif gallois : What impact will Brexit have on the Welsh economy? 13 April 2018, https://seneddresearch.blog/2018/04/13/what-impact-will-brexit-have-on-the-welsh-economy/. ″The scenario simulations reveal that Brexit will lead to the imposition of costs, either through the imposition of tariffs or the loss of preferential access to the single market. The impact on the Welsh economy will be felt via reductions in GDP, GDP per capita, trade, investment and employment. The least costly outcome for Wales is if the status quo can be held to for as long as possible. The next best or next least worst is the conclusion of a CETA type agreement by the EU. The most costly is a Brexit based on WTO rules.″
12 Marie-Claire Considère-Charon, « Brexit à l’irlandaise : vers la remilitarisation de la frontière ? », Observatoire de la société britannique [En ligne], 22 | 2018, mis en ligne le 01 mai 2019, consulté le 02 mars 2019. URL : http://journals.openedition.org/osb/2721; DOI : 10.4000/osb.2721.
13 European Committee of the Regions, Assessing the exposure of EU27 regions and cities to the UK’s withdrawal from the European Union, ECON Commission, 14 March 2018.
14 ‘Next Steps in the “Special Relationship” – Impact of a US-UK Free Trade Agreement’, Testimony by Dr. Daniel S. Hamilton, U.S. House of Representatives, Joint Hearing by the Subcommittee on Terrorism, Non-Proliferation and Trade Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats of the Committee on Foreign Affairs, February 1, 2017, p. 4.
15 La ville globale – New York – Londres – Tokyo, chez Descartes, 1996. Voir le résumé de son parcours dans l’éloge prononcé lors de l’attribution du Doctorat honoris causa à l’Université de Poitiers : https://journals.openedition.org/mimmoc/585.
16 Report by the Comptroller General and Auditor General. Cabinet Office: Civil Contingencies Secretariat. Contingency preparations for exiting the EU with no deal. National Audit Office, HC 2058, 12 March 2019. Suivant le report, en avril 2019, de la date de sortie de l’UE au 1er novembre, les fonctionnaires detaches à la planification des mesures d’urgence ont été renvoyés à leur ministères d’origine, et la planification d’urgence abandonnée. Richard Johnstone, ‘Brexit: Whitehall churn means government may never be as ready again for no deal, says IfG’, Civil Service World, 5 juin 2019.
Pour citer cet article
Référence papier
Susan Finding, « Introduction
Brexit, souveraineté nationale et mondialisation », Observatoire de la société britannique, 24 | 2019, 15-28.
Référence électronique
Susan Finding, « Introduction
Brexit, souveraineté nationale et mondialisation », Observatoire de la société britannique [En ligne], 24 | 2019, mis en ligne le 01 mai 2020, consulté le 15 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/osb/3146 ; DOI : https://doi.org/10.4000/osb.3146



 Vient de para
Vient de para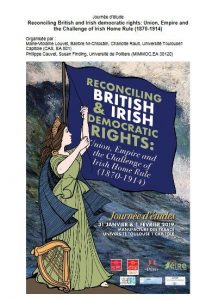




 Les retombées du résultat du référendum britannique ne sont pas encore claires – à part la décision de quitter l’Union européen qui devrait être entérinée, procédure qui pose elle-même de nombreuses interrogations – quand ? comment ? – mais l’
Les retombées du résultat du référendum britannique ne sont pas encore claires – à part la décision de quitter l’Union européen qui devrait être entérinée, procédure qui pose elle-même de nombreuses interrogations – quand ? comment ? – mais l’
