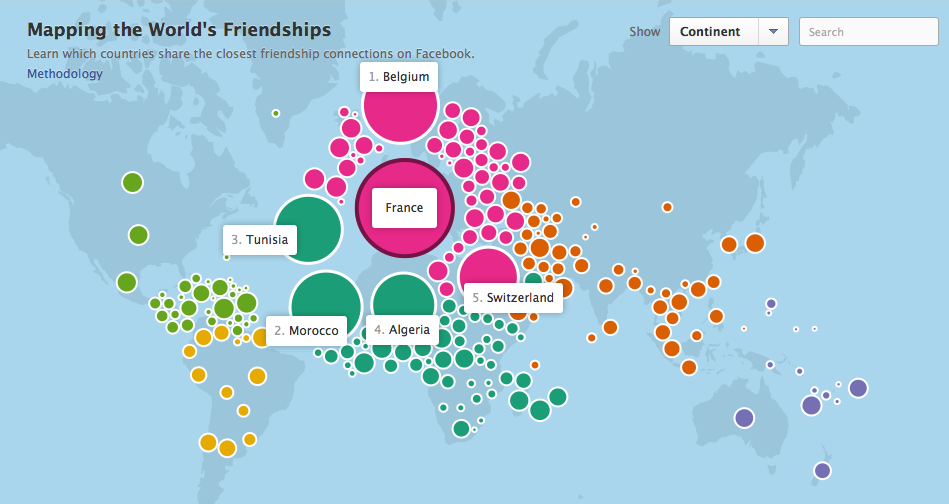Il n’aura échappé à personne que l’entreprise Heuliez fait l’objet de toutes les attentions du Conseil Régional de Poitou-Charentes depuis de nombreuses années et que régulièrement ce dossier fait la une des médias régionaux (ici par exemple tout récemment), bien sûr, mais aussi nationaux (là, fin septembre).
En bon économiste soucieux de l’utilisation de l’argent public et de l’évaluation des politiques mises en oeuvre sur les territoires, on peut se demander si cette attention est légitime et surtout si les sommes engagées l’ont été à bon escient.
A ce titre, je souhaite mettre en évidence un point particulier rarement évoqué dans les médias et dans le débat public : Heuliez est une entreprise localisée dans le Nord Deux-Sèvres, plus précisément dans le bocage Bressuirais. Quelle importance, me direz-vous ?
L’importance est grande : venir au secours d’une grande entreprise située sur un territoire connaissant un taux de chômage important et où les possibilités de redéploiement des personnes perdant leur emploi sont faibles, c’est une chose ; procéder de même sur un territoire où le taux de chômage est faible et où les personnes perdant leur emploi en retrouve rapidement un autre, c’en est une autre. D’où la question : qu’en est-il du Bressuirais ?
Pour y répondre, j’ai collecté les taux de chômage trimestriel, par zone d’emploi, de 2003 à 2013, pour différentes zones d’emploi de Poitou-Charentes. Pour faciliter l’analyse des chiffres, j’ai construit pour chaque zone un indicateur compris entre 0 et 100% qui permet de la situer dans l’ensemble national : si l’indice de la zone est compris entre 0 et 10%, c’est que la zone fait partie des 10% des zones d’emploi ayant le plus faible taux de chômage. Si son indice est compris entre 90% et 100%, la zone fait partie des 10% des zones ayant le plus fort taux de chômage.
Voici ce que ça donne pour les zones d’emploi sélectionnées :

Surprise : la zone d’emploi de Bressuire est celle qui connaît le plus faible taux de chômage de la Région depuis le premier trimestre 2003 et ce sans discontinuer. C’était vrai avant, depuis longtemps en fait. Elle fait partie en gros des 10% des zones d’emploi françaises qui connaissent les plus faibles taux de chômage.
Comment l’expliquer ? Le Bressuirais est en fait très proche du choletais et fonctionne de manière assez similaire : on y trouve de très nombreuses PME et les salariés circulent plutôt bien entre ces entreprises. Quand Heuliez va mal, les PME alentours peuvent recruter certains de ses salariés (et quand Heuliez va bien, les PME alentours ont toutes les peines du monde à trouver la main d’oeuvre dont elles ont besoin…). Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce territoire, je vous invite à parcourir l’étude que nous avions mené il y a quelques temps, en ligne sur le site de mon laboratoire (dédicace spéciale à Benjamin Guimond qui a fait un travail colossal sur cette étude).
A contrario, la situation des zones d’emploi de Rochefort, Royan et dans une moindre mesure La Rochelle est… comment dire… problématique… Les deux premières font partie des 20% des zones d’emploi ayant les plus forts taux de chômage. Forte dégradation sur Châtellerault entre 2007 et 2009, lente décroissance (relativement à l’ensemble national) depuis. Cognac a vu sa situation se dégrader un peu en 2009 (effondrement des ventes de Cognac), mais les choses se sont globalement rétablies. Niort et Poitiers vont bien, merci (un peu moins bien que sur le Bressuirais, mais ça va).
On pourra m’objecter que c’est précisément l’activisme du Conseil Régional qui permet d’observer cette situation sur le Bressuirais. Acceptons cette idée d’une intervention particulièrement efficace des instances régionales : on a très envie, alors, de leur demander de se pencher rapidement sur les cas de Rochefort, Royan, La Rochelle, Angoulême et Châtellerault. Autrement dit sur les cinq zones d’emploi de la Région qui, depuis plus de dix ans, souffrent le plus…
NB1 : merci à Olivier C. pour l’idée de ce graphique comparant les différentes zones de la Région, j’étais parti au départ sur la seule courbe du Bressuirais, cette version est beaucoup plus saisissante.
NB2 : après quelques échanges entre chercheurs de l’Université de Poitiers, nous nous sommes dit que le cas Heuliez était un cas particulièrement intéressant pour traiter de la dynamique économique de certains territoires et de la pertinence des politiques publiques. Nous allons nous atteler à la tâche dans les prochains mois, des suites à ce billet sont donc à attendre.
 Le CNER (fédération des agences de développement économique) a organisé le 2 juillet dernier un colloque intiitulé “Développement économique : la solution territoriale”. L’ouverture du colloque a été assurée par Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. J’ai ensuite participé à un débat avec Philippe Estèbe sur le thème “Décentraliser l’action économique, pourquoi?”.
Le CNER (fédération des agences de développement économique) a organisé le 2 juillet dernier un colloque intiitulé “Développement économique : la solution territoriale”. L’ouverture du colloque a été assurée par Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. J’ai ensuite participé à un débat avec Philippe Estèbe sur le thème “Décentraliser l’action économique, pourquoi?”.