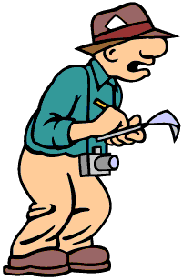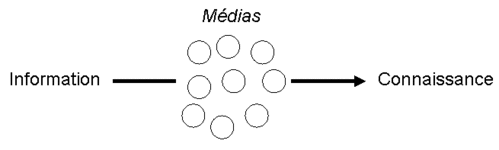Jean Arthuis est ancien Ministre de l’Economie et des Finances (de 1995 à 1997). Aujourd’hui, il est sénateur, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, Membre de la Conférence nationale des finances publiques, Président du conseil général de la Mayenne, et Membre de l’ Observatoire de la Décentralisation. Accessoirement, il est Membre du groupe d’études de l’élevage et de la section Cheval et conseiller de François Bayrou.
Il nous fait part de ses réflexions "approfondies" dans un ouvrage intitulé "Mondialisation – la France à contre-emploi".
Encore une quatrième de couverture qui fait réver, digne d’Eric Le Boucher :Comment se fait-il, me direz-vous, que Jean Arthuis se trompe à ce point sur le diagnostic? En fait, comme il n’est pas satisfait par les études économiques montrant que les délocalisations pèsent peu dans les destructions d’emploi, il a adopté une autre définition, puis commandé une étude par un cabinet de consultant. En caricaturant un peu, je dirais que le métier de consultant consiste à i) deviner les conclusions que le commanditaire aimerait bien obtenir, ii) batir une analyse validée empiriquement permettant d’arriver aux conclusions voulues. De ce fait, c’est sans surprise que l’étude commandée a "démontré" que les délocalisations pèsent beaucoup. Bien sûr, la presse s’en est fait largement l’écho sans jamais s’interroger sur la méthodologie employée…
Sa définition des délocalisations ? La voici, extraite du rapport qu’il a présenté au Sénat :
* Les délocalisations diffuses, qui correspondent au transfert et au regroupement vers un pays étranger d’une activité répartie sur plusieurs sites en France ; elles n’entraînent pas de fermetures d’établissement et sont beaucoup moins visibles que les délocalisations pures.
* Les non-localisations correspondent enfin aux ouvertures à l’étranger d’activités qui auraient pu être localisées en France, sans que les établissements français ne souffrent d’une quelconque perte d’emplois. Elles représentent un manque à gagner significatif pour notre pays en termes d’emplois, puisque ce sont autant d’emplois qui ne sont pas créés. Ce type de délocalisations est par nature très peu visible … et peu médiatisé.
La méthode employée? Comme les données statistiques ne le satisfont pas, il a demandé la production de chiffres reposant sur des interviews de chefs d’entreprises. Je cite son rapport :
"c’est ce qui a conduit votre commission des finances à opter pour une autre méthode à la fois micro-économique et qualitative, fondée sur des entretiens avec des chefs d’entreprises retenus sur la base d’échantillons, pour l’évaluation des emplois de services concernés à l’avenir par les délocalisations".Katalyse, cabinet de consultants, a produit l’étude, avec la définition et la méthodologie Arthuis et là, pas de problème, 202 000 emplois de services perdus au cours des 5 prochaines années… C’est la seule étude aussi alarmiste, réalisée non pas par des chercheurs mais par des consultants, mais c’est bien sûr la seule rigoureusement exacte.
Petite précision. Quand on entend "202 000 emplois de services perdus", on se dit, qu’on va mettre sur le carreau 202 000 personnes en France, et faire travailler à leur place des personnes à l’étranger. En fait non : sur les 202 000 emplois, 80% sont des non-localisations. Vous savez, cette catégorie supplémentaire ajoutée par Jean Arthuis. Il y aurait donc 40 000 emplois détruits en France dans les services pour cause de délocalisation sur les 5 prochaines années, soit 8 000 par an, ce qui est moins que les chiffres Insee sur l’industrie (13 500 emplois détruits par an), et ce qui est à mettre en regard des 30 000 embauches et départs quotidiens de l’emploi comptabilisés en France (Cahuc et Kramarz, p. 9). Mais personne dans les médias ne donnera ces précisions.
Ce n’est pas son coup d’essai, remarquez : en 1993, dans un autre rapport, il avait déjà adopté une définition ultra-extensive du phénomène (les importations sont aussi des délocalisations, et re-mercantilisme, les importations, c’est pas bien, na!), pour conclure que :
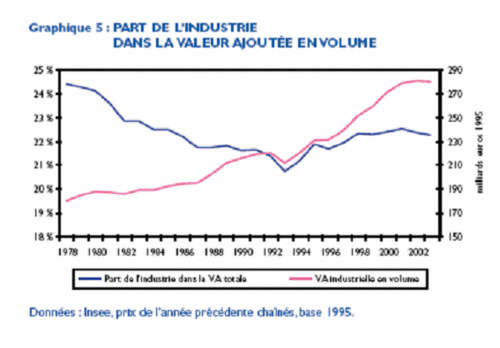
La valeur ajoutée industrielle en volume a constamment augmenté sur la période 1978-2002, en fait de 56%. Comme la valeur ajoutée totale a augmenté de 71% sur la même période, la part de l’industrie dans l’ensemble a diminué, mais somme toute faiblement, son poids passant de 24,4% à 22,2% entre 1978 et 2002. Mais surtout, et c’est là qu’on peut se régaler de la capacité d’anticipation d’Arthuis, on a assisté à un rebond en 1993 (point bas à 20,7%), puis à une stabilisation autour de 22%…. Savourez de nouveau les premiers mots de la quatrième de couverture : "Enfin, un tabou se brise. Il est maintenant admis que les délocalisations à répétition ont entraîné la France sur la pente d’une désindustrialisation catastrophique"… Il est maintenant admis par Arthuis, sur la base des définitions d’Arthuis, à partir de la méthodologie d’enquête d’Arthuis, et de l’analyse des résultats d’Arthuis que les délocalisations à répétition etc, etc… Jean Arthuis est ancien Ministre de l’Economie et des Finances de la France. Il est aussi Membre du groupe d’études de l’élevage et de la section Cheval et conseiller de François Bayrou…