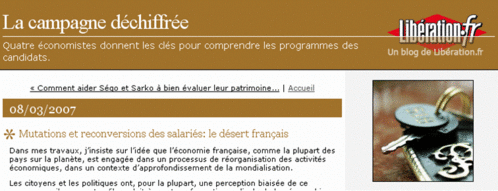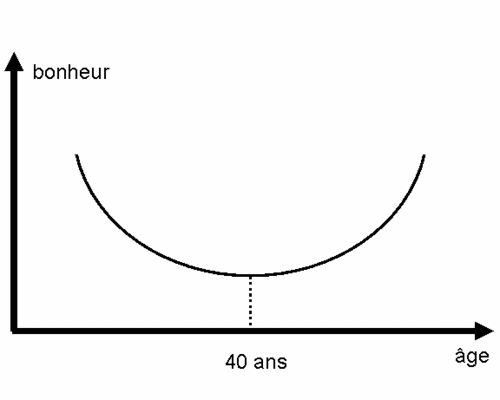On connaît la rengaine de Nicolas Sarkozy, par exemple ici :
"Il faut poser la question de l’augmentation des salaires dans notre pays parce que toute ma stratégie économique est fondée là dessus. Le premier problème économique des Français, c’est une question de pouvoir d’achat, il faut donner du pouvoir d’achat aux Français, pour donner de la croissance et pour cela il faut permettre aux gens de travailler plus. Il faut savoir qu’un salarié qui travaillerait quatre heures de plus pourrait gagner 15 % de plus. L’erreur des 35 heures a été une erreur considérable qui a conduit les Français à une rigueur salariale qui a pesé sur la croissance de la France." (source : l’interview de Nicolas Sarkozy dans l’emission « A vous de juger » sur France 2. 30/11/2006)
Discours bien assimilé par les politiques UMP, j’ai pu en juger sur France 3 l’autre jour (On a pu en juger également avec la réponse de Barnier à France Europe Express il y a quelques temps)… Les délocalisations? la faute aux 35 heures. La baisse du pouvoir d’achat? la faute aux 35 heures. Le problème des retraites? la faute aux 35 heures. L’Allemagne plus forte que la France? La faute aux 35 heures. La grippe aviaire? La faute aux 35 heures. etc.
On a donc un enchaînement assez simple : i) les 35 heures font que les gens travaillent moins. Si on leur permet de travailler plus, ils gagneront plus, ii) ce supplément de revenu sera dépensé, iii) ces dépenses de consommation alimenteront la croissance économique, iv) ce qui incitera à créer plus d’emplois et donc v) à réduire le chômage. THE cercle vertueux.
Il y a plusieurs problèmes avec cet enchaînement. L’un d’eux, et non des moindres, consiste à croire que les salariés peuvent choisir le nombre d’heures de travail. Il faut n’avoir jamais mis les pieds dans une grande surface ou dans une usine pour croire cela (Jules en a parlé dans l’un de ses billets). Un deuxième problème, et c’est sur ce point que je souhaite insister ici, résulte du fait que Nicolas Sarkozy considère qu’en France on ne travaille pas assez à cause des 35 heures. Les choses sont beaucoup moins simples (je ne suis pas le premier à le dire, voir par exemple cet article de Denis Clerc)…
Partons de l’indicateur habituellement utilisé pour dire des choses un peu intéressante sur le niveau de vie d’une population, à savoir le PIB par habitant (oui, je sais, il a plein de défaut, ce n’est pas l’essentiel ici).
Première décomposition
(1) PIB/HAB = PIB/L * L/HAB
PIB : Produit intérieur brut
HAB : nombre d’habitants
L : nombre d’actifs occupés
Le niveau de vie de la population dépend de la productivité apparente du travail (PIB/L) et du rapport entre actifs occupés et population totale (L/HAB).
Deuxième décomposition
Il s’agit de décomposer le deuxième rapport (L/HAB) comme suit :
L/HAB = L/PA * PA/HAB
PA : population active, qui est égale à la somme des actifs occupés (L) et des chômeurs (CHO)
Or, le rapport L/PA est le complément à 1 du taux de chômage. En effet :
PA = L + CHO
On divise doucement de chaque côté par PA :
PA/PA = L/PA + CHO/PA
On reconnaît, bouche bée, le taux de chômage (CHO/PA) qu’on va noter u (comme unemployment, ce qui montre au passage une certaine maîtrise de la langue de Shakespeare) :
1 = L/PA + u
On fait passer u de l’autre côté, et on a bien :
L/PA = 1 – u
On reporte tout ça dans la première relation :
(2) PIB/HAB = PIB/L * (1-u) * PA/HAB
Troisième décomposition, sur PIB/L, afin d’intégrer les heures travaillées (h) :
PIB/L = PIB/h * h/L
PIB/h est la productivité horaire du travail et h/L est le nombre d’heures travaillées par salarié, en moyenne.
On remet ça dans la relation (2) et on passe à (3) :
(3) PIB/HAB = PIB/h * h/L * (1-u) * PA/HAB
Quatrième décomposition
On va distinguer, juste pour le plaisir, entre les salariés à temps plein (L1) qui travaillent en moyenne h1 heures et les salariés à temps partiel (L2) qui travaillent en moyenne h2 heures (avec logiquement h2<h1) . D’où la nouvelle relation :
(4) PIB/HAB = PIB/h * (h1*L1 + h2*L2)/L * (1-u) * PA/HAB
Cinquième décomposition (la dernière !)
On s’attaque cette fois au rapport PA/HAB, en introduisant un nouveau terme, la population en âge de travailler (PEAT), autrement dit les personnes entre 15 et 64 ans :
PA/HAB = PA/PEAT * PEAT/HAB
PA/PEAT est le rapport entre la population active et la population en âge de travailler, autrement dit le taux d’activité. Notons le ta. PEAT/HAB est la part de la population en âge de travailler. C’est le complément à 1 de la part de la population qui n’est pas en âge de travailler. Notons cette dernière pneat (personnes non en âge de travailler). On introduit ça dans (4) et on obtient la décomposition finale :
(5) PIB/HAB = PIB/h * (h1L1 + h2L2)/L * (1-u) * ta * (1-pneat)
Bon, c’est un peu compliqué, d’accord, mais, désolé, le niveau de vie et son évolution dépendent de beaucoup de choses. En réduisant le problème à la question des 35 heures, autrement dit à l’un des éléments affectant le petit h1 de la relation on a tendance à occulter tout le reste… Alors que, on le voit, il y a bien d’autres choses qui jouent, et sur lesquelles il faut agir :
* PIB/h : la productivité horaire. Comme rappelé dans un billet précédent, ce n’est pas une erreur historique de dire qu’on peut gagner plus sans travailler plus, c’est au contraire une régularité historique, qui résulte précisément de la capacité des pays à gagner en productivité, autrement dit à produire plus de richesses avec autant de ressources. On peut s’interroger sur les moyens de faire gagner les entreprises en productivité : effort d’investissement des entreprises, investissement en formation initiale et continue, effort d’innovation technologique et organisationnelle, investissement en capital public, etc, etc, etc… Une part importante du débat économique devrait porter sur cette question, on en reste plutôt à des généralités me semble-t-il,
* h2L2/L : le temps partiel. On sait que le temps partiel subi n’est pas des moindres en France, il est encore plus élevé dans d’autres pays (Pays-Bas notamment). Pour faire monter le niveau de vie, on peut s’interroger sur les moyens de réduire ce temps partiel subi, qui affecte notamment les femmes… Ceci conduirait à réduire L2 en augmentant L1, donc à monter le temps total travaillé sans pour cela recourir à des heures supplémentaires (pour info, 17% des salariés travaillent à temps partiel, en moyenne 23 heures par semaine – voir ce document Dares pour des compléments sur le temps partiel en France),
* u : le taux de chômage, relié négativement au PIB par habitant. La mécanique implacable de l’UMP consistant à croire que monter h1 va conduire à faire baisser u (et donc monter PIB/HAB) est un peu rapide. Elle consiste en effet à supposer que le supplément de revenu octroyé aux salariés via les heures supplémentaires se traduira mécaniquement par un accroissement de la production nationale puis de l’emploi : tout dépend du contenu en emploi de cette croissance ; tout dépend aussi des biens que les ménages souhaitent acheter, s’ils sont fabriqués en France ou au contraire importés. Se pose donc la question de la capacité d’innovation et d’adaptation à la demande (nationale et mondiale) des entreprises localisées en France. De plus, le problème du chômage ne se réduit pas à un problème de croissance : se pose le problème de l’employabilité des personnes. Certaines ont du mal à changer d’activité car elles n’ont pas les connaissances minimales requises (voir ce billet). Ou encore, autre point largement occulté dans les débats : certaines personnes au chômage ont une mobilité spatiale très réduite, ce qui conduit à des désajustements entre des territoires pourvoyeurs d’emplois mais qui ne trouve pas preneurs, et d’autres territoires avec un chômage élevé (voir cet article pour des mesures et analyses de la mobilité des salariés). C’est une des raisons importantes du chômage, qui n’a rien à voir avec le coût du travail, les compétences, ou la prétendue fainéantise ou mauvaise volonté des chômeurs dénoncée par exemple par François Fillon. Je n’ai pas entendu un seul candidat évoquer cette question de la mobilité spatiale.
* ta : il y a deux choses ici. Le fait que le rapport peut être faible en raison du poids des jeunes inactifs de 15 à 24 ans. Ils sont en âge de travailler, mais inactifs, la plupart pour des raisons de poursuite d’étude. On ne peut guère souhaiter que les jeunes interrompent leurs études pour travailler, mais on pourrait réfléchir à proposer aux jeunes en étude du travail en lien avec celles-ci, ce qui faciliterait en passant leur entrée sur le marché du travail. Ca se fait dans d’autres pays, au Danemark par exemple, et ça marche plutôt bien. L’autre composante, à l’autre bout de la chaîne, correspond aux personnes disons entre 50 et 64 ans, qui sont en âge de travailler, elles-aussi, mais qui sont exclues du marché du travail (pré-retraites par exemple). On pourrait s’interroger sur les moyens de réduire cette part… sachant qu’il y a problème en France : le taux d’emploi est un des plus faible de l’Europe à 15 (63,1% en 2005) ; l’emploi des séniors est faible (38% des 55-64 ans sont en emploi, contre 44% dans l’UE15 en moyenne) ; les séniors français sont ceux qui sortent le plus tôt du marché du travail (âge moyen de sortie : 58,5 ans – Pour des compléments sur l’emploi des seniors, voir ce document Dares) ; l’emploi des jeunes aussi (30% des 15-24 ans contre 40% en moyenne dans l’UE15), et concerne peu les étudiants (en France, 1/4 des étudiants de 22 ans travaillent mais essentiellement dans des petits boulots sans lien avec leur étude, contre 2/3 au Danemark, avec des emplois mieux liés à leur formation),
* 1-pneat, enfin. On notera en passant que l’allongement de l’espérance de vie réduit automatiquement (1-pneat) donc le niveau de vie moyen. Pour faire monter ce ratio, on peut repousser l’âge de la retraite au-delà de 60 ans. Mais les personnes entre 50 et 60 ans ont déjà des problèmes de maintien sur le marché du travail, repousser l’âge de la retraite ne résoudra pas cette question. Autre possibilité pour agir sur le ratio : autoriser le travail des enfants (0-15 ans). Ca se discute. On peut aussi réduire autoritairement l’espérance de vie, mais ce n’est pas très politiquement correct non plus.