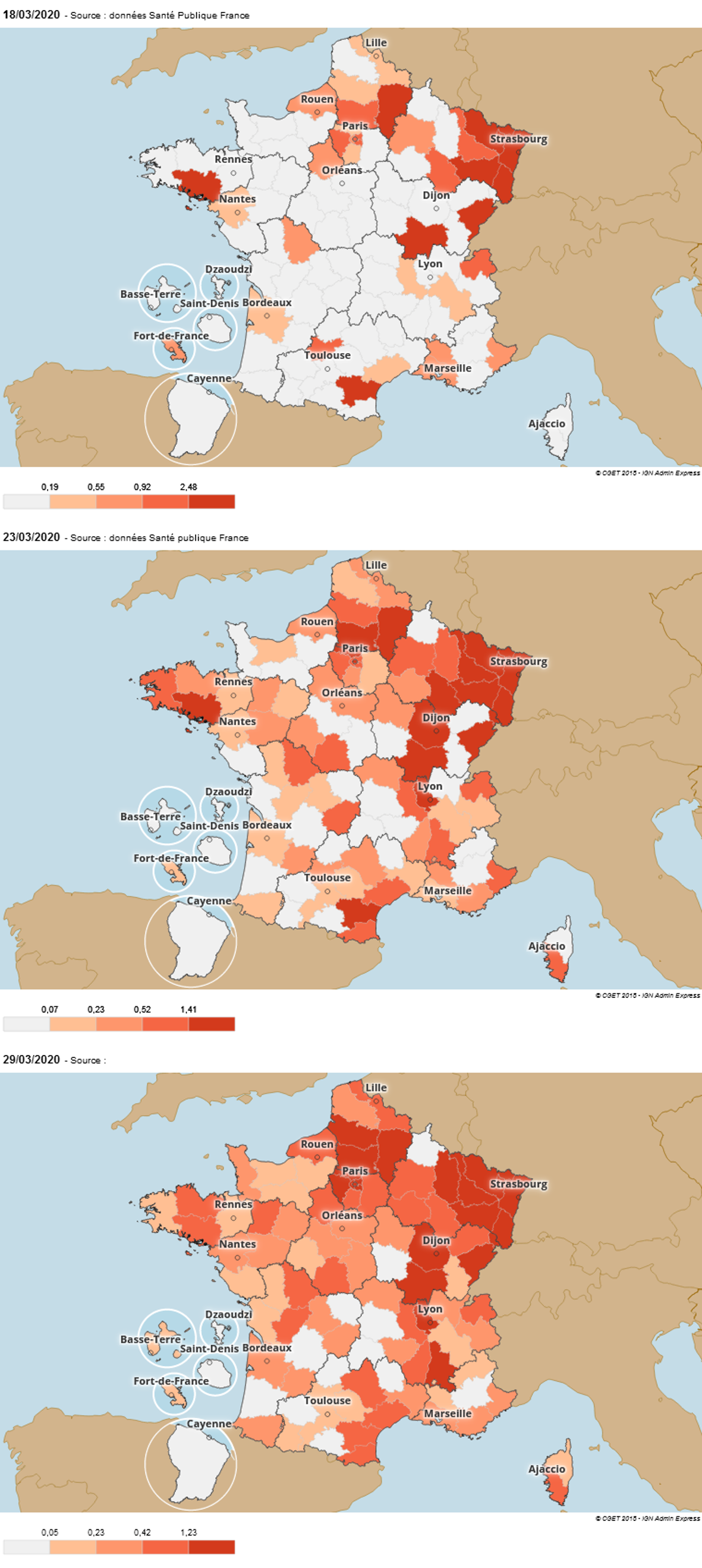[Edit 15/12/2018 : en italique quelques ajouts/compléments]
Le mouvement « gilets jaunes » m’interpelle, comme dirait l’autre, disons qu’il me fait me poser des questions sur ce qu’il signifie, quelles réponses apporter, ce genre de choses. Je ne le crois pas anecdotique, plutôt une sorte de révélateur de problèmes plus profonds, qu’il faut interroger.
J’imagine que je n’échappe pas au biais inévitable consistant à interpréter un évènement à la lumière de ce que j’ai en tête, de mes travaux récents, sans doute est-ce que je vais vous livrer des analyses biaisées, partielles, mais je me rassure en me disant qu’il ne s’agit pas pour moi de vous expliquer que « j’avais raison », ou encore que « je vous l’avais bien dit », mais plutôt de vous faire part de quelques interrogations, en essayant de lier le mouvement « gilets jaunes » à mes réflexions sur la Came (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) co-écrites avec Michel Grossetti, et puis de m’interroger avec vous sur « vers où on va ? », et puis surtout « que peut-on faire ? ». C’est cette dernière question, au fond, qui m’intéresse.
J’ai lu plein de choses intéressantes, sur le sujet des gilets jaunes : Aurélien Delpirou, qui explique que les gilets jaunes ne sont pas ceux qu’on croit (Edit : voir aussi ce billet plus récent, très punchy), Stéphane Ménia, qui donne de précieuses clés de lecture, Pierre Rosanvallon, assez inévitable, sur ce que ça signifie, et puis comment réenchanter le monde, parce que c’est la seule question qui compte.
Petits prolégomènes, d’abord. Dans nos articles sur la Came, ce que l’on essaye d’expliquer, c’est qu’il y a un ensemble de notions mises ensemble, en partie ou en totalité, qui structurent les représentations de bon nombre d’acteurs, sur tous les territoires, et qui influent ensuite sur les discours et sur les décisions prises. Des propositions du genre que, dans un contexte de mondialisation, il faut être compétitif, que pour cela, il faut arrêter de soutenir tous les territoires, se concentrer sur les plus performants, que les plus performants ce sont les métropoles, qu’il faut donc mettre le paquet sur elles, à charge de dédommager les perdants, et/ou de leur trouver un rôle, une petite place, quoi, histoire que tout le monde soit content, à la fin..
Suite au mouvement des « gilets jaunes », après avoir repensé à notre texte, à sa réception, à tout un ensemble d’échanges un peu partout en France, je me dis, qu’en fait, il y a deux niveaux dans la Came, deux effets différents :
- la Came comme description du monde réel,
- la Came comme description du monde vers lequel on va, vers lequel il faut aller, vers lequel on rêve d’aller, je ne sais pas trop quelle expression employer. Disons la Came comme description d’un monde inéluctable,
Certains collègues chercheurs considèrent que la Came correspond bien à ce monde inéluctable. C’est comme cela que j’interprète le texte Askenazy-Martin pour le CAE (à chaque fois que j’en parle je précise que je me demande ce que Philippe Askenazy, dont j’apprécie tant les analyses, est venu faire ici : il faudra qu’il clarifie, un jour), qui préconise d’arrêter de faire de l’aménagement du territoire, de mettre le paquet sur les meilleurs, ce genre de choses. Pour les autres territoires, si on met le paquet sur les meilleurs, on créera plus de richesses, on collectera plus d’impôts, on pourra donc dédommager les perdants, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Comme Philippe Martin préside désormais le Conseil d’Analyse Economique, je me dis que son avis n’est pas qu’un avis d’universitaire lu par quelques personnes, qu’il est un peu influent.
D’autres collègues défendent des positions assez proches, ils partagent l’idée que l’avenir, dans une économie mondialisée, va aux grandes métropoles, mais qu’il y a une place, au-delà de la redistribution, pour les autres territoires. Ce sont les histoires de systèmes productivo-résidentiels mises en avant dans la note de Davezies et Pech, reprises de manière délicieuse par Jean Viard, dans un texte pour la fondation Jean Jaurès, où il explique que « le fait d’être délaissés va favoriser le rôle [des territoires non métropolitains] dans la production de forêt, d’air et d’eau purs, de produits agricoles de qualité et de modes de vie « paisibles ». Je trouve intéressante cette répartition des rôles : je vais aller chausser mes bottes, et mettre mes gants de jardiniers.
Premiers messages aux gilets jaunes, donc, si je résume : « ne vous inquiétez pas, on va vous verser des allocations » (version redistribution), ou bien « plantez des arbres, et tondez vos pelouses » (version complémentarité productivo-résidentielle).
Bref, un premier ensemble de discours qui considèrent la Came comme le monde inéluctable, que le monde réel n’en est pas si loin, qu’il faut s’en approcher, un peu plus vite.
Face à eux, Christophe Guilluy. Il considère pour sa part que la Came est une bonne description du monde réel, mais il dénonce le fait que cela soit considéré comme le monde idéal, ou bien inévitable, il en appelle en gros à la révolte des oubliés. C’est la star des médias actuellement (interview Figaro, Europe 1, le Nouvel Obs, …). Je l’ai écouté ici, environ 15 minutes. Il inspire, me semble-t-il, la France Insoumise, le Rassemblement National, Vauquiez, …, sur l’échiquier politique. Il inspire tout le monde, je crois, si les propos rapportés par le Canard Enchaîné sont exacts, qui font dire à Macron que « Il ne faut sûrement pas désespérer la France périphérique, mais il ne faut pas non plus désespérer celle des métropoles ». Guilluy structure le a imposé un langage (métropoles contre France périphérique). Il structure donc les représentations. Par suite, l’action publique.
Que dire face à cela ? J’ai la conviction que la Came, l’idée selon laquelle, pour faire simple, l’avenir est aux métropoles et que la seule question qui vaille est celle du dédommagement, est fausse, non fondée empiriquement, qu’il faut donc décaler la focale. Je renvoie donc Askenazy, Martin, Davezies, Pech, Viard, Guilluy, …, tous ces collègues à l’influence non négligeable, qui relaient de différentes façons ces discours, vers la même question : où sont vos éléments de preuve ? Ils sont très friables, très contestables, autant que je puisse en juger. Mettons-les donc sur la place publique, et acceptez qu’on en discute ensemble. Arrêtez de croire que l’histoire est écrite, que l’innovation se joue simplement au sein des grandes villes, allez-vous promener, un peu, en France, regardez les richesses qui s’y trouvent. Arrêtez de résumer, de caricaturer, arrêtez de vous contenter de brasser quelques chiffres derrière vos ordinateurs, ou de vous réfugier derrière vos constructions intellectuelles : brassez vos chiffres, c’est important, je le sais, je les brasse, moi aussi, mais allez rencontrer les gens dont vous parlez, parfois, combinez à vos traitements statistiques, à vos constructions intellectuelles, des analyses qualitatives, de terrain, pour mieux comprendre vos “objets” de recherche.
La difficulté, selon moi : je conteste la vision Came, comme description du monde réel, elle ne tient pas la route, je pense pouvoir aligner de nombreux éléments de preuve pour vous le démontrer. Mais je la conteste aussi comme vision d’un monde souhaitable, ou bien inévitable. Je renvoie donc dos-à-dos Laurent Davezies et Christophe Guilluy, pour parler des plus médiatiques, ou des plus diffusés, ou des plus influents, à leur corps défendant, parfois. Je valide l’existence de fractures sociales, nombreuses et que l’on doit entendre, et que l’on doit traiter, mais je conteste la transposition géographique de ces fractures sociales, avec de nombreux autres (Rosanvallon, déjà cité, mais aussi Pierre Veltz, dans cette tribune).
Mais une fois cela dit, que fait-on ?
Je vous livre quelques intuitions sur les enjeux en termes d’action publique :
- on a besoin de règles et de régulations macroéconomiques, un peu globales. Faire en sorte que chaque personne, où qu’elle se trouve, puisse se former, se soigner, se déplacer, de manière un peu simple. L’Etat a donc un rôle à jouer, pour assurer, à tous, des services publics de qualité, de base, autour des questions de santé, d’éducation, de mobilité. Ce sont des choses qui vont peser de plus en plus, parce que la population vieillie, que les besoins de formation augmentent, donc l’enjeu, c’est de savoir comment on trouve des compromis acceptables, entre nous, comment on mutualise, quelles réponses on apporte pour répondre à ces besoins-là. L’Etat-nation a plein de choses à faire, à cette échelle,
- S’agissant des politiques conjoncturelles, de comment faire quand un choc affecte très fort le Monde, l’Europe, la France… on connait la réponse : il faut agir à l’échelle où se jouent les interdépendances. Pour la France, ça se joue à l’échelle de l’Europe, parce que, pour l’essentiel, on exporte/importe à cette échelle-là, sauf que jusqu’à présent, on ne peut pas dire qu’on est capable de construire des réponses un peu collectives. L’initiative portée par Piketty et consorts pour un nouveau traité européen me semble très bonne pourtant, dans cette perspective, mais elle est passée inaperçue, je crois (http://tdem.eu/). C’est pourtant à l’échelle européenne que l’on doit penser les politiques conjoncturelles, ainsi que certaines politiques structurelles évoquées dans le premier point,
- on a aussi besoin de réponses « locales », locales au sens un peu métaphorique, du genre trouvons des choses à faire ensemble, avec ceux avec qui je partage des choses à faire, qui sont parfois éloignées, qu’il faut aller chercher. Je suis assez convaincu que sur tous les sujets, on a des choses à faire ensemble, dans la proximité, qu’il faut rassembler les ressources et puis les énergies.
La question clé, au final, relève des représentations : doit-on se considérer comme rival, en concurrence, en compétition, …, quand on préside aux destinées d’un territoire, s’interroger sur comment tirer son épingle du jeu ? Ou doit-on, à l’inverse, s’interroger sur ce que l’on peut faire ensemble, avec qui travailler, pour régler nos problèmes communs ? La réponse est contenue dans la question, elle sonne comme l’évidence. Acceptons l’évidence, et travaillons ensemble.
Si l’on accepte l’évidence, il convient de réfléchir en termes d’action publique, plus généralement de réinvention de l’action démocratique. D’où mon sentiment que le problème n°1, celui qu’il faut régler, pour lequel on doit trouver des réponses, c’est celui évoqué par Pierre Rosanvallon :
Les représentants sont élus avec un si faible pourcentage aujourd’hui que leur légitimité de départ peut vite s’affaisser, et qu’il faut donc la renforcer par des épreuves permanentes de légitimation. L’onction électorale, il faut le rappeler, repose sur une fiction qui consiste à dire que la majorité exprime la volonté générale. Avec ces majorités courtes et un fort taux d’abstention, le pouvoir doit sans cesse relégitimer son « permis de gouverner », être évalué, contrôlé. Il faudrait aussi, comme on l’a dit, une démultiplication des formes de représentation. Cette révolte est le révélateur du nécessaire basculement des sociétés dans un nouvel âge du social et de l’action démocratique.
(…)
Mais le problème est davantage aujourd’hui celui d’une violence qui se substitue à une capacité stratégique défaillante. Cette violence a un fort pouvoir de séduction car elle donne un sentiment de renaissance et de puissance ; elle apparaît comme le signe d’une parole directement faite action, immédiatement efficace donc.
D’où sa légitimation croissante par des individus qui ne sont en rien des hérauts d’une improbable révolution. Dans ce cas, c’est donc au pouvoir en place, ainsi qu’aux partis et aux syndicats, de savoir être responsables pour deux.
Mon sentiment est qu’une fraction large, de plus en plus large, des citoyens, en ont marre des discours élitistes, qui percolent à toutes les échelles de territoire, discours selon lesquels il faudrait concentrer les efforts sur une élite économique (les startups, les talents, les créatifs), académiques (les “meilleurs” chercheurs), territoriale (les métropoles), … Je crois que nombre de politiques n’ont pas conscience de l’effet produit. Des citoyens prennent la parole pour s’opposer à ce discours, parfois de manière maladroite et contestable quand ils dérivent vers des discours populistes et xénophobes. Mais le problème essentiel ne relève pas de ces dérives : la question, c’est celle des représentations des acteurs en responsabilité, et des réponses qu’ils peuvent proposer. Je crois qu’elle n’ont rien d’évident. Mais elles me semblent urgentes.