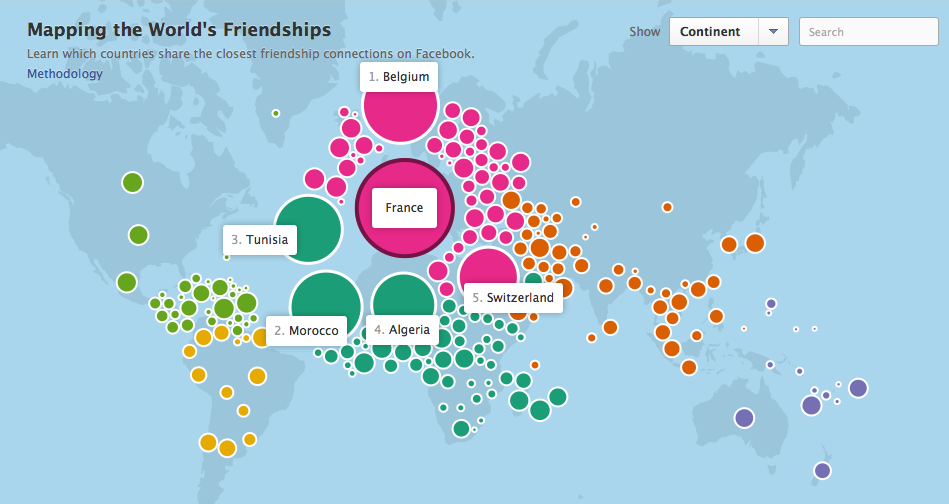Ça discute pas mal sur les réseaux sociaux autour de l’impact des mesures fiscales décidées par le gouvernement sur la création d’entreprise en France, certains évoquent la mort des auto-entrepreneurs, des start-up, etc.
Je ne me prononcerais pas sur le sujet, je souhaite juste apporter quelques éléments de réflexion (et quelques statistiques) sur la création d’entreprise en France, car mon sentiment est qu’il y a, de la part de certains, une sorte d’idéalisation de la figure du créateur d’entreprise, un peu comme si on avait affaire, de manière systématique, à des Bill Gates ou des Steve Jobs en puissance. La réalité est plus banale…
Petite analyse néo-institutionnaliste, à la Coase, un brin cynique. Plaçons nous dans la situation d’un individu qui souhaite disposer, chaque mois, d’un revenu pour couvrir ses dépenses. Plusieurs solutions s’offrent à lui :
- occuper un emploi dans une entreprise, une administration, une association, …
- créer une entreprise pour se dégager un revenu,
- rester inactif et vivre du revenu de son conjoint ou d’une autre personne (patrimoine hérité par exemple), ou vivre mal, tout simplement…
- vivre d’une allocation de l’Etat (allocation chômage par exemple si on ne parvient pas à trouver un emploi),
Le “choix” entre ces différentes possibilités dépend du gain espéré de la situation (est-ce que je vais réussir à décrocher un emploi? combien vais-je être payé? quelle est la nature du contrat de travail? Si je suis au chômage, quel sera le montant de l’allocation? Pour quelle durée? Si je créé mon entreprise, quel chiffre d’affaires j’espère dégager? Est-ce que mon entreprise sera pérenne? etc.) et du coût que je dois supporter pour accéder à cette situation (coût de prospection d’un emploi, coût de création d’une entreprise, contraintes imposées aux bénéficiaires d’allocation, etc.).
Toute chose égale par ailleurs, si vous durcissez les conditions sur une alternative, les acteurs, qui réagissent aux incitations, vont se tourner vers une autre alternative. Si, par exemple, vous durcissez les conditions nécessaires pour toucher des allocations chômage, certains chômeurs vont tenter de créer leur entreprise. Ils ne se rêvent pas Bill Gates ou Steve Jobs, ils veulent juste manger à la fin du mois… Idem pour chaque alternative.
Que nous apprennent les statistiques à ce sujet? Sans surprise, les créateurs d’entreprise sont surreprésentés parmi les chômeurs…

Ce tableau est issu de
ce document de l’Insee. 34% des créateurs d’entreprise de 2002 sont des chômeurs, proportion qui monte à 40% en 2006. Comme la part des chômeurs dans la population est très inférieure à ces chiffres, on en déduit que la propension à créer son entreprise est beaucoup plus forte pour les chômeurs. Que cette part augmente logiquement quand le chômage augmente et/ou quand le niveau des allocations baisse, ou encore quand les conditions de leur attribution se durcissent.
Autre élément issu du même document, la raison principale de la création d’entreprise :

Là encore, sans surprise, l’objectif essentiel est d’assurer son propre emploi. Avant de conquérir le monde, éventuellement…
On peut mobiliser le même raisonnement pour s’étonner de l’émoi suscité par le franchissement de la barre des trois millions de chômeurs. Je signale en effet,
chiffres à l’appui, qui si on ajoute les personnes au chômage et les personnes inactives qui souhaiteraient occuper un emploi (catégories 3 et 4 de ma petite typologie), cela fait longtemps qu’on a passé cette barre… 3,3 millions pour 2011… Là encore, si vous durcissez les conditions d’attribution des allocations chômage, le taux de chômage stricto sensu va diminuer, mais le “halo” du chômage (qui intégre les inactifs souhaitant travailler) va augmenter.
Je reviens à mes moutons (les créateurs d’entreprise), en mobilisant
un autre document de l’Insee, qui nous renseigne sur les auto-entrepreneurs. Catégorie un peu particulière, car pour partie il peut s’agir de personnes qui souhaitent percevoir un revenu complémentaire en se simplifiant la vie. Un professeur d’université peut par exemple arrondir ses fins de mois en faisant un peu de consulting, via ce statut (ce n’est pas mon cas, je précise, mais ça existe et c’est plutôt rationnel). Dans tout un ensemble de cas, cependant, il s’agit de personnes qui souhaitent percevoir des revenus plutôt que de rester au chômage. La simplification de la procédure de création d’entreprise via ce statut a conduit à une explosion du nombre d’auto-entrepreneurs. Non pas que des Bill Gates ou des Steve Jobs soient apparus en puissance en France, mais simplement que la structure des gains et des coûts entre les différentes alternatives en a été modifié.
Quel bilan? 30% des auto-entrepreneurs étaient auparavant chômeurs. Résultat conforme aux chiffres précédents. Chiffre d’affaires plutôt faiblard, en moyenne de 1000€ par mois (avec toute la difficulté liée au fait que pour certains, il ne s’agit que d’une activité accessoire, il faudrait des chiffres plus précis). Pas mal de création dans le conseil (activité accessoire?), le commerce, le service aux ménages et la construction. On est toujours loin de Steve Jobs.
En résumé, on peut contester le projet de réforme fiscale, on peut défendre la création d’entreprise, mais autant en avoir une vision plus conforme à la réalité…
 Ce tableau est issu de ce document de l’Insee. 34% des créateurs d’entreprise de 2002 sont des chômeurs, proportion qui monte à 40% en 2006. Comme la part des chômeurs dans la population est très inférieure à ces chiffres, on en déduit que la propension à créer son entreprise est beaucoup plus forte pour les chômeurs. Que cette part augmente logiquement quand le chômage augmente et/ou quand le niveau des allocations baisse, ou encore quand les conditions de leur attribution se durcissent.
Ce tableau est issu de ce document de l’Insee. 34% des créateurs d’entreprise de 2002 sont des chômeurs, proportion qui monte à 40% en 2006. Comme la part des chômeurs dans la population est très inférieure à ces chiffres, on en déduit que la propension à créer son entreprise est beaucoup plus forte pour les chômeurs. Que cette part augmente logiquement quand le chômage augmente et/ou quand le niveau des allocations baisse, ou encore quand les conditions de leur attribution se durcissent. Là encore, sans surprise, l’objectif essentiel est d’assurer son propre emploi. Avant de conquérir le monde, éventuellement…
Là encore, sans surprise, l’objectif essentiel est d’assurer son propre emploi. Avant de conquérir le monde, éventuellement…