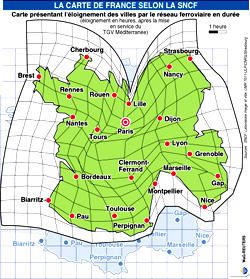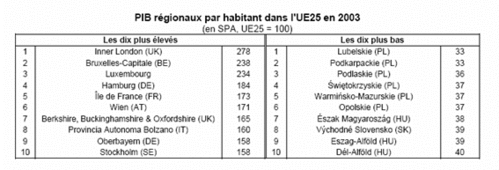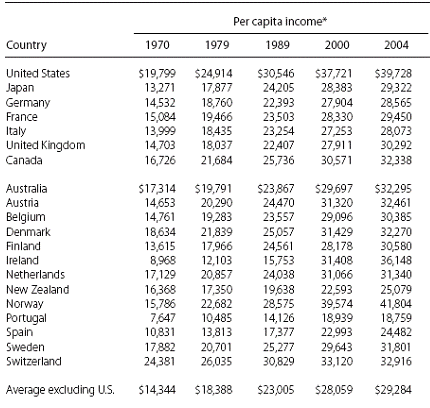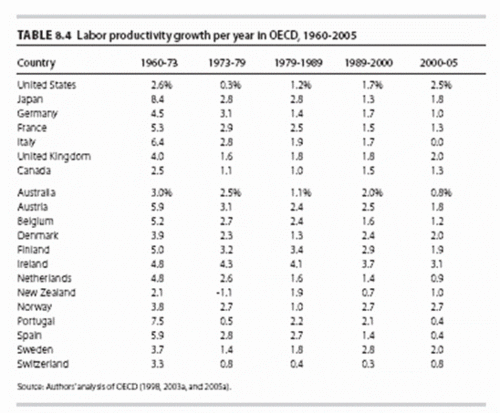Vous le savez sans doute, les prévisions des experts, notamment économiques se révèlent souvent fausses. Si vous ne le saviez pas, Philip Tetlock le montre clairement dans son dernier ouvrage Expert Political Judgment. Mais il fait plus que cela : il explique pourquoi.
En fait, dit-il, les experts consultés sont souvent de mauvais experts. Mieux encore : plus ils sont mauvais, plus il sont consultés. Plutôt politiquement incorrect, me direz-vous, mais la démonstration est assez convaincante.
Il effectue d’abord des tests psychologiques pour déterminer deux catégories d’individus : les Hérissons et les Renards. Si vous êtes plutôt d’accord avec cela : « c’est pénible d’entendre des gens ne pas parvenir à se faire une opinion » et « l’erreur la plus fréquente en matière de décision consiste à abandonner trop vite une bonne idée », vous êtes un Hérisson. Si au contraire, vous êtes plutôt du genre « dans la plupart des conflits, j’arrive à voir dans quelle mesure les deux parties ont raison » et « je préfère interagir avec des personnes ayant des idées très différentes des miennes » ; vous êtes plutôt Renard.
Autrement dit, en forçant à peine le trait, le Hérisson se caractérise par le fait qu’il a une et une seule règle de décision en tête, qu’il voit tout ce qui valide sa règle et dispose d’explications toutes prêtes en cas de défaillance de sa règle. Pendant ce temps le Renard collecte de l’information de différentes sources, révise son jugement en fonction de ces informations et envisage un large ensemble des possibles.
Bien, quid des prédictions de nos deux animaux ? Et bien, figurez-vous que les prédictions du Renard sont meilleures que celles du Hérisson… mais que les caractéristiques du Hérisson sont exactement celles que recherchent les leaders de tous horizons. Ce que John Kay, dans un billet pour le Financial Times sur l’ouvrage de Tetlock, explique ainsi :
Et de citer le hérisson politique, qui envahit l’Irak, le hérisson des affaires, qui délocalise en Chine, le hérisson financier, qui investit dans la nouvelle économie, etc.
Bon, inutile de dire qu’en France, les hérissons sont légion. Je n’évoquerai qu’un exemple récent: le problème des méthodes d’apprentissage de la lecture…
Grave problème pour l’éducation nationale : les difficultés de lecture des jeunes entrant en sixième (15 à 20% des élèves auraient des difficultés pour lire et écrire selon le ministère). Hérisson-de Robien a trouvé sa règle de décision : les difficultés de lecture résulte de la méthode d’apprentissage en vigueur dans les écoles, à savoir la méthode globale. D’où la proposition du Hérisson
Question du journaliste du Figaro : « Beaucoup d’enseignants disent que ce débat est dépassé car la méthode globale ne serait plus appliquée. »
Réponse du Hérisson, qui, je vous le rappelle, dispose d’explications toutes prêtes en cas de défaillance de sa règle :
Et attention à ne pas s’opposer : Roland Goignoux, professeur d’IUFM, n’a pas été reconduit comme enseignant à l’Ecole supérieure de l’Education Nationale pour … avoir écrit un livre. Motif invoqué par le directeur de cette école :
Pour vous faire une idée de la dangerosité de cet individu, je vous invite à consulter ce site. Extraits :
Aucune étude de neurosciences n’a porté, à ma connaissance, sur le rapport entre les pratiques pédagogiques des maîtres de cours préparatoire et le fonctionnement du cerveau. Il y a, entre ces deux questions, un nombre considérable de niveaux d’analyse qui sont loin d’être maîtrisés et encore moins d’être modélisés simultanément !
(…)
Est-ce que pour autant les résultats des sciences cognitives permettent de conclure à la supériorité de telle ou telle méthode ? Non, bien sûr, et je partage sur ce point l’avis de Franck Ramus lorsqu’il affirme dans Le Figaro : « À l’heure actuelle, les recherches en neurosciences ne sont pas assez avancées pour valider ou invalider telle ou telle pratique ». Tout au plus, me semble-t-il, permettent-elles d’indiquer les composantes de la lecture que la pédagogie n’a pas le droit de négliger si elle ne veut pas prendre le risque de pénaliser les élèves. C’est plus modeste mais plus rigoureux.
(…)
Si aucune étude comparative des méthodes de lecture en pays francophones n’a permis d’établir la supériorité de l’une par rapport à l’autre, ce n’est pas parce que toutes les pratiques se valent mais parce que la variable « méthode », trop grossière et mal définie, n’est pas une variable pertinente pour une telle recherche. Pour comprendre ce qui différencie véritablement les choix pédagogiques opérés par les maîtres et pour évaluer leurs effets sur les apprentissages des élèves, il est nécessaire de substituer à cette approche en termes de « méthode » une analyse reposant sur l’examen simultané de nombreux indicateurs. Et de ne pas se contenter des déclarations des enseignants mais d’observer le détail de leurs pratiques effectives. Pourquoi ne proposerions-nous pas ensemble au ministre de conduire une telle recherche ?
Roland Goignoux a un côté Renard, forcément déplaisant pour notre Ministre-Hérisson…
Quant à la proposition de Goignoux de conduire une recherche sur ce thème, on peut anticiper la réponse : à quoi bon une nouvelle étude ? Après tout, comme l’a affirmé notre Premier Ministre sur un autre sujet, « une étude ne fait pas le printemps, pas plus qu’une hirondelle »… (source). Beau réflexe de Hérisson…
Complément de dernière minute : Le World Economic Forum a publié son nouveau classement des pays. La France est au 18ème rang. Chute de 6 places. Problème évoqué, entre autres : "la France souffre d’un manque d’efficacité et de flexibilité" sur le marché du travail (voir ici ce que je dis de la confusion flexibilité des entreprises – flexibilité du marché du travail). Econoclaste se désespère de ce genre de classement. Je partage son sentiment et ses remarques. Voir ce que je disais du classement Banque Mondiale dans un précédent billet. A noter que le classement du WEF s’appuie pour une part importante sur une enquête à dire d’experts. 11 000 "business leaders" interrogés dans 125 pays. Soit une moyenne de 88 experts par pays. J’aimerais bien avoir la liste des leaders français. En tout cas, ça nous fait un sacré troupeau de hérissons…