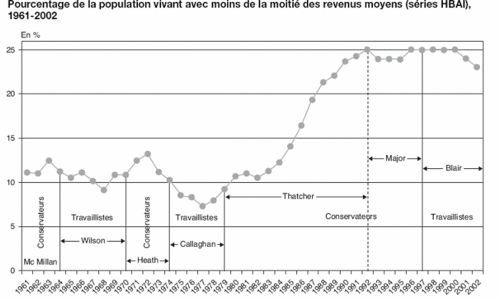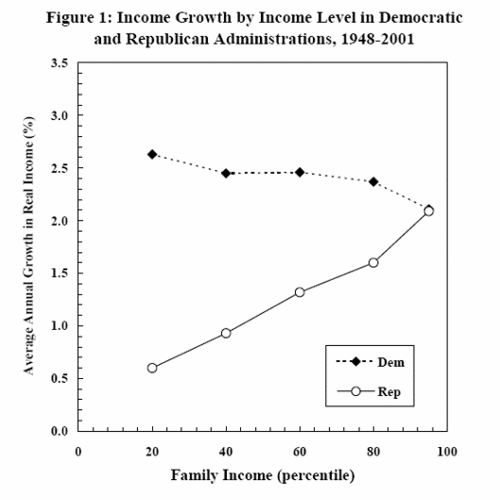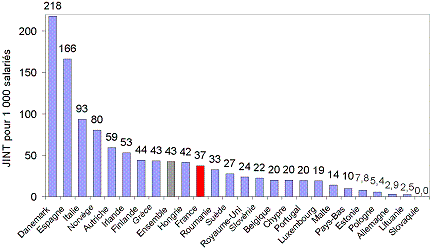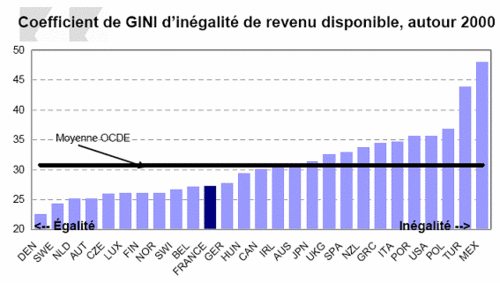
Premier graphique : les inégalités en termes de revenu disponible (ie après impôts et transferts) varient fortement d’un pays à l’autre. Les pays les plus égalitaires sont le Danemark, la Suède, les Pays-Bas ; les plus inégalitaires sont le Mexique, la Turquie, la Pologne et les Etats-Unis. La France est dans une situation intermédiaire, avec des inégalités plus faibles que dans la moyenne des pays de l’OCDE. On notera la proximité de la France, de l’Allemagne et de la Belgique.
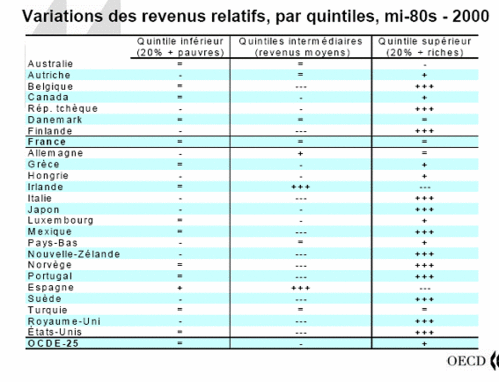
Deuxième graphique : l’évolution par quintile. L’idée est de décomposer la population en différentes classes : les "pauvres" (quintile inférieur), les "riches" (quintile supérieur), les classes moyennes (quintiles intermédiaires). On regarde ensuite la progression des revenus de chaque classe, on affecte des —, –, -, =, +, ++, +++ en fonction des évolutions. On retrouve le résultat rappelé plus haut : grande stabilité dans l’évolution des inégalités en France. Globalement, dans l’OCDE, on observe une stabilité dans la situation des pauvres, une détérioration de la situation des classes moyennes, une amélioration de la situation des plus riches. Je vous laisse observer les situations plus précises de chaque pays.
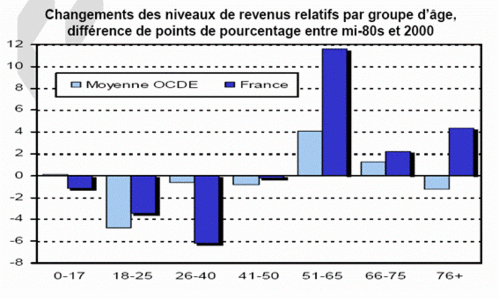
Troisième graphique : une nouvelle décomposition, non plus par classe de revenu, mais par âge. C’est sans doute le graphique le plus saisissant! La France se distingue par une évolution relative très défavorable des "jeunes" entre 26 et 40 ans (que personne ne me dise que les 26-40 ans ne sont plus jeunes 🙂 ) et particulièrement favorable des 51-65 ans et, dans une moinde mesure, des tranches d’âge encore supérieures. Bref, il fait bon être vieux dans notre doux pays!
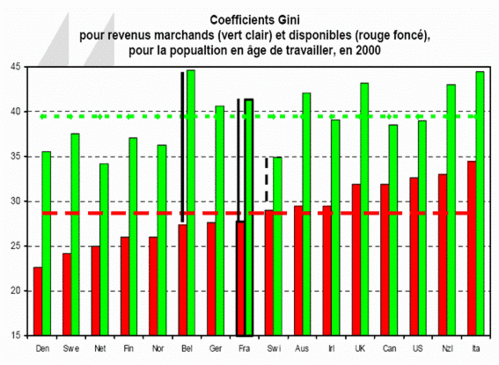
Quatrième graphique : la distinction revenu marchand (avant impôt/transfert) et revenu disponible (après impôt/transfert). Entre les deux, l’Etat (au sens large) est passé par là, pour faire de la redistribution. On observe, et c’est heureux!, que dans tous les cas, les inégalités après redistribution sont plus faibles qu’avant, signe que l’Etat "prend aux riches pour donner aux pauvres". Bon, mais plus ou moins cependant, selon les pays! Ca redistribue énormément au Danemark et en Suède, mais aussi en Belgique, et plutôt pas mal en France. Ce graphique est intéressant, car on constate qu’avant redistribution, les inégalités sont beaucoup plus faibles au Danemark (indice de 35 environ) qu’en Belgique par exemple (indice de 45). Les deux pays font un grand effort de redistribution, je dirais même un effort comparable, si bien que l’écart initial entre les deux pays demeure. On peut se dire que pour réduire encore les disparités, la Belgique a intérêt à agir en amont de la redistribution, au niveau de la distribution primaire des revenus. Idem pour la France, qui présente des inégalités avant redistribution somme toute assez fortes…
Complément au complément, maintenant, avec deux graphiques tirés d’une étude de Piketty. Celui-ci a collecté des stats sur la part dans les revenus (avant/après impôt) du décile / centile supérieur, et ce sur très longue période.
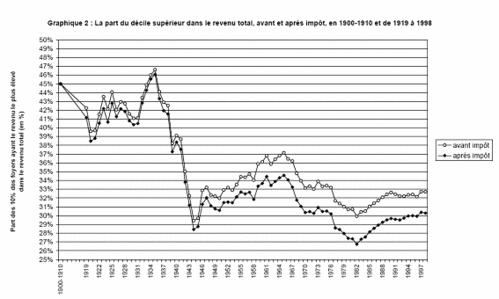
S’agissant du décile supérieur (les 10% des foyers les plus riches), on observe un accroissement de leur part dans le revenu total des années 40 au milieu des années 1960, une baisse ensuite jusqu’au début des années 1980, puis un accroissement depuis. Difficile de relier cela à la couleur politique des gouvernements, même si certains ne manqueront pas de souligner que le point de retournement (1982-1983) correspond à la mise en oeuvre de la politique de désinflation compétitive du gouvernement socialiste, politique toujours en vigueur depuis lors…
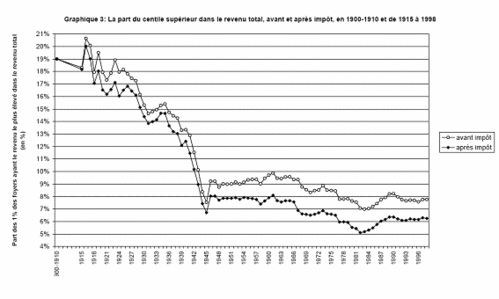
S’agissant du premier centile, c’est-à-dire vraiment les très très riches (les 1% les plus riches), on observe une stabilité/légère baisse de leur poids depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Leur poids a aussi augmenté, mais plus légèrement que pour le premier décile, de 1982 à 1990.
Pour en revenir au débat Krugman/Mankiw, ces deux derniers graphiques montrent la nécessité de distinguer, sans doute, entre l’analyse des 90/10 et celle des 99/1, comme le suggère aussi Josh Bivens.
Notons pour finir que les graphiques de Piketty ne permettent pas de saisir les effets générationnels, dont on a vu l’importance plus haut.