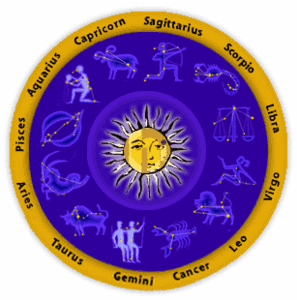Petits rappels : le groupe suisse Calida a racheté en juillet 2005 l’entreprise Aubade. Elle a décidé récemment de licencier 180 personnes travaillant sur le site de la Trimouille (Vienne), l’activité de production étant délocalisée en Tunisie. D’où la question : pourquoi cette délocalisation?
Dans un billet précédent, j’ai expliqué que l’hypothèse d’un licenciement boursier était plus que sujette à caution : Calida est un groupe familial à l’abri d’éventuels investisseurs institutionnels court-termistes. La délocalisation est plutôt sous-tendue par la stratégie industrielle du groupe. Explications.
Aubade est une entreprise qui appartient au secteur du textile – habillement. Elle est spécialisée dans la lingerie (principalement féminine) et sur le segment du haut de gamme. Elle est confrontée à une double concurrence : i) concurrence d’entreprises localisées dans des pays en voie de développement, notamment d’Asie, qui fabriquent des biens partiellement substituables (lingerie de gamme inférieure (montée de gamme en cours) à prix inférieur), ii) concurrence surtout des autres entreprises positionnées sur le même créneau : Dim, Playtex, Wonderbra, Princesse Tam-Tam, Barbara, etc… Pour maintenir son avantage concurrentiel, Calida-Aubade cherche donc à réagir, en développant une stratégie multidimensionnelle.
1. La stratégie industrielle de Calida-Aubade
Différenciation
La stratégie de différenciation est double : différenciation verticale, d’abord, en développant la qualité des produits, différenciation horizontale, ensuite, avec comme arme essentielle la stratégie marketing. S’agissant du premier point, on estime qu’Aubade consacre 3% de ses ventes annuelles à la R&D. Preuve que l’innovation n’est pas qu’affaire de haute technologie. Sur le deuxième point : Aubade consacre 10% de son chiffre d’affaires à la communication, dont on connaît l’efficacité (les 71 leçons de séduction).
Diversification
La diversification est à la fois de la diversification géographique et de la diversification produit. Sur le premier point, Aubade réalise 55% de ses ventes en France et à peine 20% hors d’Europe. Cette « faible » internationalisation pèse en partie sur ses résultats, en raison de la faible croissance française et européenne, comparativement à la croissance observée sur d’autres continents. Le groupe souhaite donc renforcer cet engagement à l’international. Sur la diversification produit, Aubade s’est lancée en 2002 dans la fabrication de maillots de bain et en 2005 dans les dessous pour hommes. Ces deux activités représentent 8% du chiffre d’affaires.
Flexibilité
Les effets de mode et les besoins de différenciation des consommateurs obligent les entreprises à renouveler sans cesse leurs produits. Aubade n’échappe pas à la règle : sur la lingerie féminine, elle propose huit collections deux fois par an. L’étape « conception des produits » est donc tout à fait fondamentale.
Réduction des coûts
On oppose trop souvent logique d’innovation et logique de coût, en pensant qu’une entreprise innovante n’a pas à se préoccuper outre mesure du niveau de ses coûts. En dehors de quelques secteurs très spécifiques, cette opposition n’est pas pertinente : l’entreprise se doit d’être innovante tout en répondant à une contrainte forte de coût (et à l’impératif de flexibilité).
Ceci conduit certaines entreprises à procéder à des délocalisations. Non pas de l’ensemble des étapes du processus productif, mais des étapes délocalisables. Quelles sont ces étapes ? Pour l’essentiel, celles qui réclament une main d’œuvre dite peu qualifiée. Le groupe Calida est engagé depuis longtemps dans cette stratégie : 70% de la production est réalisé en Tunisie. Les autres unités de production sont localisées en Hongrie et, jusqu’à récemment, en France.
2. Les effets de la stratégie sur l’emploi
Pour comprendre les incidences de la réorganisation d’Aubade sur l’emploi, il faut procéder à une analyse par grande fonction de l’entreprise, en distinguant les étapes de conception, production, distribution et marketing :

L’étape de conception est essentielle, elle vise à développer des produits innovants permettant de sortir de la guerre des coûts. Cette étape se nourrit de dépenses de R&D (3% du CA) et de main d’oeuvre qualifiée (H pour capital Humain). Cette activité est localisée dans les pays développés, plus précisément sur les territoires denses en compétences adaptées. Il s’agit souvent de territoires métropolitains, dotés d’institutions de formation dans le domaine (design notamment). Implication : création d’emplois qualifiés dans certains territoires des pays développés.
L’étape de production réclame pour l’essentiel du travail peu qualifié. Dans le secteur du textile-habillement, industrie de main d’œuvre par excellence, l’automatisation du processus est plutôt faible, si bien que le coût du travail est la composante essentielle du coût de production. L’avantage de coût d’un pays comme la Tunisie incite fortement Aubade à localiser la production dans ce pays. Le fait que Calida connaisse ce pays (il y a délocalisé depuis longtemps une large partie de l’activité de fabrication du groupe) peut laisser penser que les coûts d’une coordination à distance, d’une part, l’ensemble des coûts de production, d’autre part, sont plutôt bien connus. Implication : destruction d’emplois peu qualifiés dans les pays développés, création d’emplois dans les pays en développement.
L’étape de distribution est étroitement liée à la géographie de la demande. L’enjeu pour Aubade est de développer des réseaux de distribution de ses produits, afin de dépendre de manière moins importante de l’évolution de la demande en métropole. Elle peut, pour cela, s’engager dans des relations de marché (appel à des distributeurs indépendants), des relations de coopération (franchisés) ou des relations hiérarchiques (développement de ses propres boutiques par croissance interne ou externe). Les qualifications nécessaires pour vendre en boutique les produits Aubade ne sont pas très élevées, mais les boutiques sont localisées dans les plus grandes agglomérations, plus précisément encore dans les quartiers les plus chics de ces agglomérations. Implication : création d’emplois sur certains territoires des pays développés ou de certains pays en développement à demande fortement croissante.
L’étape Marketing, enfin, obéit à une logique similaire à l’étape de conception : coûts fixes importants (dépenses de publicité), main d’œuvre qualifiée, localisation sur les territoires des pays développés qui disposent de cette main d’œuvre et des institutions de formation adaptées. Une localisation à proximité des principaux foyers de clientèle est souvent nécessaire afin de « sentir » les évolutions de la demande et de mieux vendre les produits. Implication : création d’emplois qualifiés sur certains territoires des pays développés.
Au final, si on généralise l’exemple, on devine une double implication en termes d’emplois : i) création d’emplois qualifiés dans les pays développés, destruction d’emploi peu qualifiés, ii) création d’emplois peu qualifiés dans les pays en développement. Cette double dynamique laisse ouverte la question du solde global sur l’emploi dans les pays développés. Plusieurs études tendent à montrer que le solde est plutôt positif, mais clairement biaisé au détriment des personnes à moindre qualification.
3. Implication en termes d’action publique
L’interdiction des délocalisations a toutes les chances d’être contreproductive : non seulement l’entreprise verra son désavantage sur l’étape fabrication s’accentuer, mais en plus son effort en matière de conception/marketing et de diversification géographique risque d’être plombé par les surcoûts occasionnés. Même chose si l’on conditionne d’éventuelles subventions à l’engagement à ne pas délocaliser : la délocalisation est un moyen pour les entreprises de réorganiser leur activité productive afin de conserver leur avantage concurrentiel. Ceci ne signifie pas que toute délocalisation est rationnelle (cf. un billet précédent), mais, à l’inverse, il ne faudrait pas croire qu’aucune délocalisation n’est rationnelle… Je rappelle également que les délocalisations sont un levier important de création d’emplois et de richesses dans les pays en développement, ce dont ils ont, paraît-il, un peu besoin (et si l’on pousse un cran plus loin : le développement de ces pays participe à l’accroissement mondial de la demande, donc à la création de nouveaux débouchés pour les entreprises localisées dans les pays développés, etc.).
Est-ce à dire qu’il faut laisser faire les entreprises, à charge pour la collectivité de gérer les transitions ? Non, et ce pour une raison évidente : la délocalisation de l’entreprise de la Trimouille était largement anticipable depuis plusieurs années, aussi aurait-on pu s’interroger sur le problème de la reconversion des personnes peu qualifiées au sein du groupe et/ou au sein du territoire (le « on » désignant l’entreprise et les collectivités locales).
Deux grandes possibilités existent :
* développer la formation de ces personnes afin qu’elles puissent évoluer dans le groupe ou qu’elles puissent être employées dans d’autres entreprises du territoire (territoire régional ou départemental, avec des problèmes évidents de mobilité géographique de la main d’œuvre),
* s’interroger sur les emplois peu qualifiés en émergence : une prospective du Conseil d’Analyse Stratégique (une publication pilotée par C. Afriat est prévue en décembre 2006) indique qu’à horizon 2015, 25% des emplois créés en France relèveront des Services aux Personnes. Il y a là matière à repositionnement des personnes les moins qualifiées, pour autant que l’on anticipe les besoins et que l’on travaille à l’organisation de cette filière d’activité, afin que les emplois proposés ne soient pas sous-payés, fragmentés, etc…
La première possibilité est, dans l’état actuel des choses, difficile à mettre en œuvre : tant que l’entreprise est satisfaite de sa situation, elle n’a aucune incitation à former sa main d’œuvre. L’entreprise est également fortement incitée à ne pas divulguer d’information, ressource stratégique essentielle des organisations. Ce n’est qu’en renforçant les relations élus-managers (la route est longue et la pente est forte, et dans les deux sens !) d’une part, et en réfléchissant autour de la thématique de la sécurisation des parcours professionnels (ou terminologie approchante), d’autre part, que l’on pourra avancer sur ce dossier.
Les collectivités locales ont un rôle décisif à jouer dans le domaine, car des dispositifs territorialisés innovants existent (genre groupements d’employeurs, mais il y en a d’autres) pour concilier besoins de flexibilité de l’entreprise et besoins de sécurité des salariés. Il me semblerait plutôt pertinent de conditionner les subventions aux entreprises non pas à la « promesse » de ne pas délocaliser, mais plutôt à l’engagement de s’insérer et de favoriser le développement de ce type de dispositifs.