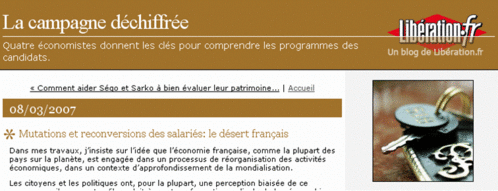L’entreprise Nathan (source : Les Echos, « Une hirondelle ne fait pas le printemps », 18 mars 1996, p. 50)
Nathan avait décidé de délocaliser la production de jeux à Hong-Kong. Conséquence : suppression de 22 emplois en Bretagne. En 1993, Nathan fait demi-tour, en relocalisant la production dans le Finistère, à Loguivy. Deux raisons à cela.
Un premier élément d’explication tient au comportement opportuniste du partenaire chinois : celui-ci a plagié les produits Nathan pour les redistribuer en France, évidemment à moindre prix. Une belle illustration de la théorie de l’Agence, qui montre la difficulté de contrôler à distance les comportements des partenaires (ce n’est pas toujours vrai : l’entreprise Willy Betz (ces camions jaunes que vous croisez sûrement si vous empruntez les autoroutes françaises) contrôle très bien le comportement de ses chauffeurs via la mise en place d’un système informatisé de suivi de sa flotte…).
Un deuxième élément d’explication relève des coûts de la coordination à distance : en 1996, Joëlle Poirier, alors directrice générale des jeux Nathan, expliquait que la délocalisation « imposait de passer commande un an à l’avance » et les délais de transport « atteignaient un mois ». Bref, difficile de suivre efficacement l’évolution de la demande… Problème de réactivité, donc.
L’entreprise Jeanneau-Benneteau (source : Les Echos, « Une hirondelle ne fait pas le printemps », 18 mars 1996, p. 50)
Histoire assez similaire : l’entreprise Jeanneau, fabricant de bateaux de plaisance, décide de délocaliser 30% de sa production en Pologne, en raison d’un coût de la main d’œuvre huit fois inférieur. Demi-tour, en raison « de gros problèmes de qualité et d’image ». Bruno Cathelinais, directeur général de Bénéteau, déclarait en 1996 « nous avons déjà ramené la fabrication de trois produits en France, et le reste suivra dans les prochaines années ».
Les entreprises Mobidel et Texim (Source : Libération, « un tee-shirt c’est sept minutes en Inde et deux minutes en Europe », 20 février 1997, p. 27)
80% de la production de ces deux entreprises textiles avaient été délocalisées en Inde, afin de bénéficier d’un coût du travail favorable. Francis Leclaire, PDG des deux entreprises, a décidé de relocaliser la fabrication en France, en comptant sur la réorganisation du processus et sur son automatisation. En Asie, dit-il, « l’outil de travail n’est pas toujours des plus performants. La productivité des ouvrières n’est pas non plus la même. Un certain nombre de tâches se font par exemple à la main et la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. D’où un taux de perte relativement élevé ». Il cite également le problème des délais de transport, des taxes d’importation et des quotas européens.
L’entreprise Atol (source : Les Echos, « Atol rapatrie de Chine dans le Jura la fabrication de ses lunettes Ushuaïa », 28 octobre 2005, p. 20 et Valeurs Actuelles, « Atol voit plus près » n° 3659, 12 Janvier 2007)
L’entreprise Oxibis-Exalto est un lunettier installé à Morbier (Jura). Atol distribuait déjà les modèles des marques Oxibis (milieu de gamme) et Exalto (haut de gamme). Les lunettes Ushuaïa, également distribuées par Atol, étaient jusqu’alors fabriquées en Chine. Atol a décidé de relocaliser en partie la fabrication en France, en se tournant vers Oxibis-Exalto, afin de gagner en qualité, en créativité et en réactivité : « Nous misons aujourd’hui tout sur le made in France qui nous permet d’avoir une qualité et un design irréprochables ainsi que des couleurs que l’on ne trouvait pas en Chine » (Philippe Peyrard, directeur général délégué in Valeurs Actuelles). Plus loin il ajoute « Nous avons aussi choisi le site de Beaune pour son emplacement géographique qui nous permettra d’offrir de nouveaux services : nos magasins pourront ainsi passer commande jusqu’à 20 heures à l’unité bourguignonne en étant assurés que leurs clients auront leurs lunettes dès le lendemain matin, quelle que soit leur localisation en France ». La fabrication en Chine impliquait de prévoir des délais de livraison de trois à quatre mois…
L’entreprise Aquaprod (Source : La Croix, « Qu’est-ce qu’une relocalisation », 4 janvier 2007 (bref article) et surtout Pénard T., 2006, support de cours disponible en ligne)
L’entreprise Aquaprod est un fabricant français de cabines de douche, qui emploie 300 personnes. Elle a délocalisé sa production en Roumanie en 2002, puis a décidé de relocaliser près de Nantes en 2005. Motifs invoqués : les délais de livraison trop long, les problèmes de communication avec des équipes lointaines, la hausse des coûts de transport côté roumain. Et les gains attendus, côté français d’un accroissement de la productivité (sous-tendue par l’acquisition d’une machine spécifique) et d’une plus grande réactivité ; ainsi que d’un positionnement sur le haut de gamme.
Des entreprises de Rhône-Alpes (Source : Chanteau J.-P., 2001, L’entreprise nomade : localisation et mobilité des activités productives, L’Harmattan).
Jean-Pierre Chanteau a recensé en 1993 sept cas de relocalisation en Rhône-Alpes et un seul cas en 1997. Les entreprises recensées appartiennent à des secteurs variés (textile, mécanique, pharmacie, jouets, matériel de construction), reviennent de pays différents (Ile Maurice, Maroc, Italie, Japon, …), et relocalisent pour des motifs différents, avec une raison nouvelle par rapport aux cas précédents : confrontées à une baisse d’activité, des entreprises rapatrient de l’activité sur un site sous-employé.
Des entreprises allemandes (Source : Mouhoud El Mouhoub, 1992, Changement technique et division internationale du travail, Economica)
Dans son ouvrage, Mouhoud évoque le cas d’entreprises du textile-habillement et de l’électronique. Grundig, notamment, qui avait délocalisé à Taïwan sa production de TV, hi-fi et autres produits de l’électronique grand public en 1977, a relocalisé en Allemagne en 1983. 850 emplois supprimés sur Taïwan. Idem pour Siemens, déménagement à Mauritius en 1977, raptriement en Allemagne en 1981, 1000 emplois supprimés.
Une des raisons essentielles de ces rapatriements est l’évolution technologique : les compétences présentes dans les pays ayant bénéficié dans un premier temps de la délocalisation ne sont pas suffisantes pour fabriquer efficacement les biens dont les caractéristiques ont évolué en raison des innovations introduites par les entreprises.