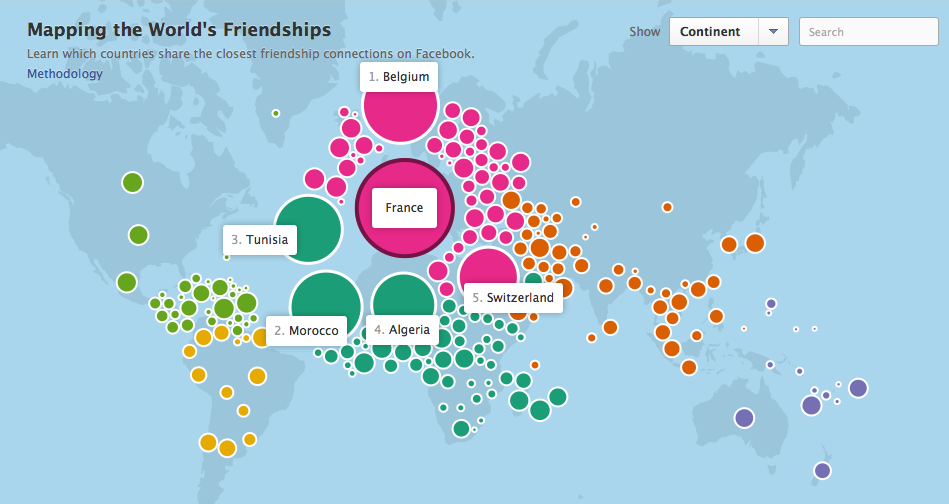Voici les résultats de la petite enquête lancée il y a quelques temps, afin de dire des choses sur les réseaux socionumériques, en l’occurrence sur Facebook. Les trois questions clés de l’enquête étaient les suivantes, elles ont permis de définir trois variables :
- Combien avez-vous d’amis Facebook? variable X
- Parmi vos amis Facebook, combien résident dans la même ville que vous? variable Y
- Parmi vos amis Facebook, combien de personnes n’aviez-vous jamais rencontré physiquement avant d’être amis sur Facebook? variable Z
S’agissant de la deuxième question, j’aurai préféré demander aux enquêtés le nombre de personnes résidant dans la même région plutôt que la même ville, mais c’est plus compliqué à obtenir sur Facebook.
A partir des valeurs de ces variables, j’ai défini deux indicateurs :
- le degré de proximité relationnelle, égal à (X-Z)/X. En clair, il s’agit de la proportion d’amis Facebook que vous aviez rencontré physiquement avec d’être amis sur Facebook.
- le degré de proximité géographique, égal à Y/X.
217 personnes ont répondu (un peu plus, mais il y avait quelques réponses incomplètes que j’ai supprimé). L’échantillon n’a rien de représentatif, ce n’était pas l’objectif. Voici les caractéristiques de base des personnes interrogées, pour les variables quantitatives, d’abord :
| variable |
modalité |
% |
| genre |
homme |
59% |
|
femme |
41% |
| Ville |
Poitiers |
34% |
|
Paris |
12% |
|
Autres |
55% |
| niveau d’étude |
<bac +3 |
28% |
|
bac+4 ou 5 |
49% |
|
>bac+5 |
24% |
| utilisation Facebook |
tous les jours |
80% |
|
moins souvent |
20% |
Puis pour les variables qualitatives :
| variable |
moyenne |
| age moyen |
31,9 |
| nombre d’années résidence |
10,1 |
| nombre d’amis Facebook |
199,7 |
| nb années sur Facebook |
4,1 |
Le degré de proximité relationnelle
Premier résultat essentiel : le degré de proximité relationnelle des personnes enquêtés est particulièrement élevé. Moyenne de 93%, médiane de 99%, premier quartile de 97%, premier décile de 80%. Résultat conforme à mes attentes : Facebook ne permet pas, pour l’essentiel, de se faire de nouveaux amis, il permet d’entretenir des relations avec des amis que l’on s’est fait hors ligne. Résultat conforme à
cette étude américaine.
J’ai estimé un petit modèle économétrique, avec pour variable expliquée le degré de proximité relationnelle et pour variables explicatives les différentes variables disponibles. Voici les résultats (les étoiles indiquent que les variables explicatives sont statistiquement significatives) :
| variable expliquée : degré de proximité relationnelle |
|
|
|
Coefficient |
|
| age |
-0,49 |
*** |
| homme |
-2,64 |
|
| <bac+3 |
modalité de référence |
|
| bac +4 ou 5 |
2,25 |
|
| >bac+5 |
-0,49 |
|
| autre ville |
modalité de référence |
|
| poitiers |
-1,89 |
|
| paris |
-2,41 |
|
| nb années résidence |
0,07 |
|
| nb amis |
-0,04 |
*** |
| nb années FB |
1,75 |
** |
| FB intensif |
-7,71 |
*** |
| constante |
116,86 |
*** |
|
|
|
| n |
217 |
|
| R2 |
0,26 |
|
Les variables qui ressortent sont l’âge (influence négative sur le degré de proximité relationnelle) et des variables qui caractérisent le mode d’utilisation de Facebook. Le nombre d’amis et l’intensité d’utilisation de Facebook conduisent notamment à une proximité relationnelle plus faible.
Le degré de proximité géographique
En moyenne, la proportion d’amis Facebook qui vivent dans la même ville que les personnes enquêtées est de 19%. Voici la distribution du degré de proximité géographique :
Les résultats sont sensiblement différents selon la ville des enquêtés : la proportion monte à 27% pour les poitevins et à 29% pour les parisiens. Elle est en revanche de 12% pour les résidents des autres villes.
Ces “scores” sont-ils élevés? Plutôt oui, je dirais : si le monde était plat, la proportion d’amis Facebook des habitants d’une ville donnée devrait être égale au poids de cette ville dans la population mondiale, ou dans la population française si on raisonne simplement sur la France. Poitiers ne pèse pas 27% de la population française, Paris ne pèse pas non plus 29% de la population. En raisonnant à l’échelle des régions, les proportions seraient sans doute significativement plus élevées. Dans tous les cas, la géographie reste marquée et les liens locaux sont plutôt importants.
Résultat assez peu surprenant : on entretient sur Facebook des relations développées hors ligne, relations qui se nouent pour une part importante dans la proximité géographique. Résultat conforme là encore avec celui de
l’étude américaine citée plus haut, qui montre que 90% des amis facebook des personnes interrogés (des étudiants de premier cycle universitaire) résidaient dans le même Etat US qu’eux.
Comme plus haut, j’ai testé un petit modèle économétrique, dont voici les résultats :
| variable expliquée : degré de proximité géographique |
|
|
|
Coefficient |
|
| age |
-0,05 |
|
| homme |
2,43 |
|
| <bac+3 |
modalité de référence |
|
| bac +4 ou 5 |
-6,08 |
** |
| >bac+5 |
-6,42 |
* |
| autre ville |
modalité de référence |
|
| poitiers |
13,29 |
*** |
| paris |
18,36 |
*** |
| nb années résidence |
0,52 |
*** |
| nb amis |
0,00 |
|
| nb années FB |
-0,67 |
|
| FB intensif |
3,59 |
|
| constante |
12,77 |
* |
|
|
|
| n |
217 |
|
| R2 |
0,29 |
|
Ce sont cette fois des variables qui caractérisent les personnes qui influent sur le degré de proximité géographique. Sans surprise, le niveau d’études influe négativement sur ce degré : les personnes ayant un niveau d’études supérieur à bac+3 sont plus mobiles géographiquement. Le nombre d’années de résidence influe logiquement positivement sur le degré de proximité géographique.
Conclusion
A ceux qui pensaient que les réseaux socionumériques étaient susceptibles de bouleverser le monde social, cette petite enquête, sur le cas d’un réseau spécifique (Facebook), montre plutôt le contraire. L’intérêt de Facebook est ailleurs : il permet d’entretenir à moindre coût des relations préexistantes. Un prolongement possible consisterait à s’interroger sur la nature de ces relations (liens forts vs. liens faibles, cf. Granovetter), pour voir le rôle éventuel d’un tel réseau dans l’activitation des liens faibles, dont le rôle stratégique est mis en évidence depuis longtemps par la sociologie économique.