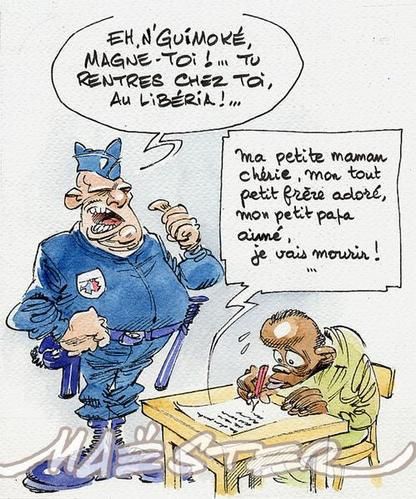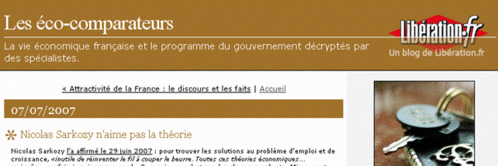Un peu avant que Christine Lagarde annonce le doublement du crédit d’impôt accordé aux nouveaux acquéreurs d’un logement sur la première année (40% des intérêts
d’emprunt contre 20% initialement prévus), l’Insee, qui ne fait rien qu’embêter tout le temps notre gouvernement, publie un document sur
l’endettement domestique des ménages début 2004.
On y apprend par exemple que :
“Du fait de leur capacité de remboursement, les ménages disposant de revenus supérieurs aux revenus médians ont plus facilement accès ou recours aux
emprunts, en particulier pour l’habitat. Parmi les ménages disposant d’un niveau de vie supérieur à 15 000 euros par unité de consommation, six ménages sur dix sont endettés contre
un peu plus de quatre ménages sur dix pour ceux dont le niveau de vie est plus faible. La différence est encore plus marquée pour les emprunts immobiliers puisque les ménages ayant un
niveau de vie supérieur à 15 000 euros ont deux fois plus souvent un emprunt en cours que ceux disposant d’un niveau de vie moins élevé“. Plus loin, on nous dit logiquement que “la disparité des montants d’endettement en fonction du niveau de vie se retrouve au niveau des catégories sociales. Les
professions libérales ont très fréquemment un niveau d’endettement à l’habitat très élevé, dans une moindre mesure les cadres et chefs d’entreprise.” (souligné par moi).
Les gains liés à la déduction étant peu susceptibles d’accroître la capacité d’emprunt des ménages les plus modestes, on peut donc penser que ce sont surtout
les ménages aux revenus élevés qui vont bénéficier du dispositif [1]. Pour partie des personnes qui, de toute façon, avaient prévu l’achat (elles vont éventuellement
l’anticiper), et qui vont donc bénéficier d’un effet d’aubaine.
Et encore, faudra-t-il que l’effet inflation ne soit pas trop fort : si la demande de logement augmente fortement, compte-tenu de l’inertie de l’offre de logements,
les prix de l’immobilier risquent d’augmenter. Pour information, l’effet inflationniste des déductions d’emprunt a pu représenter jusqu’à 30% de la hausse des prix immobiliers aux Etats-Unis
dans les années 70 (James Poterba « Tax Subsidy to Owner-Occupied Housing: An Asset Market Approach », Quaterly Journal of Economics, 1984, cité dans ce billet incontournable des Ecopublix). Ce sont alors essentiellement les agences immobilières et les vendeurs qui seront
gagnants.
On pourrait également s’interroger sur l’intérêt économique de faire de la France un pays de propriétaires, surtout lorsqu’on observe des corrélations robustes entre proportion de propriétaires et taux de chômage : le fait d’être
propriétaire réduit la mobilité spatiale des individus, qui est une des composante (souvent négligée) de leur mobilité dans l’emploi. Point intéressant à souligner, au moment où le gouvernement
met en place la
“commission pour la libération de la croissance française”, qui a notamment pour but d’identifier les moyens “d’améliorer le fonctionnement du marché des biens et des services et de renforcer
le dynamisme et la mobilité de l’emploi“…
[1] Petit exemple, qui s’appuie sur
les simulations parues dans les Echos (avec les
anciens chiffres apparemment, mais ça ne change pas grand chose). Un ménage emprunte 250 000 € sur 15 ans au taux fixe de 4,05% (hors assurance). Montant de la réduction d’impôt sur 5 ans :
7582 €. Emprunter 250 000 € sur 15 ans à 4,05% vous fait rembourser au total 333 988 €. Les 7582 € représentent donc 9% des intérêts versés et 2,3% de la somme totale.