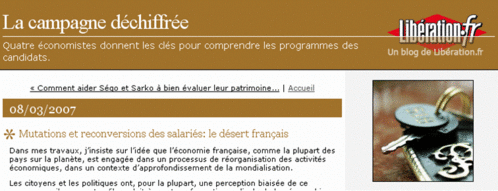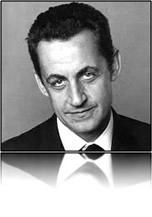
Nicolas Sarkozy l’a affirmé le 29 juin 2007 : pour trouver les solutions au
problème d’emploi et de croissance, “inutile de réinventer le fil à couper le beurre. Toutes ces théories économiques… moi-même, parfois je suis un peu perdu. Ce que je veux c’est que les
choses marchent”. Mieux vaut, selon lui, faire du “benchmarking”, cette méthode qui consiste à regarder ce que font les autres pays.
Je passe sur le caractère populiste de cette déclaration (NS veut “que les choses marchent”, sous-entendu, “les autres politiques veulent que les choses ne marchent
pas”? ; il disqualifie également à l’avance les analyses de tous les intellectuels – très vendeur, tout cela… optimum avait posté un petit billet suite à ces déclarations, un brin énervé
; idem pour les éconoclastes, encore plus laconiques : c’est
vrai qu’on peut difficilement faire pire…) pour me concentrer sur le benchmarking.
Le principe de base du benchmarking est aussi simple que puissant : il consiste à observer les performances d’un échantillon de pays, repérer le pays qui obtient les meilleures performances,
puis identifier les mesures de politique économique qui sous-tendent ces performances, pour enfin les imiter.
En procédant de la sorte, on se débarrasse de toute accusation de biais idéologique : il ne s’agit plus de déduire de la théorie des préconisations en termes de
politique économique, mais d’adopter une posture pragmatique (comme le répètent à l’envie certains leaders de l’UMP), en faisant parler les faits et en s’en remettant aux données pour légitimer
son action.
Démarche séduisante, donc, mais qui pose de sérieux problèmes : il faut imiter le meilleur pays, certes, mais lequel choisir ? Les Etats-Unis ? Le
Royaume-Uni ? L’Allemagne ? Le Danemark ? Le choix n’est pas si réduit que cela… Regardons les données, me dira-t-on. Certes, mais quelles données ? Les taux de
croissance ? Les niveaux de vie ? Les taux de chômage ? La proportion de travailleurs pauvres ? L’évolution du solde commercial ? En fonction de l’indicateur utilisé, les
résultats risquent d’être profondément modifiés… Une combinaison de ces données, pourrait-on proposer. D’accord, mais s’il s’agit de bâtir un indicateur composite, le problème n’est que
déplacé : quels indicateurs élémentaires inclut-on ? Comment peut-on les pondérer ? Là encore, diversité des choix possibles et des résultats obtenus…
Et, en supposant que ces premiers problèmes soient réglés, il convient ensuite d’identifier les politiques explicatives de ces performances, ce qui est sans doute
encore moins simple : dans l’ensemble des mesures prises, lesquelles ont été les plus déterminantes ? Quelle période d’observation faut-il couvrir ? Dans quelle mesure la
reproduction de ces politiques est-elle pertinente dans un autre contexte institutionnel ? À une autre période ? etc.
Est-ce à dire que tout exercice de benchmarking est voué à l’échec ? Pas nécessairement. Disons qu’il existe un mauvais benchmarking, qui, au pire, est
révélateur de l’incompétence de celui qui l’exerce (roulons à gauche puisque les routes britanniques sont les plus
sûres), et au mieux, relève de la manipulation (définissons astucieusement l’échantillon de pays, les indicateurs de performance et les mesures de politique qui nous arrangent afin de dégager
les conclusions auxquelles nous souhaitions parvenir)
[1]
.
Il existe aussi, potentiellement au moins, un bon benchmarking. Dans lequel le choix des indicateurs, des pays et des politiques à observer résulte d’analyses
économiques approfondies. Dans lequel les résultats obtenus sont ensuite analysés à la lumière des théories économiques, pour mieux comprendre les enchaînements à l’œuvre, mieux identifier les
complémentarités entre les politiques menées, et donc mieux évaluer la pertinence de la reproduction de certaines des mesures prises. Un benchmarking qui ne vise pas nécessairement à identifier
le modèle optimal, mais à se comparer pour mieux se comprendre.
Bref, un benchmarking qui ne s’oppose pas aux théories économiques, comme le suppose Nicolas Sarkozy, mais qui les complète, qui en découle et qui les nourrit en
retour.
[1] Je crains que les discours autour de la TVA
sociale relèvent plutôt d’un mauvais benchmarking (par incompétence ou par manipulation ? Peut-être un peu des deux…).