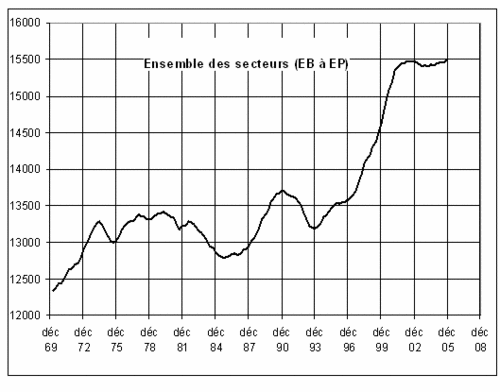La mise en place du CPE a reposé sur un diagnostic totalement erronée, qui s’explique par une mauvaise analyse de ce qu’est un taux de chômage (Cf. l’idée reçue #1).
Compte tenu de la crise en cours, Jacques Chirac et Dominique de Villepin cherchent des issues de secours et parmi leurs propositions, on voit poindre une nouvelle idée qui semble pleine de bon sens : si les jeunes sont au chômage (et l’on connaît le taux !), c’est parce que le système éducatif n’est pas adapté aux besoins du système productif. Dans son allocution télévisée, Jacques Chirac a ainsi appelé de ses voeux une grande réflexion sur les relations entre l’Université et l’Emploi. Extrait : "Je demande au Premier ministre et au Gouvernement d’ouvrir un grand débat national sur les liens entre université et emploi, afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes" (Source ici). Dominique de Villepin s’empresse de relayer l’idée : "ce débat pourrait porter notamment sur l’orientation, l’insertion et la formation professionnelle comme sur la professionnalisation des études, l’apprentissage et le développement de l’alternance" (source ici). Sur le site Débat 2007, on trouve des propos peu éloignés sous la plume d’André Levy-Lang, dans un billet intitulé "Université Française : briser les tabous", lorsqu’il dénonce "des formations universitaires prolongées qui n’assurent pas l’emploi à la sortie".
Une fois encore, on oublie de collecter un peu d’information statistique et d’établir un diagnostic un peu solide pour circonscrire le problème à celui de l’adéquation entre système éducatif et système productif.
Petites statistiques (source : Cereq) pour montrer l’erreur et cibler le bon problème :

Concentrons-nous d’abord sur la génération 1998 : on y voit que le taux de chômage diminue très significativement avec le niveau d’étude, pour atteindre 4% pour les troisièmes cycles et grandes écoles, autrement dit un niveau de chômage quasi-incompressible. Le diplôme continue à protéger, ce sont les non qualifiés qui souffrent du chômage. Et les jeunes sortant de l’Université Française semblent ne pas trop souffrir…
Certains diront que, certes, les personnes qualifiées ont du travail, mais qu’elles sont victimes d’un déclassement, en occupant des emplois ne correspondant pas à leur niveau de formation. Voir par exemple l’article de Dubet et Duru-Bellat dans Le Monde. C’est sans doute vrai pour partie, mais on notera que dans leur article, ces auteurs s’appuient sur des statistiques concernant les bacheliers, d’une part, et les bac+4 , d’autre part, autrement dit des points de sortie non sanctionnés par un diplôme professionnalisant. Les statistiques ci-dessus sur les Bac+2 (DUT, BTS) et les Bac+5 (pour une grande part des masters (ex-dess) professionnalisant) sont bien meilleures. De plus d’autres chiffres montrent que, pour les étudiants allant jusqu’à bac+5, la qualité de l’emploi est au rendez-vous : entre 70 et 80%des bac+5 ont accès aux professions supérieures 5 ans après la fin de leurs études, proportion très proche de celle des étudiants sortant des grandes écoles (graphique ici).
Comparons maintenant les générations 1998 et 2001 : on observe une dégradation des chiffres pour tous les niveaux de formation. Mais soutenir l’idée que le problème observé en 2001 résulte d’une mauvaise adéquation entre le contenu des formations dispensées et les besoins des entreprises est plus que sujet à caution, à moins de considérer que le système éducatif s’est effondré en 3 ans… On priviligiera une autre hypothèse : sur la période, c’est la croissance qui est tombé en panne, et avec elle les créations d’emploi… Deuxième graphique instructif sur les créations d’emplois de 1995 à 2005 (source : DARES) :
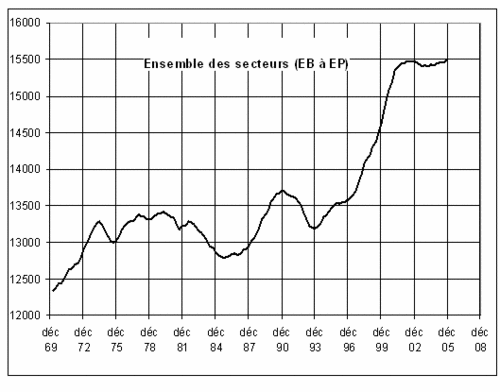
La période 1994-2001 (surtout la sous-période 1996-2001) a été une période de forte création d’emplois, ce qui explique l’insertion plus facile de la génération 1998 et celle, plus difficile, de la génération 2001. Plus qu’un problème d’adéquation, c’est un problème de croissance auquel on fait face. Dans un article récent, Dubois signale ainsi qu’aujourd’hui, 125000 bac+5 sortent du système éducatif, alors que le nombre d’emplois de cadres débutants n’est que de 80000 par an. Et Il ajoute que "la situation risque de se dégrader encore plus si la situation économique reste languissante et si la politique gouvernementale de réduction des déficits publics conduit à faire baisser significativement les effectifs dans la fonction publique, en ne remplaçant pas systématiquement les départs en retraite." Certains rétorqueront que l’on forme trop de cadres. Ce à quoi on objectera qu’en France, parmi les 25-64 ans, 36% n’ont pas dépassé la troisième, contre 18% au Danemark, 17% en Suède, en Allemagne et au Canada et 13% aux Etats-Unis. Et que le taux d’emploi des bac ou plus est de 82%, contre 58% pour ceux ayant arrété le lycée. Moins former n’est sans doute pas la bonne solution…
Ceci ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème à l’Université, mais plutôt que le problème est ailleurs.
Il y a d’abord un problème évident de financement alloué, comme je l’ai déjà montré avec ce graphique :

Graphique éloquent qui montre que l’on prend aux pauvres pour donner aux riches, ce qui peut laisser réveur en terme de justice sociale : on concentre les moyens financiers sur les meilleurs étudiants, ceux qui disposent déjà du plus de capital humain et de capital social. Les étudiants moins bien "dotés" se trouvent exclus des filières sélectives, notamment des filières courtes qui leur correspondent le mieux, ils s’orientent par défaut à l’Université et, pour une grande partie, échouent. Il conviendrait donc, pour réduire l’échec à l’Université :
i) de revoir l’allocation du financement de telle sorte que ceux que l’on donne plus de moyens à ceux qui en ont le plus besoin, et non pas plus de moyens à ceux qui en ont le moins besoin.
ii) de revoir les modalités de sélection en BTS et DUT, afin que ces filières s’ouvrent aux étudiants qui n’ont pas les capacités de s’engager dans des études longues. Pour l’instant, les bons étudiants vont en BTS et DUT, mais bien sûr ils ne s’y arrêtent pas : ils poursuivent ensuite en bac+5 (pour plus de 60% de mémoire)…
L’autre problème évident relève de l’orientation des lycéens dans les différentes filières : les effectifs sont pléthoriques en psychologie ou sport par exemple, alors que l’on sait que les débouchés sont peu nombreux ; tandis que les effectifs sont réduits et chutent en sciences ou en économie, où, là, les débouchés existent. Cet autre aspect du problème n’est pas des plus simples à résoudre, puisqu’on n’imagine mal obliger les étudiants à s’orienter vers les filières en fonction des débouchés (certains en rêvent sûrement…). Il conviendrait plutôt de les y inciter. En commencant, sans doute, par leur dire que le monde de l’entreprise ne ressemble pas à la caricature qu’en proposent Laurence Parisot et Serge Dassault quand ils annoncent une inévitable précarité, et en évitant d’institutionnaliser cette précarité en mettant en place un contrat non adapté au problème des personnes peu qualifiées…
Ajoutons, pour répondre à Dominique de Villepin, que la professionnalisation des études est en cours depuis bien longtemps (je m’interroge sur sa connaissance du fonctionnement de l’Université Française…) : les masters professionnels sont conçus en lien étroit avec les professionnels du domaine, il est obligatoire que 50% des intervenants soient des professionnels, un stage de fin d’étude de 3 mois minimum est imposé, etc. Avant cela, de nombreux jeunes partent en stage (via par exemple les Unités d’Expérience Professionnelle : ces stages remplacent, à la Faculté de Sciences Economiques de Poitiers –ce n’est qu’un exemple!– un semestre de licence ou un semestre de master 1) et/ou effectuent des séjours à l’étranger (système Erasmus). Des licences professionnelles se sont également développées un peu partout en France. Au total, à l’Université de Poitiers, en 1995, 2500 étudiants sur 30000 partaient en stage chaque année. Ils sont aujourd’hui 6000 pour 24000 étudiants. Si bien que l’on estime que 80% des bac+4 et 5 ont déjà au moins une expérience professionnelle (merci à la Présidence de l’Université, et plus particulièrement à Stéphane, pour ces infos!).
Signalons également que cette collaboration étroite entre système éducatif et système productif s’observe également à des niveaux plus bas de formation (merci à Virginie pour les liens!) : tout un ensemble d’accords, de conventions générales et de conventions cadres sont signées entre le Ministère et les branches professionnelles (voir sur ce site) et chaque année, de nombreux diplômes sont rénovés pour tenir compte de l’évolution des besoins (voir ici des exemples).
Il y a bien sûr des choses à faire pour que plus de jeunes s’orientent vers ces filières professionnalisantes. Il convient bien sûr de toujours s’interroger sur les moyens d’améliorer les formations dispensées à l’Université. Mais le coeur du problème, aujourd’hui, n’est pas là.
Le problème tient plutôt :
i) du côté de l’Université, à un sous-investissement dans la recherche et dans l’enseignement supérieur, qui sont pourtant deux moteurs essentiels de l’innovation et, par voie de conséquence, de la croissance, sans laquelle la création d’emploi ne pourra pas repartir,
ii) du côté des personnes non qualifiées, au fait que 160 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans qualification, ce qui rend leur employabilité quasiment impossible, et ce qui les exclue du marché du travail, même quand la croissance est là.
Bien sûr, certains diront que la résolution de ces problèmes suppose plus d’investissement de l’Etat, or on ne peut pas : la dette publique française est trop importante !!! Mais là, on s’attaque à une autre idée reçue, qui méritera bien un autre article…