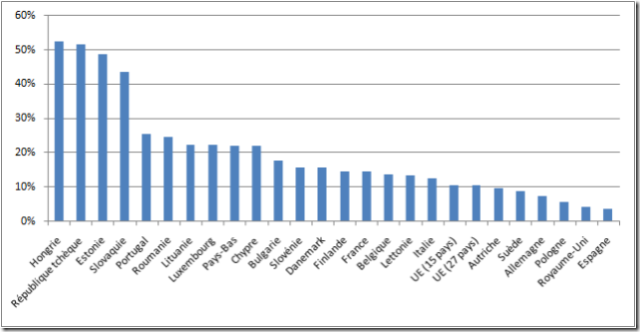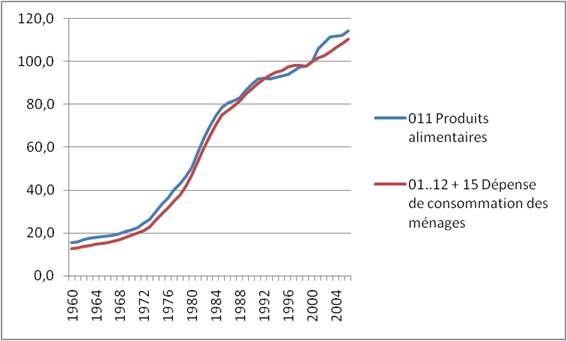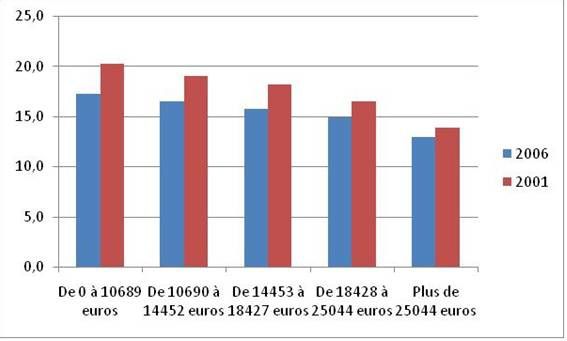billet de Philippe Askenazy dans Le Monde, titré “pricing out”. Ou plutôt, curieuse application à la grande distribution. Je m’explique, en reprenant d’abord l’argumentation d’Askenazy.
Qu’est-ce que le pricing out? “Un acteur menace votre position sur un marché grâce à des coûts plus faibles ou à un concept plus innovant. La solution : lui
faire augmenter ses prix, par exemple en accroissant ses coûts, et ainsi réduire sa capacité de nuisance sur vos propres marges. Votre concurrent est “pricé-out”. L’usage de cet outil est en
plein essor en France, en particulier dans le commerce.”
Appliqué à l’affaire Amazon/distributeurs classiques de livres, ça marche plutôt bien. Là où je tique, c’est quand Askenazy étend l’analyse à
la grande distribution : “Depuis le lancement en 2005, par la Commission européenne, de la procédure contre la loi Raffarin, d’inventifs dirigeants de
grandes enseignes françaises ont mûri un plan B : le pricing out de ces dangereux concurrents en augmentant le coût du travail. Pour cela, il suffit d’améliorer la convention collective
de branche, qui, une fois étendue par le gouvernement, s’applique aux discounters.”
En clair, les responsables de la grande distribution verraient d’un bon oeil la grogne sociale, car celle ci conduirait à un accroissement du
coût du travail, ce qui dissuaderait la menace de nouveaux entrants.
Intuitivement, ça me semble un peu tiré par les cheveux. En réfléchissant un peu, ça me semble aussi tiré par les cheveux.
Supposons que pour les distributeurs en place le coût du travail par unité de chiffre d’affaires soit wL/CA avec w le salaire unitaire, L le nombre de personnes employées, et CA le chiffre
d’affaires. Dans le hard discount, on écrira w*L*/CA*.
Ce que semble dire Askenazy, c’est que dans le hard discount, le coût du travail pèse moins car les salaires sont plus faibles (“
lepoint commun entre ces nouveaux distributeurs est une stratégie “low cost”, qui assure la viabilité de leurs modèles économiques. En particulier, les salaires y sont plus faibles que dans les
enseignes classiques”). Autrement dit, si le coût du travail pèse moins, c’est parce que w*<w. En obligeant à un alignement de w* sur w, on comprend que les grands distributeurs réduisent la
menace d’entrée.
Mais supposons maintenant que le coût du travail pèse moins non pas en raison de salaires inférieurs, mais parce que l’intensité en travail dans le hard discount est plus faible. Autrement dit,
non pas parce que w*<w, mais parce que L*/CA*<L/CA. Ca ne me semble pas coomplètement stupide : on rend moins de services (moins de caisse, moins de conseil dans les rayons, moins de
personnes pour mettre en place de “jolis” rayons, etc…), on utilise donc moins de main d’oeuvre. A la limite, on pourrait supposer w=w* et w*L*/CA*<wL/CA.
Sous cette hypothèse (w et w* peu différents), un accroissement généralisé des salaires ne réduirait pas la menace d’entrée, elle l’augmenterait, car l’impact sur les coûts totaux unitaires dans
la grande distribution serait plus fort que dans le hard discount. Les entreprises de ce dernier groupe devraient donc s’attendre à un gain de part de marché plus important, suite à
l’augmentation des salaires…
Bon, tout l’enjeu est de savoir quelle est l’hypothèse la plus crédible : coût unitaire du travail plus faible dans le hard discount, ou intensité en main d’oeuvre plus faible? On a peut-être un
peu des deux, mais je parie plutôt sur la deuxième hypothèse. Si quelqu’un a des chiffres en stock, je suis preneur.