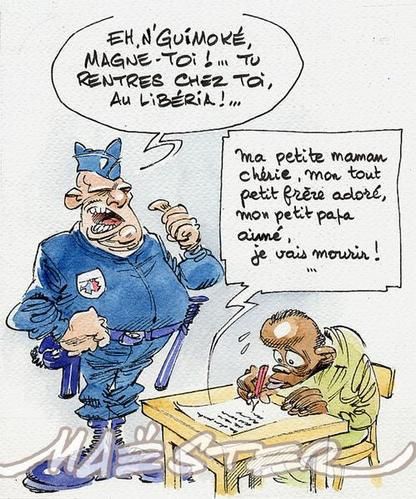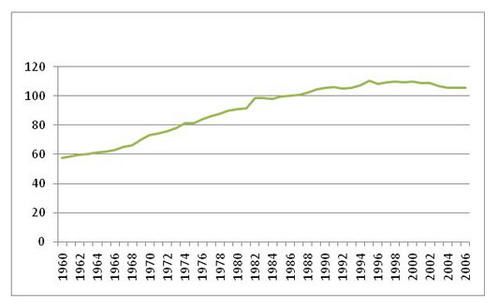Les sociétés de capitaux se caractérisent par une dissociation croissante entre le collectif des actionnaires, propriétaires du capital social de l’entreprise, et le
collectif des dirigeants, qui gèrent l’entreprise au quotidien.
On sait depuis Berle et Means (1932) que cette dissociation pose
problème : i) actionnaires et dirigeants ont des objectifs divergents (les actionnaires ont un objectif de profit pendant que les dirigeants ont, prioritairement, un objectif de haut
revenu), ii) les dirigeants, qui sont quotidiennement dans l’entreprise, bénéficient d’asymétrie d’information ; iii) ils peuvent donc prendre les décisions leur permettant d’atteindre leurs
propres objectifs plutôt que ceux des actionnaires.
Pour réduire ce problème, certains préconisent l’instauration de stock-options. Il s’agit d’attribuer aux dirigeants une option sur un certain nombre de titres
de l’entreprise, option que l’on peut exercer ou non après une date donnée. Si le cours de l’action de l’entreprise augmente, le dirigeant a intérêt à exercer son option, sinon, il ne l’exerce
pas. Cette solution semble pertinente : en octroyant des stock-options aux dirigeants, on réconcilie leur objectif de haut revenu à l’objectif de profit des actionnaires, la divergence
d’intérêt initiale disparaît.
Ce système de stock options pose cependant de sérieux problèmes (voir par exemple ici pour une recension des problèmes, p. 17 et 18). Il s’apparente notamment à un jeu asymétrique potentiellement dévastateur « pile je gagne, face je ne
perds rien ». En effet, si le cours de l’action n’augmente pas, le détenteur de stock options n’exerce pas son option, il ne perd rien ; si le cours de l’action augmente, il exerce
l’option et peut gagner beaucoup. Ce petit jeu incite donc surtout à prendre beaucoup de risques, parfois des risques inconsidérés.
A la
vue des déboires EADS, il semble qu’il existe une autre limite de taille à ce système, que je n’avais pas encore repéré dans les papiers sur la question : la diffusion croissante de
stock options auprès de ceux qui bénéficient nécessairement d’asymétrie d’information risque d’augmenter significativement la probabilité de délits d’initié, à plus ou moins grande échelle (je ne
connais pas d’étude sur le sujet, si quelqu’un a des références en stock…).
Dans un éditorial pour les Echos du 4 octobre 2007, Patrick Lamm pose le
problème en ces termes : « comment veiller à ce que les informations données par les sociétés ne soient pas utilisées par certains tant que l’ensemble des intéressés n’ont pas été
prévenus ? ». Et il propose : « des déontologues devraient pouvoir s’assurer, au sein des conseils d’administration, de l’égalité de traitement non seulement entre les actionnaires
mais également entre toutes les parties prenantes de l’entreprise. Un devoir de transparence indispensable si l’on veut moraliser la vie des affaires. »
Je doute un peu, car le problème n’est pas fondamentalement un problème de moralité : demander plus de transparence permettrait sans doute de limiter les
délits d’initiés, mais cela priverait dans le même temps l’entreprise d’une de ses ressources les plus stratégiques, l’information dont elle dispose et dont ne dispose pas encore ses concurrents.
Problème difficile à résoudre me semble-t-il…