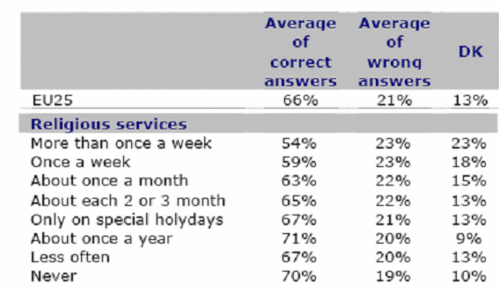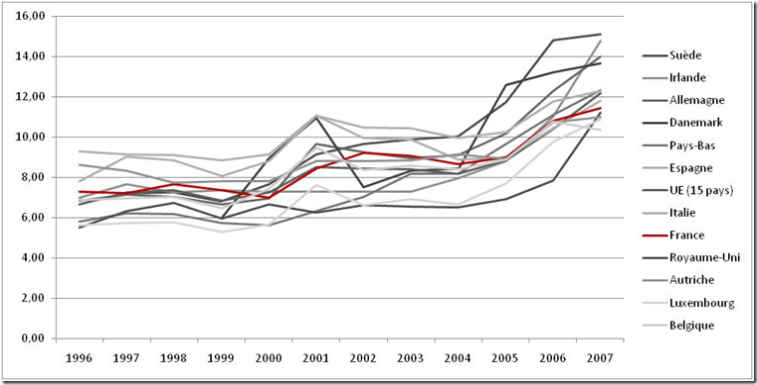GDF demande 6,1% d’augmentation du prix du gaz, le
gouvernement en accorde 4%. Interprétations possibles.
H1 : GDF a bien fait ses calculs : pour que l’entreprise couvre ses dépenses et procède aux investissements nécessaires au maintien de sa position concurrentielle, une
hausse de prix de 6% s’impose. En n’accordant que 4%, le gouvernement préserve le pouvoir d’achat à court terme des consommateurs de gaz, mais nuit à moyen terme à la santé de l’entreprise. GDF
est mal barrée (voir pour quelques éléments cet article du Monde).
H2 : Le gouvernement a bien fait ses calculs, les responsables de GDF, en demandant 6% de hausse alors que 4% suffisent, sont donc opportunistes, ils ne pensent qu’à
récupérer encore plus de bénéfices, à assurer leurs primes, et blablabla, et blablabla. Une entreprise gérée par des
dirigeants opportunistes, ça craint. GDF est donc mal barrée.
H3 : GDF a bien fait ses calculs, elle sait que 4% suffisent. Mais GDF sait qu’en demandant 4%, elle obtiendra moins de 4%. En demandant 6%, elle espère récupérer les
4% nécessaires. Ce qu’elle obtient effectivement, GDF est gérée par des petits malins, tout va bien.
H4 : GDF et le gouvernement ont interagi avant annonce de la demande de hausse par GDF et annonce de la décision du gouvernement.
GDF veut 4% d’augmentation, le gouvernement veut montrer son attachement à la défense du pouvoir d’achat des consommateurs. Le gouvernement demande donc à GDF de demander 6% de hausse, qu’il
puisse annoncer 4% en retour, histoire de démontrer cet attachement. GDF et le gouvernement sont gérés par des petits malins, tout va bien.
Personnellement, j’hésite entre H1 et H4, avec une préférence pour H1. N’hésitez pas à cocher l’hypothèse de votre choix, à argumenter pour faire pencher en faveur d’une hypothèse, voire à
ajouter d’autres hyptohèses d’interprétation.
En tout cas, qu’est-ce qu’on rigole avec le contrôle des prix!