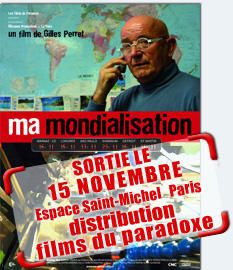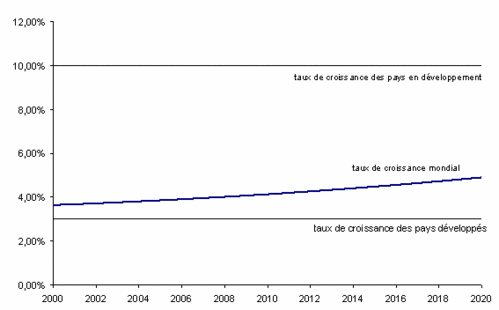La première fois où j’ai fait passer des étudiants à l’oral, je leur faisais tirer au hasard un sujet. Assez régulièrement, des étudiants me disaient : "Oh, mince, le sujet porte juste sur le chapitre que je n’ai pas révisé!" (j’édulcore le vocabulaire…). Si bien que, depuis, je leur fais tirer deux sujets, à charge pour eux de traiter le sujet qu’ils préfèrent.
Sans surprise, j’ai eu un étudiant qui n’a tiré qu’un sujet malgré la consigne rappelée à chacun en entrant dans la salle. J’ai eu également un étudiant qui a traité les deux sujets tirés. Un autre encore est entré dans la salle, m’a demandé s’il pouvait tirer les sujets, sortir de la salle et re-rentrer à l’heure de son passage…
J’avais préparé une cinquantaine de sujets. Certains, très rares, entrent, prennent rapidement deux papiers et vont s’installer. Peut-être 4 ou 5 sur la centaine interrogés. La plupart des étudiants passent un temps infiniment long à regarder les petits bouts de papier, hésitent entre ceux situés à gauche et ceux situés à droite ; se demandent s’il faut prendre un sujet situé au dessus du tas et un autre au-dessous, un sujet écrit sur un petit bout de papier et un autre sur un gros bout de papier, etc… Superstitieux, les étudiants…
Parmi les sujets proposés, un mérite quelques développements :
Premier constat : un seul étudiant m’a demandé s’il fallait traiter le sujet du point de vue de la France ou bien d’un autre point de vue (européen par exemple). Ce qui démontre une tendance évidente à adopter un point de vue franco-français dans le traitement des sujets.
Deuxième constat : a minima, les étudiants évoquent les avantages d’une telle politique, en raison du coût du travail trop élevé, des charges fiscales et sociales qui pèsent sur les entreprises, etc. Au mieux, ils m’ont expliqué les limites d’une telle approche, les choix de localisation ne dépendant que partiellement des différentiels de fiscalité.
De ce fait, je leur ai posé systématiquement la question suivante :
Et là, je peux vous dire qu’à chaque fois, ca a été un grand moment de solitude pour les étudiants… Un peu comme ces personnages de Tex Avery qui prennent conscience qu’ils sont au dessus du vide et qu’ils vont faire une chute de quelques centaines de mètres, sans rien à quoi se raccrocher…

D’un autre côté, je ne leur en veux pas vraiment. Ils ont dû trop écouter notre ministre de l’économie:
– dire qu’on va augmenter les impôts des français, ça revient aussi à dire qu’on veut casser la consommation et la croissance. Alors autant dire qu’on veut des chômeurs en plus!
On ne peut qu’admirer la profondeur d’analyse.
Breton se Lambertise en quelque sorte. D’un autre côté, il a des circonstances atténuantes : il n’est pas économiste, ni étudiant en économie. Juste Ministre de l’Economie.