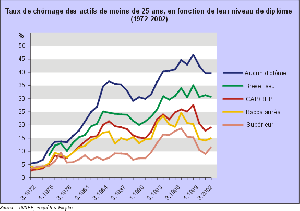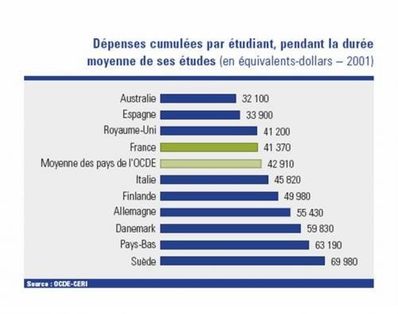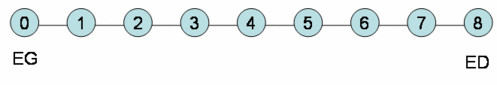Pour comprendre une partie des discours des politiques, rien de mieux que le modèle de Hotelling, base de la théorie de l’électeur médian. Explications.
L’échiquier politique va de l’extrême gauche à l’extrême droite. Schématisons-le comme suit :
Considérons ensuite que deux candidats luttent pour accéder au pouvoir. Le gagnant est celui qui récolte le maximum de suffrages. Chacun des deux candidats va se situer quelque part sur l’échiquier politique. Sa localisation en 0 signifie qu’il développe un programme d’extrême gauche. Sa localisation en 2 un programme disons PS, en 6 un programme UMP, en 8 un programme FN, etc…
La localisation choisie par le candidat ne dépend pas de ses valeurs ou préférences intrinsèques : son objectif est de développer un programme lui permettant de recueillir le maximum de voix.
1/ Elections à 1 tour
Imaginons que le premier candidat se localise en 2. Le citoyen localisé en 2 est très satisfait, le programme correspond exactement à ses préférences. Le citoyen localisé en 3 est un peu moins satisfait : voter pour le candidat localisé en 2 lui coûte un peu, mais s’il n’y a qu’un candidat, ma foi, il s’y résigne. Pour ceux localisés en 4, 5, 6, 7 et 8, le coût est encore plus important, il croît avec la distance entre le citoyen et la localisation du politique….
Première question : si deux candidats sont opposés, où ont-ils intérêt à se situer ?
Supposons que le premier est en 2. Le deuxième, pour accéder au pouvoir, a intérêt à se localiser en 3 : il gagne les suffrages des citoyens 3 à 8 (6 voix), l’autre candidat n’en récolte que 3 (0, 1 et 2). Voyant cela, le premier candidat a intérêt à se déplacer dans l’espace des programmes, pour se localiser en 4. Il gagne alors (5 voix contre 4). Le deuxième, à son tour, a intérêt à se déplacer en 4 : il ne gagne pas, mais il ne perd pas non plus, les deux candidats se répartissent à égalité le marché.
Première conclusion : on aboutit à un principe de différenciation minimale, en l’occurrence des programmes politiques. L’enjeu pour les candidats est de bien saisir les préférences de l’électeur situé au milieu du segment, électeur que l’on qualifie logiquement d’électeur médian, d’où le nom de la théorie…
2/ Elections à deux tours
Seul problème, l’élection présidentielle, en France, est une élection à deux tours. Si bien que l’enjeu, au premier tour est avant tout… de passer au deuxième tour! Autrement dit, pour les candidats de gauche, de rassembler à gauche et pour les candidats de droite de rassembler à droite.
Si l’on considère, de plus, que la répartition de l’électorat suit grosso modo la courbe suivante…

… il en résulte que le candidat de gauche a intérêt à se situer en 2, celui de droite à se situer en 6, autrement dit, respectivement, aux premier et troisième quartiles. Une fois le premier tour passé, chacun se devra de recentrer son discours, pour se rapprocher des préférences de l’électeur médian.
Sur la base de ce petit modèle, l’erreur de Jospin paraît évidente : en affirmant que son programme n’était pas socialiste, et ce avant le premier tour, il s’est localisé trop tôt en 4, les électeurs de gauche ont préféré s’en remettre aux autres candidats mieux ancrés à gauche.
3/ Et 2007 ?
Qu’en est-il des élections de 2007 ? Le jeu est sans doute encore différent : l’écart entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et les autres candidats est tel qu’il semble qu’ils sont déjà en train de jouer le second tour, l’un et l’autre "lorgnant" de l’autre côté.
Pas totalement, bien sûr : chacun garde en tête l’importance de rassembler son propre camp. De ce fait, Nicolas Sarkozy remet régulièrement sur la table les sujets de l’insécurité et de l’immigration, histoire de ne pas perdre les voix de l’extrême droite. Ségolène Royal, quant à elle, a sans doute un terrain mieux dégagé à sa gauche : la peur du 21 avril lui garantit jusqu’à un certain point que les voix s’éparpilleront peu. Elle donne également régulièrement des gages à la gauche de la gauche (ralliement de Montebourg d’abord, de Chevènement ensuite ; discours sur les délocalisations et sur sa volonté de terroriser les capitalistes, également, etc…).
Tout l’enjeu, pour eux, est donc de rassembler leur camp sans effrayer l’électeur médian… équilibre instable s’il en est! Pour cela, si l’on suit Daniel Cohen (article payant), ils ont le choix entre deux formes de radicalisation :
* le radicalisme stratégique, qui consiste à faire surgir des thèmes de campagne qui rassemblent son propre camp et divisent le camp adverse.
* le radicalisme partisan, qui consiste en quelque sorte à ignorer le camp adverse, en comptant sur sa défaite en raison de l’usure du pouvoir.
Le radicalisme stratégique, c’est sans conteste ce que tentent Sarkozy et l’UMP avec l’insécurité, voire avec les 35 heures. Sans grand succès jusqu’à présent, me semble-t-il. A l’inverse, Ségolène Royal et le PS s’essayent au radicalisme partisan, Nicolas Sarkozy étant au pouvoir depuis quelques années… mais, pour l’instant, sans plus de succès!