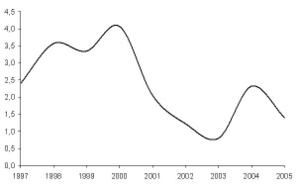Quelques jours après l’affaire Mittal – Arcelor, voilà que le projet de fusion Suez – GDF défraye la chronique. Quelle analyse peut-on en faire?
Premier point : ce projet de fusion s’inscrit dans une dynamique plus générale de réorganisation des activités à l’échelle mondiale. Pour rester compétitive, les entreprises se recentrent sur leur coeur de métier et procèdent à des fusions – acquisitions afin d’atteindre une taille critique. Cette taille critique leur permet de bénéficier d’économies d’échelle (l’accroissement de la production d’un même bien permet de baisser le coût unitaire de production) et d’économies de champs (le coût unitaire de fabrication de deux biens diminue quand ces deux biens sont produits par la même entreprise). Sur ce dernier point, s’agissant de la fusion Suez – GDF, on nous dit qu’elle permettra de proposer aux clients des offres duales, combinant gaz et électricité. Si l’on en reste à cet argument, la fusion semble donc souhaitable : elle permettra de réduire les coûts de production et donc de gagner en compétitivité.
Les choses sont cependant un peu plus complexes… D’abord parce qu’il ne faut pas simplement comparer l’efficacité des deux anciennes entités à l’efficacité supposée de la nouvelle entité, il faut aussi s’interroger sur l’efficacité que l’on pourrait attendre d’autres rapprochement d’entreprises : par exemple, un groupe Suez – GDF est-il nécessairement plus efficace qu’un groupe Enel – Suez? La question mérite au moins d’être posée…
Ensuite parce ce ne sont pas seulement les coûts de production qu’il faut comparer, mais aussi ce que certains appellent les coûts d’organisation interne (d’autres diraient des coûts de gouvernance). C’est en tout cas ce qu’invite à faire la théorie des coûts de transaction (pour une présentation, je vous invite à lire le deuxième chapitre de mon ouvrage "L’économie de l’entreprise" ). Dans le cas qui nous intéresse, ces coûts d’organisation interne risquent de ne pas être négligeables, compte tenu, comme l’on dit, des différences dans les cultures de ces deux entreprises; et ils pourraient très bien plus que compenser les avantages en termesde coûts de production. Dans cette perspective, un rapprochement entre EDF et GDF aurait sans doute été moins problématique…
Troisième élément à prendre en compte : le risque que la nouvelle entité occupe une position dominante sur certains territoires… Pour ne prendre qu’un exemple, à l’issue de la fusion, la nouvelle entité contrôlera plus de 96% de la fourniture en gaz de la région flamande et 90% de sa fourniture en électricité. D’ici que des pratiques anti-concurrentielles n’émergent… Ceci explique le positionnement différent de l’Europe dans les deux affaires récentes Mittal – Arcelor, d’un côté, Suez – GDF de l’autre : dans le premier cas, le risque de position dominante est faible, dans le deuxième, il est avérée. L’Europe, en charge de la politique de la concurrence, voit donc plutôt d’un mauvais oeil le projet français.
On objectera que, quand même!, une fusion entre deux groupes français sera toujours préférable à une prise de contrôle d’un fleuron de notre industrie par un groupe étranger (bon, là, ce serait moins grave que pour Arcelor : Enel est italien…). On aurait moins à redouter en termes d’emploi. On retrouve donc le sacro-saint principe de "patriotisme économique". Mais je l’ai déjà dit pour l’affaire Mittal – Arcelor, ce principe est tout à fait contestable : certains groupes bien français n’hésitent pas à délocaliser une partie de leur activité; a contrario, des groupes bien étrangers sont implantés de manière durable sur le territoire national. Bref, la nationalité du groupe n’est pas le critère déterminant. Il faudrait plutôt s’interroger, indépendamment de la nationalité, sur les pratiques effectives des différents acteurs en présence i ) en termes d’organisation et de localisation des activités, ii) en termes de gestion des ressources humaines. L’enquête de l’Expansion parue dans le numéro de mars le montre bien s’agissant de Mittal: les salariés de l’établissement localisée près de Metz considèrent qu’ils ont gagnés en passant du groupe Arcelor au groupe Mittal.
Le gouvernement ne s’est apparemment pas posé toutes ces questions. Il est vrai que a fusion lui permet de privatiser rapidement un groupe public sans que grand monde s’en émeuve, puisque c’est au nom du patriotisme économique…