Suite à mon article sur les pôles de compétitivité mis en ligne sur Débat 2007, un commentaire intéressant de Charles Lambert, Directeur Stratégies et projets d’innovation à la Technopole Vallée du Saint-Maurice. On a toujours à apprendre de nos cousins québecois!
Proximité Bordelaise…
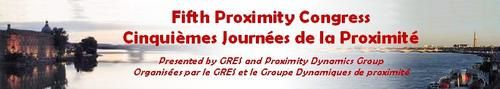
Je prends la direction de Bordeaux du 28/06 au 30/06 pour un colloque sur la Proximité. J’y présente un papier co-écrit avec Michel Grossetti, intitulé "socio-économie de proximité".
Qu’est-ce qu’une bonne entreprise?
J’ai posté sur Débat 2007 un billet intitulé "Qu’est-ce qu’une bonne entreprise?". Je reprends des éléments déjà évoqués dans de précédents billets, j’en développe d’autres.
Je le reprends ci-dessous, n’hésitez pas à réagir ici ou là-bas.
L’entreprise Mittal Steel est une mauvaise entreprise. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une entreprise familiale. C’est pour cette raison que Guy Dollé, président de la direction générale d’Arcelor, ironise : "je vais vous présenter les dirigeants présents, mais mon fils n’est pas là !". C’est aussi ce qu’affirme Elie Cohen quand il s’interroge en ces termes "Si l’OPA de Mittal sur Arcelor venait à réussir, M. Mittal continuerait à contrôler à titre personnel la majorité du nouvel ensemble. Qui peut croire que la gouvernance du nouvel ensemble s’en trouverait améliorée ? Qui ne voit ce qui est perdu avec le passage d’Arcelor, entreprise transparente, sous la surveillance permanente des marchés et des Etats, sous la coupe de Mittal, entreprise familiale ?" (Le Monde, 14 février 2006).
En clair, il existerait de bonnes entreprises, contrôlées par les marchés financiers, qui se conforment aux canons de la gouvernance actionnariale, et de mauvaises entreprises, qui échappent à ce contrôle et se complaisent dans les formes archaïques d’une gouvernance familiale, managériale, coopérative ou mutualiste…
Sauf que…
Côté entreprises familiales, d’abord :
- l’OCDE estime que 70% des entreprises des pays industrialisés sont des entreprises familiales, et qu’elles emploient 50% des salariés. En France, près de la moitié des entreprises du CAC40 sont familiales (L’Oréal, Peugeot, Michelin, …) ;
- le cabinet Oddo-Pinatton a construit un indice pour comparer les performances des entreprises familiales aux entreprises non familiales : les premières dégagent une rentabilité financière (ROE) de 16,5% par an, contre 12,5% par an pour les dernières ;
- tout un ensemble d’études convergent pour dire que ces entreprises investissent plus en formation, mettent en oeuvre un rapport salarial plus stable, pratiquent des politiques de rémunération moins inégalitaires, etc… (voir notamment les études et synthèses de Allouche et Amann, par exemple celle-ci). Bref, on a vu modèle plus désatreux…
Côté surveillance des marchés, ensuite, se pose un problème évident d’efficacité du processus de sélection : l’enjeu, pour un acteur souhaitant acquérir des actions, est de repérer les bonnes entreprises, celles qui ont les bons fondamentaux. Dans un monde d’information parfaite, ceci est possible. Mais quand l’incertitude est radicale, c’est impossible. Il ne s’agit donc plus de repérer les bonnes entreprises (on ne sait pas faire), mais de repérer les entreprises que la majorité des acteurs, à tort ou à raison, considèrent comme bonnes. Comment procéder ? En repérant ce que Schelling (prix Nobel d’économie 2005) appelait des points saillants, ce que l’on appelle aujourd’hui des conventions partagées par les acteurs sur les marchés.
Exemple de convention qui s’est imposée il y a quelque temps : une bonne entreprise est une entreprise de la nouvelle économie. On sait où cela nous a conduit. Autre exemple : une bonne entreprise est une entreprise qui se recentre sur son cœur de métier. Avec là aussi, des dérives qu’André Lévy-Lang a dénoncé le 11 octobre 2004 dans une tribune particulièrement intéressante publiée par le Figaro Entreprises (perche tendue à un autre contributeur de Débat 2007 !).
Ceci ne signifie cependant pas, a contrario, que les bonnes entreprises sont les entreprises familiales. Il semble plutôt qu’il n’existe pas de modèle optimal de gouvernance, mais une diversité de modèles plus ou moins pertinents selon les pays, les secteurs et les périodes. Chaque modèle a ses avantages, chacun a ses limites : la gouvernance managériale pose le problème de l’opportunisme des dirigeants (cf. les débats sur la rémunération des dirigeants, les scandales Enron, Parmalat, WorldCom, etc…), la gouvernance actionnariale pose la question du mimétisme des comportements sur les marchés, la gouvernance familiale conduit à une certaine inertie des comportements (cf. mon dernier ouvrage pour des développements et une hiérarchisation des problèmes).
Or, curieusement, chacun fait comme si la gouvernance actionnariale s’était déjà imposée partout. Tout le monde a en tête une espèce de chronologie selon laquelle nous serions passés d’une gouvernance familiale, au 19ème siècle, à une gouvernance managériale, au tournant du 20ème siècle aux Etats-Unis, un peu plus tard en Europe occidentale, pour, enfin, tous converger vers une gouvernance actionnariale. Certains le déplorent, d’autres s’en félicitent, mais en fait, tous ont tort ! Preuve, parmi (beaucoup) d’autres : en 2000, les entreprises non financières détiennent, en France, 20,8% de l’ensemble des actions des entreprises cotées, 40,1% en Allemagne et 3,5% au Royaume-Uni, signe de l’importance, dans les deux premiers pays, des participations croisées (et donc, derrière, du poids de la gouvernance managériale et/ou familiale). Symétriquement, la part des investisseurs institutionnels (indicateur du poids de la gouvernance actionnariale) est de 19,6% en France, 9,6% en Allemagne et 50,8% au Royaume-Uni (source : Banque de France).
C’est sans doute en prenant acte de cette diversité des modes de gouvernance (et plus généralement du capitalisme) et en tentant de la préserver que l’on renforcera la capacité d’adaptation de la population d’acteurs aux contraintes économiques futures. De l’évolutionnisme bien pensé, en quelque sorte, qui fait de la diversité des populations la clé de l’adaptation.
France – Suisse

Je pars ce matin à Lausanne pour une conférence (ce soir) sur les délocalisations : affiche de présentation, heure et lieu plus précis ici.
Je pars rassuré après le match d’hier : je craignais que l’on me fusille du regard en cas de victoire française (peu probable), ou que l’on ricane sur mon passage en cas de victoire suisse. Un match nul, finalement, c’est très bien!
La photo du mois…
L’alcoolisme fait des dégâts un peu partout en France (jusque et y compris au sein de nos universités, mais chuttt…). Une campagne de prévention est donc en cours, on me charge de diffuser cette information auprès de mes étudiants :
Lors de vos soirées et week-ends étudiants, s’il vous plaît, pas plus d’un verre par personne, ca rendra service à tout le monde (merci Daniel!).

Les secteurs clés de Poitou-Charentes
Aucun pays, aucune région, ne détient un avantage concurrentiel dans l’ensemble des secteurs d’activité : tous les territoires sont inscrits dans une logique de spécialisation productive souvent évolutive. Implication immédiate de ce constat, la nécessité, pour les acteurs du développement économique, de définir les secteurs clés autour desquels doit s’organiser l’action publique.
Comme je l’explique dans Les nouvelles Géographies du Capitalisme, les collectivités territoriales s’en remettent trop souvent, pour définir ces secteurs, à une analyse des secteurs porteurs : tous veulent un pôle spécialisé dans les biotechnologies, le multimédia, les nouveaux matériaux, etc.
Une stratégie alternative consiste à partir des ressources présentes localement et de s’interroger sur les possibilités de valorisation de ces ressources. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de se demander "où l’on va", mais aussi "qui l’on est" et "d’où l’on vient", en repérant les secteurs spécifiques de la région.
Le document lié à ce billet présente une méthode d’identification de ces secteurs. Il a été réalisé en partenariat avec l’Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (IAAT), et se focalise sur les secteurs industriels.
Tout commentaire sera le bienvenu!
Ségolène et la mondialisation
On a beau dire, mais Ségolène, elle ne dit pas que des bêtises… La preuve? Allez donc voir le chapitre 2 de son projet (intitulé "Les désordres de l’emploi et du travail"), section 9 ("Délocalisations : la mondialisation-alibi"), notamment le point 3 ("la mondialisation n’exonère pas la puissance publique de sa responsabilité")…
Je sens que certains lecteurs de mon blog vont faire de la dissonance cognitive…
[PS : rien à voir avec Ségolène, mais en lien avec la mondialisation ; pour les footeux qui ont regardé France-Chine hier soir, j’espère que vous avez fait le lien avec mon billet sur la métaphore du match de foot, et que vous avez vu que quand un chinois marque, ca fait un point pour la France ! Finalement, le foot aussi c’est un jeu à somme positive??!!]
Le clown et l’économiste
Chaque année, les lycéens doivent émettre des voeux d’orientation. L’Université de Poitiers vient de prendre connaissance des voeux pour la rentrée 2006-2007. Résultat des courses intéressant, à interpréter avec précaution, cependant, car des décalages existent entre les voeux et l’orientation effective des lycéens. Je ne reprends ici que quelques résultats :
| Filière | 1er + 2ème voeux | Part dans l’ensemble |
| Sciences économiques | 111 | 2,1% |
| Histoire de l’Art | 194 | 3,6% |
| Arts du spectacle | 210 | 3,9% |
| Sciences du sport | 377 | 7,1% |
| Psychologie | 593 | 11,1% |
| Total Université | 5328 | 100% |
Les sciences économiques sont une filière qui assurent une bonne insertion sur le marché du travail (taux de chômage faible) et une bonne qualité des emplois occupés (part des cadres supérieurs forte). En 2004-2005, 185 voeux pour cette filière, en 2005-2006, 119, pour 2006-2007, on tombe à 111. On voit mal comment une telle filière est tenable. Les filières "sport" et "psychologie" attirent toujours beaucoup (moins que les années précédentes, cependant : on est passé de 721 à 750 puis 593 pour psycho, et de 532 à 506 puis à 377 pour Staps). Les débouchés y sont notoirement plus faibles (même si les diplômés de master des deux filières ont des bons débouchés, ceux-ci ne suffisent pas à assurer une bonne insertion à l’ensemble des étudiants).
Résultat remarquable : il y a plus d’étudiants à vouloir s’inscrire en Arts du spectacle qu’en Sciences Economiques. On peut y voir le signe de l’irrationnalité des lycéens. J’y vois plutôt le signe d’une hyper-rationalité : à entendre le discours de Parisot ou de Dassault sur la flexibilité, les erreurs de nos politiques à propos du taux de chômage, l’interview récente de Luc Ferry sur les problèmes de l’éducation nationale, les propos léinfiants de Guy Dollé et consorts sur les entreprises familiales, etc, etc, etc, je crois qu’une formation Arts du spectacle (avec, bien sûr, option Clown) est une bonne formation, sans doute même la meilleure, pour finir responsable économique ou politique dans notre doux pays.
Le niveau baisse
J’ai évoqué rapidement dans mon dernier billet quelques idées reçues véhiculées par un ancien Ministre de l’Education Nationale. Afin de compléter et mieux cibler les problèmes éventuels, petit exercice statistique.
Supposons quà la date t, 50% des élèves poursuivent leurs études jusqu’au bac ; 50% s’arrêtant à un niveau inférieur. Supposons en outre que le niveau moyen pour ceux allant jusqu’au bac soit de 100, et de 50 pour ceux s’arrêtant plus tôt.
Entre t et t+n, on va supposer, hypothèse qui me semble pertinente, que la proportion de ceux allant jusqu’au bac augmente significativement, disons à 80% (c’est l’objectif annoncé). Les 20% restant arrêtent leurs études avant le bac. On peut supposer que cette massification de l’enseignement conduit à une érosion du niveau moyen observé au bac (les enseignants ont du mal à s’adapter à leur nouveau public, les moyens ne suivent pas, les élèves continuant leurs études ont un niveau initial de capital humain, social, culturel plus faible, etc…), qui passe, disons d’un indice 100 à un indice 90 (cette baisse serait à valider empiriquement). Je supposerais que le niveau de ceux s’arrêtant plus tôt est inchangé (indice 50), même si l’hypothèse d’une augmentation serait sans doute plus pertinente.
Quid de l’évolution du niveau moyen?
niveau bac |
niveau inférieur |
niveau moyen de la population | |||
| effectifs | indice de niveau | effectifs | indice de niveau | ||
| t | 50% | 100 | 50% | 50 | 75 |
| t+n | 80% | 90 | 20% | 50 | 82 |
Sous les hypothèses mentionnées, on observe que le niveau moyen global de la population augmente significativement, en dépit d’une baisse locale du niveau observé pour ceux allant jusqu’au bac. Etant donné que la massification de l’éducation touche à peu près tous les niveaux (collège, lycée, supérieur), l’ensemble des acteurs observent (ou pensent observer) localement une baisse et ne voient pas l’accroissement global du niveau des élèves.
Si l’on considère que ce petit modèle d’évolution est pertinent, le discours sur la baisse du niveau, et surtout les pseudo-explications que l’on s’empresse de développer tombent (les jeunes sont tous nuls, y’a plus que leurs jeux vidéos, feuilletons et sms qui les intéressent / les méthodes pédagogiques des enseignants sont toutes nulles, pas étonnant avec un tel ramassi de fonctionnaires marxistes, etc…). Le problème tiendrait plutôt à la "massification" de l’enseignement secondaire et supérieur, et à la difficulté d’encadrement de ce nombre croissant d’élèves et d’étudiants. Une fois encore, je renvoie à ce petit texte, qui permet de bien poser les bases du problème.
Actualités…
Je vous avais informé de ma participation le 26 mai dernier à un débat sur BFM avec notamment Lionel Fontagné et Jean-Louis Levet. Sujet : comment lutter contre les délocalisations? Le débat peut être écouté sur BFM en cliquant sur le lien "émission du 26/05", entre les flash d’infos et coupures diverses… Nos points de vue furent plutôt convergents.
J’ai été sollicité par les responsables de Débat 2007 pour alimenter leur blog. Vous trouverez en ligne ma première contribution, intitulée "Une nouvelle mode : les pôles de compétitivité". N’hésitez pas à réagir, ici ou là-bas.
Pour d’éventuels visiteurs suisses : je suis invité par la Société d’études économiques et sociales pour une conférence le 14 juin prochain à 18h00 à Lausanne (conférence annoncée ici). Le thème? "Faut-il avoir peur des délocalisations?" !
Plus de précision ici. D’ici là, je m’informe de l’actualité suisse sur le sujet, histoire de faire un peu de comparatif.

