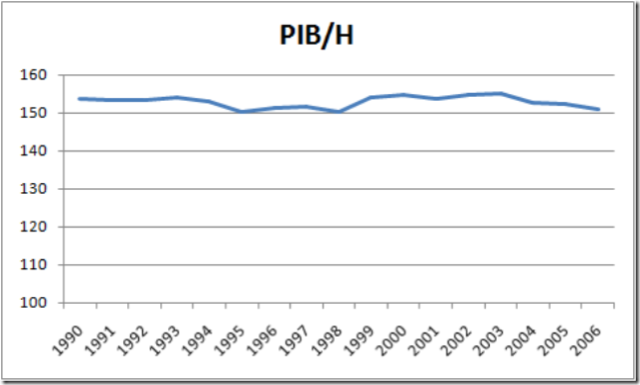“Hypermarchés : le défaut de concurrence peut provoquer jusqu’à 20% de perte de pouvoir d’achat”. C’est le titre d’un article des Echos, qui reprend le commentaire le plus spectaculaire des conclusions d’une étude
de l’UFC Que Choisir, dont le résumé se trouve ici,
les données détaillées là, et d’autres documents
encore là.
En gros,la méthodologie est la suivante : Que Choisir a travaillé sur 634 zones de chalandise, classées en non concurrentielles (1 seul
hypermarché sur la zone), moyennement concurrentielles (2 hypers) et concurrentielles (plus de 2 hypers). Sont ensuite calculés des indices de cherté, chaque indice étant égal à “l’écart entre
les prix moyens de l’enseigne en question et les prix moyen du groupe auquel l’enseigne appartient”. Un indice pour les marques nationales, un indice pour les marques distributeurs et un
indice synthétique, qualifié d’indice de cherté du panier. En se concentrant sur ce dernier, et en croisant indice de cherté et degré de concurrence, la conclusion de l’étude est la
suivante :
En moyenne nationale, un hypermarché situé dans une zone non concurrentielle sera 1,30% plus cher qu’un hypermarché du même groupe
situé dans une zone concurrentielle. Le relevé ayant été effectué lors d’une période de prix bas, septembre 2007, il s’agit d’un écart de prix sous estimé. Par ailleurs, cette moyenne cache
des écarts de prix locaux beaucoup plus importants pouvant aller jusqu’à 20%.
Par exemple, à Marseille, le consommateur paiera au Carrefour du 15ème arrondissement, en position dominante, 5,5% de plus qu’au
Carrefour du 8ème arrondissement. Cela représente pour un ménage moyen un surcoût annuel de l’ordre de 230 euros. Dans le département de la Gironde, un ménage qui fait ses courses au Leclerc
de Talence, qui est dans une zone non concurrentielle, paiera 9,3% plus cher qu’au Leclerc de Port-Ste-Foy-et-Ponchapt, en concurrence avec un Géant Casino. Déménager, permettrait au ménage
de Talence de faire une économie annuelle d’environ 392 euros en moyenne !
Par conséquent, il apparait évident que les distributeurs, notamment Carrefour et Auchan, adaptent leur politique de prix à
l’environnement concurrentiel local. Cette stratégie peut s’avérer très payante dans la mesure où notre étude montre que seules 26,9% des 634 zones de chalandise de notre étude peuvent être
considérées comme potentiellement concurrentielles.
Ce manque flagrant de concurrence sur les zones de chalandise doit être imputé à la réglementation relative aux implantations
commerciales, dite « loi Royer/Raffarin », mise en place pour protéger le petit commerce.
Quelques remarques, dont certaines s’appuient sur des calculs complémentaires (réalisés en partenariat avec mes statisticiens préférés,
Françoise et Christian, que je remercie en passant!).
Première remarque : je suis surpris (façon de parler…) par la façon dont l’UFC commente ses résultats, et par la façon dont les médias
relaient ces commentaires (voir le titre des Echos) : la conclusion essentielle de l’étude, me semble-t-il, est que les écarts de prix entre zones non concurrentielles et zones
concurrentielles, certes existent, mais sont finalement assez peu importants, de l’ordre de 1,30% en moyenne. Bien sûr, si on se concentre sur les cas extrêmes, et on trouvera toujours, dans
toute étude, des cas extrêmes, on peut arriver à dire le contraire, mais ça me semble moyennement honnête intellectuellement… D’autant moins honnête que l’écart de 20% mentionné n’est pas un
écart observé sur une même zone, ni même dans un même département, mais l’écart entre l’indice de cherté le plus fort, et l’indice de cherté le plus faible observé France entière. Ayant calculé
les plus grands écarts observés par département, on obtient un chiffre de 13% au plus, pour les départements 22 et 52, sachant qu’en moyenne l’écart au sein d’un département est de 4% (écart type
de 3%).
Deuxième remarque : même si l’on considère que ce type de démarche est recevable, et si on se focalise sur l’écart extrême de 20%, dire que
cet écart est synonyme de perte de 20% de pouvoir d’achat est fortement critiquable, car on fait abstraction du poids du budget alimentaire dans l’ensemble de la consommation des ménages. Sachant
que ce poids tourne autour de 17%, une variation de 1,3% impacte grosso modo leur pouvoir d’achat de 0,2% ; et si on retient le cas des 20%, on arrive à un impact de 3,4%, non pas de 20%.
Troisième remarque : les auteurs de l’étude ne testent pas le caractère significatif ou non des résultats obtenus. Mais je les rassure toute
de suite, sur la base de leurs chiffres, il s’avère que les écarts obtenus sont effectivement significatifs, notamment lorsqu’on compare les zones non concurrentielles et les zones moyennement
concurrentielles (l’écart de prix étant en moyenne de 0,97%). La conclusion la plus rigoureuse serait donc : “défaut de concurrence locale : un impact faible mais significatif sur le pouvoir
d’achat des ménages”. Moins vendeur, c’est vrai…
Quatrième remarque : au-delà des différences dans les résultats moyens, on observe des différences dans la dispersion des résultats.
Notamment : l’écart-type des résultats pour les zones non concurrentielles est de l’ordre de 2,5%, contre 1,5% pour les deux autres types de zones. Bref, il semblerait qu’en l’absence de
concurrence locale, les pratiques en termes de prix soient plus hétérogènes. Un bémol cependant : cette valeur élevée de l’écart-type résulte pour une bonne part des valeurs observées pour une
dizaine des 209 zones non concurrentielles, comme on peut le voir sur ce graphique, qui reprend la valeur de l’indice (base 100) des 209 zones rangées par ordre croissant :

Si on étudie plus précisément ce groupe de zones non concurrentielles, on observe que 93 des 209 zones, soit 44%, ont un indice de cherté pour
le panier inférieur à la moyenne de l’ensemble des zones. Certes, ça en fait une majorité avec un indice supérieur à la moyenne (56%), mais un bon nombre d’enseignes, pourtant protégées de la
concurrence, ne semblent pas vraiment en profiter. L’étude de l’UFC leur permettra peut-être de s’en rendre compte, ils pourront alors se dépêcher d’augmenter leurs prix… Plus sérieusement, sur
la base de ce constat, on peut se dire que d’autres éléments jouent dans le niveau des prix.
Cinquième remarque : les résultats obtenus pour l’indice de cherté MDD et l’indice de cherté Marques nationales diffèrent, qu’il s’agisse des
moyennes ou des écarts types, même si le classement des zones reste le même (résultats moyens supérieurs et dispersion plus grande pour les zones les moins concurrentielles). De plus, on observe
que les indices de cherté MDD et Marques nationales sont plutôt mal corrélés (R² de 0,22). Un peu puzzling comme résultat : si l’absence de concurrence permet de monter les prix,
pourquoi le faire pour les marques nationales et pas pour les MDD (ou inversement)?
Ce qui m’amène à la sixième et dernière remarque, sans doute la plus importante : en étudiant la relation indice de cherté = f(nombre de
concurrents), l’UFC fait comme si aucune autre variable ne jouait sur le niveau des prix pratiqués dans les zones. Or, il existe d’autres déterminants. Petit exemple parmi d’autres : les
zones du territoire diffèrent par le prix du foncier commercial, ce qui conduit, pour les établissements s’implantant dans les zones, à des différences de coûts fixes. Toute chose égale par
ailleurs, une enseigne s’implantant dans une zone où le foncier commercial est relativement plus coûteux pratiquera des prix relativement plus importants qu’une même enseigne s’implantant dans
une zone où le foncier est moins cher. De manière plus générale, tous les éléments locaux qui conduisent à des écarts de coûts fixes peuvent expliquer une partie des écarts de prix pratiqués. On
peut sans doute même pousser un cran plus loin le raisonnement : sur certains territoires, le niveau des coûts fixes peut constituer une barrière à l’entrée. On verra dès lors moins
d’hypermarchés sur la zone, pratiquant des prix plus élevés qu’ailleurs, mais ce n’est pas le faible nombre de concurrents qui explique le niveau des prix, mais le niveau des coûts
fixes.
Le rôle des coûts fixes ressort en tout cas clairement d’une étude plus rigoureuse réalisée sur le cas anglais, dont une synthèse est
visible ici. Elle montre que l’impact de la régulation des implantations sur les prix proposés aux consommateurs
existe, qu’il est statistiquement significatif, mais qu’il est faible, une bonne partie des différences s’expliquant plutôt par des écarts de coûts fixes. J’ai vaguement l’impression qu’on
obtiendrait les mêmes résultats pour la France…