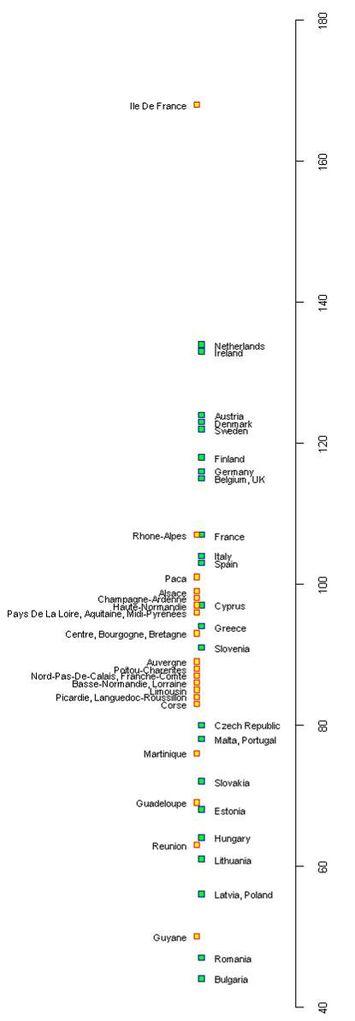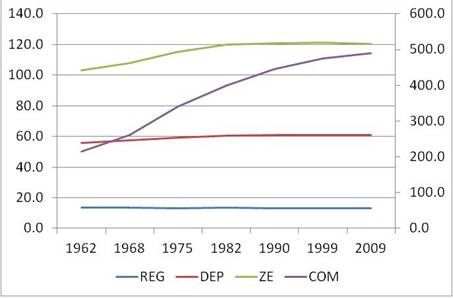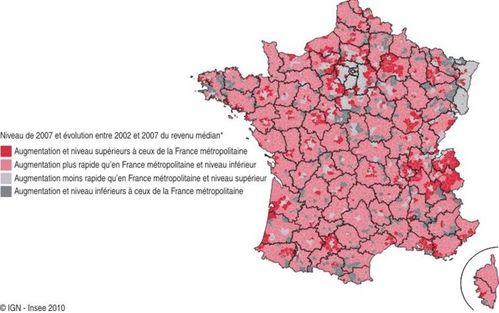Propositions entendues à diverses reprises : « L’effort de recherche est inférieur en France à ce qu’il est au Japon, aux
Etats-Unis ou en Suède, il faut inciter les entreprises à investir plus en R&D ». « Les entreprises de Poitou-Charentes (remplacez par la région de votre choix) n’exportent pas
assez, il faut les inciter à le faire davantage ». « L’Université de Poitiers (remplacez par l’Université de votre choix) forme de nombreux étudiants qui partent ensuite travailler dans
d’autres régions, il faut les informer sur l’activité des entreprises picto-charentaises, leur proposer des stages, pour qu’ils aient envie de rester ». « Le taux d’encadrement dans les
entreprises de Poitou-Charentes (remplacez etc…) est inférieur au taux national, il faut les inciter à embaucher plus de cadres ».
Je pourrais multiplier les exemples. Dans tous les cas, on compare des indicateurs nationaux ou régionaux, on observe une valeur
inférieure à la moyenne pour notre pays/région, on en déduit que les acteurs ne se comportent pas comme ils le devraient, on propose donc de mettre en place des systèmes d’information et/ou
d’incitation pour qu’ils révisent leurs comportements. Ce qui coûte en termes d’argent public. Les rares fois où les politiques incitatives mises en place sont évaluées, on se désespère de la
faiblesse des effets. Quelques années après, on propose donc de mettre en place une nouvelle politique dans le même but. Etc.
Où est l’erreur ? Dans l’absence de prise en compte, dans les écarts à la moyenne observés, de ce qui résulte d’effets de
structures et de ce qui résulte de comportements « individuels ». J’avais déjà parlé de la première
proposition : une intensité technologique (rapport des dépenses de R&D au PIB) plus faible en France que dans d’autres pays. Cette plus faible intensité peut s’expliquer : i)
par des effets de structure, en l’occurrence une spécialisation plus forte dans des secteurs ayant une intensité technologique intrinsèquement plus faible, ii) par des effets comportements
« individuels », autrement dit par une propension plus faible à investir dans la R&D à composition sectorielle identique. L’étude mentionnée montrait que les écarts d’intensité
technologique s’expliquaient pour tous les pays par des effets structurels, sauf deux pays : la Suède, dont l’intensité était plus forte que ce que prédisait sa spécialisation, et
l’Espagne, dans la situation inverse.
Quid des autres questions ? Quelques intuitions : les entreprises de Poitou-Charentes exportent moins que la moyenne car ce
sont pour une part supérieure à la moyenne des PME sous-traitantes. Elles vendent donc à des entreprises qui exportent. Vous pouvez mettre des systèmes d’incitation sur elles, cela n’y changera
rien. Si vous voulez qu’elles exportent plus, il faut faire bouger les structures (les inciter à passer du statut de sous-traitant à celui de donneur d’ordre). Les étudiants poitevins partent,
diplôme en poche, travailler dans d’autres régions ? Ce n’est pas parce qu’ils ne connaissent pas/n’aiment pas les entreprises de notre région, c’est parce que les emplois sont, pour une
large part, ailleurs. Ils vont là où sont les emplois. Vous voulez qu’ils restent ? N’agissez pas sur eux, réfléchissez à la dynamique de création d’emplois en Région. Les entreprises
picto-charentaises ont un taux d’encadrement inférieur à la moyenne ? Effet de structure, encore : il s’agit de PME indépendantes, toujours, qui ont structurellement une propension plus
faible à engager des cadres.
Ce qui me désole, dans cette histoire, c’est que l’on sait depuis longtemps isoler statistiquement ce qui relève des effets de
structure des effets hors structure. Il est donc très facile, pour chaque problème donné, de voir si les effets de structure expliquent l’ensemble du problème, ou une partie seulement. Si les
effets de structure expliquent tout, et qu’on veut faire bouger le taux moyen, il faut faire bouger les structures. Si les effets de structure n’expliquent rien, il faut faire bouger les
comportements individuels. Dans le cas général, on se trouve entre ces deux extrêmes. Autant savoir précisément où avant de prendre des décisions…