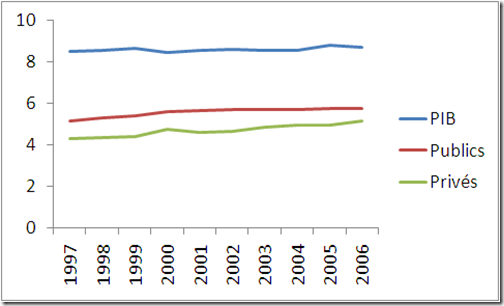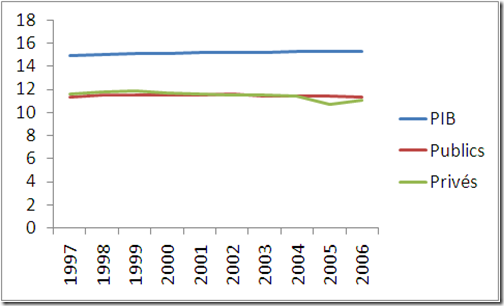Inutile de vous dire que ca bouillone pas mal dans les Universités en ce moment, en raison, notamment, de la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Sur ce point, voir notamment l’analyse de Gizmo, à laquelle je souscris très largement. Rationalité Limitée en avait parlé aussi ici, en concluant sur l’idée que les réformes en cours visaient implictement à renforcer la concentration spatiale de la recherche. il vient de compléter sur ce point dans ce billet, en plaidant à la mode évolutionniste sur l’intérêt d’une décentralisation de la recherche, synonyme de diversité. Billet qui m’a rappelé que j’avais commencé à écrire il y a quelques mois un petit topo sur cette question de la concentration spatiale de la recherche académique. Je me dis que c’est sans doute le bon moment de le diffuser, même si j’aurais voulu idéalement compléter ou développer certains points.Vous verrez en passant qu’il s’agit aussi d’une critique des analyses très à la mode de l’économie géographique, qui certes ont permis d’avancer des propositions intéressantes sur tout un ensemble de points, mais qui ont tendance à être mobilisées à toutes les sauces, parfois de manière non pertinente. Ce qui risque d’être encore plus le cas avec le nobel de Krugman. Critique qui s’appuie implicitement sur des analyses en termes de proximité, ce qui tombe bien puisque je pilote l’organisation des journées éponymes, qui visent notamment à mettre en débat économie géographique et économie de la proximité. Un avant goût en quelque sorte.
Je vous le livre tel quel, commentaires bienvenus.
On entend souvent l’idée selon laquelle le nombre d’Universités en France est trop élevé, qu’il faudrait favoriser leur concentration spatiale, ceci permettant de faire émerger des Campus d’Excellence, et par suite de remonter dans le classement de Shangaï, d’accroître la productivité des Universités, etc. Je résume ici les arguments généralement évoqués, pour en montrer les limites.
1. Les avantages de la concentration spatiale
Les économistes défendant l’idée d’une concentration de la Recherche s’appuie sur les développements de l’économie géographique : la concentration spatiale permettrait de bénéficier de rendements croissants, d’une part, et de réduire les coûts de transaction, d’autre part.
Sur le premier point, la concentration spatiale des acteurs serait synonyme d’accroissement de la taille du marché. Un marché plus grand permet de mutualiser certains besoins, par exemple en machines, ce qui conduit, à la réduction de leur coût unitaire de fabrication, dès lors que ces équipements font supporter aux entreprises des coûts fixes. Un marché plus grand permet également d’accroître la spécialisation des organisations, synonyme là aussi de gains de productivité. On pourrait donc voir apparaître différentes organisations se divisant localement le travail, l’intérêt pour ces organisations de se localiser à proximité étant qu’ainsi, les coûts de transaction sont réduits (coûts de transport, coûts de coordination si les produits supposent des échanges nombreux, …). La concentration spatiale des acteurs est également synonyme d’accroissement de la taille du marché local du travail. Ceci permet d’une part d’améliorer l’appariement entre offre et demande de travail et, d’autre part, de gagner en productivité via la circulation des travailleurs, et donc des compétences, entre les organisations. La concentration spatiale permet enfin de rendre moins coûteuse/moins difficile la circulation des connaissances, notamment quand ces connaissances sont tacites, et qu’elles ne peuvent s’échanger que dans le cadre de rapports de face à face.
Ces différentes sources de gains de productivité ne sont pas intégrées dans les calculs des différentes entités. On dit qu’elles bénéficient d’externalités positives, en l’occurrence locales : elles profitent de gains de productivité sans en payer le coût. Ceci signifie que le marché ne va pas conduire à une concentration spatiale optimale, on observe une déconnexion entre bénéfice privé et bénéfice social, une intervention de l’Etat pour accroître la concentration spatiale des acteurs est donc souhaitable.
Ces avantages de la concentration ont cependant une limite. Si tel n’était pas le cas, on devrait observer la concentration de l’ensemble des acteurs sur un seul territoire. Ces désavantages résultent d’abord de l’existence de déséconomies d’échelle : au-delà d’un certain point, peuvent d’abord se poser des problèmes de congestion. La concentration des acteurs sur un espace de taille finie conduit également à une élévation du prix du foncier, qui peut, au-delà d’un certain point, faire plus que compenser les gains de la concentration. Ces deux premiers éléments sont synonymes d’externalités locales négatives. De la même façon que pour les externalités positives, ces externalités négatives ne sont pas intégrées dans les calculs des acteurs. Ceci peut conduire cette fois à une concentration trop importante des acteurs. Un autre ensemble d’éléments limitant l’intérêt de la concentration des acteurs est liée à la mobilité des personnes et des entreprises : si le coût de la relocalisation des acteurs excède le bénéfice de la concentration, l’intérêt du regroupement disparaît.
2. Application au cas de la recherche
Les chercheurs produisent et diffusent des connaissances nouvelles. Pour cela, ils mobilisent différentes ressources, principalement des équipements (équipement informatique, machines plus ou moins spécifiques) et des connaissances passées, pour partie codifiables (publications et brevets), pour partie tacites (connaissances dont disposent les chercheurs mais qui ne peuvent être inscrites sur un support). Dans quelle mesure la concentration des chercheurs sur un territoire restreint est-elle souhaitable ?
La mutualisation des ressources
Conformément aux mécanismes évoqués plus haut, le fait que des chercheurs mobilisent des équipements communs peut inciter à leur regroupement. Ceci est recevable dans certains domaines scientifiques, qui utilisent des équipements très coûteux, beaucoup moins dans d’autres domaines, par exemple en sciences humaines et sociales, ou de tels équipements ne sont pas nécessaires. Même dans le premier cas, le regroupement spatial des chercheurs n’est pas toujours économiquement pertinent : on peut en effet mettre en place un équipement sur un territoire donné, les chercheurs venant utiliser temporairement l’équipement, en fonction de leur besoin. Autrement dit, une proximité temporaire peut être préférable à une localisation définitive.
Jusqu’à récemment, une autre ressource essentielle favorisait la concentration des chercheurs : les centres de documentation. La dématérialisation des publications affaiblit cependant cet avantage de manière considérable, puisqu’on peut accéder via les TIC à toutes les publications souhaitées. Même sans cela, on peut douter que la taille optimale des centres de documentation réclame un accroissement de leur concentration spatiale.
On peut également évoquer les dépenses en personnel administratif : la concentration de la recherche permettrait peut-être de faire quelques économies en la matière, mais on peut craindre également des déséconomies liées à des coûts supplémentaires d’organisation interne. L’enjeu est sans doute moins d’accroître la taille que d’améliorer l’organisation.
Le marché du travail
Le marché des chercheurs n’est pas un marché local, il s’agit d’un marché d’envergure nationale, voire globale. Cette internationalisation est d’ailleurs considérée comme une source de gains de productivité en matière de recherche, car elle favorise la diffusion des connaissances, qui peuvent être remobilisées dans des contextes locaux spécifiques. L’enjeu n’est donc pas de concentrer les chercheurs en un lieu donné, mais de favoriser leur circulation entre les différentes universités, françaises et étrangères, soit sous la forme d’incitations à la mobilité du travail (possibilités de détachement, de séjours à l’étranger, …), soit sous la forme d’incitations à la mobilité dans le travail (séminaires, colloques, …). C’est donc plutôt à la proximité temporaire/circulation des chercheurs qu’il convient de travailler.
La circulation des connaissances
S’agissant des connaissances codifiables, on l’a dit, elles sont pour l’essentiel inscrites sur un support dématérialisé, elles peuvent donc circuler instantanément dans l’espace, pour un coût faible.
S’agissant des connaissances tacites, l’argument selon lequel une co-localisation des acteurs est nécessaire doit être fortement nuancé : les connaissances tacites sont des connaissances non codifiables que partagent des acteurs ayant une expérience commune. Deux chercheurs travaillant dans le même domaine de spécialisation, ayant accumulé des connaissances tacites très pointues au fur et à mesure de leur activité, peuvent parfaitement échanger à distance et faire circuler, ainsi, des connaissances tacites.
Et lorsque des échanges plus informels sont nécessaires entre des chercheurs aux compétences complémentaires (qui ne partagent pas donc pas les mêmes connaissances tacites), ou entre des chercheurs aux compétences semblables, une proximité temporaire sera souvent préférable : séminaires, colloques, chercheurs invités, etc.
3. Les autres missions des chercheurs
En France, nombre de chercheurs exercent des activités d’enseignement. Ils développent également des recherches appliquées, en collaboration avec des entreprises et/ou des collectivités locales.
La proposition souvent entendue de concentrer la recherche sur un ensemble restreint de campus, et de confier aux autres universités le soin des formations jusqu’au niveau L peut dans ce cadre se révéler contre-productive : on néglige d’une part l’importance des interactions recherche-enseignement pour dispenser des cours de qualité, y compris au niveau L ; on occulte d’autre part les besoins d’interaction entre chercheurs, entreprises et collectivité pour la coproduction des connaissances nouvelles.
il est clair que, parfois, ces interactions peuvent se faire à distance, elles peuvent parfois reposer sur une proximité temporaire, mais dans d’autres cas, une proximité permanente est souhaitable. Le besoin de proximité spatiale est d’ailleurs certainement plus important entre ces acteurs appartenant à des univers très différents, dont certains sont peu mobiles (étudiants en début de parcours, PME, collectivités locales) qu’entre des chercheurs de la même discipline, ce qui plaide plutôt pour un certain degré de dispersion spatiale de la recherche.
Conclusion
Au final, les arguments plaidant pour une concentration spatiale de la recherche me semblent plutôt légers. Ils sont logiquement portés par de grands pôles (la PSE et la TSE en économie), et correspondent tellement bien à l’idée toujours très prisée en France selon laquelle le “big is beautiful”, qu’ils risquent de s’imposer très rapidement. Rectificatif : en fait, ils se sont déjà imposés.


![clip_image002[6]](http://idata.over-blog.com/0/24/69/70/API/2009-09/clip_image002-6-_thumb.gif)