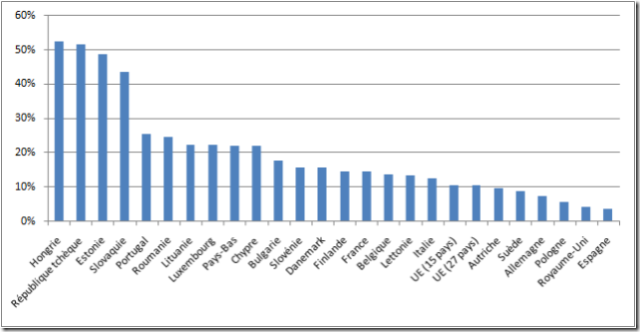Pour étudier l’évolution des inégalités de revenu entre riches et pauvres, on rapporte généralement le revenu moyen des 10% les plus
riches au revenu moyen des 10% les plus pauvres. Notons R1 le premier et R2 le deuxième. On peut mesurer le revenu nominal (non prise en compte de l’évolution des prix) ou le revenu réel (prise
en compte de l’évolution des prix en divisant le revenu nominal par l’indice des prix à la consommation (IPC)), peu importe : R1/R2 est égal à (R1/IPC)/(R2/IPC).
Appliqué aux Etats-Unis, on observe que les inégalités de revenu ont augmenté de 6% entre 1994 et 2005. Ce qui n’est pas une
paille.
J’ai expliqué récemment que Krugman avait reconsidére sa
position sur le rôle du commerce international (plus précisément de la Chine) dans le creusement de ces inégalités, qu’il considérait en 1995 comme faible, qu’il considère aujourd’hui comme plus
fort.
Un document de
travail de Broda et Romalis, trouvé via Marginal Revolution, apporte un nouvel éclairage sur cette question, en développant une thèse plutôt à
contre-courant : les pauvres américains bénéficieraient en fait assez largement du développement de la Chine.
Voici leur argument : lorsqu’on mesure l’évolution des inégalités, on fait comme si pauvres et riches consommaient les mêmes
produits, qu’ils subissaient donc la même inflation. Or, c’est faux, les paniers de biens et de services sont différents. Il convient donc de réviser nos mesures, l’évolution des inégalités en
termes réels s’écrivant maintenant :
(R1/IPC1)/(R2/IPC2) avec IPC1<>PIC2 compte tenu des différences de consommation.
Qu’est-ce que cela change? Pas mal de chose, potentiellement : l’accroissement des inégalités de revenu peut maintenant être
contrebalancée par une évolution favorable de l’indice des prix à la consommation des pauvres, relativement à celui des riches. C’est en tout cas ce que les auteurs observent sur la période
1994-2005 : les riches achètent plus de services, les pauvres plus de biens non durables, les prix des biens non durables ont diminués relativement aux prix des services, l’inflation subie
par les pauvres est donc, sur cette période, 4% plus faible que celle subie par les riches. 2/3 du creusement des inégalités de revenu s’expliqueraient donc par cet écart d’inflation.
Quel rapport avec la Chine? Une part non négligeable des biens achetés par les pauvres provient de Chine. Le développement du commerce des
Etats-Unis avec ce pays expliquerait donc 1/3 du différentiel d’inflation. Les pauvres américains auraient donc bénéficié du développement de la Chine…
Petits compléments :
* l’étude ne dit pas que les inégalités riches/pauvres ne se creusent pas, mais qu’elles se creusent de manière moins spectaculaire qu’il ne
semblait, en raison de l’effet déflationniste de la mondialisation, dont bénéficiait plus les pauvres que les riches,
* on peut logiquement se demander si, depuis 2005, on n’est pas entré dans le processus inverse : la mondialisation devient inflationniste, et
tous les produits ne sont pas touchés de la même manière. Le fait que les prix de l’alimentaire augmentent plus vite que la moyenne affecte par exemple plus les pauvres que les riches,
* on peut d’autant plus se le demander qu’à bien regarder les résultats de l’étude, il semble que l’effet favorable aux pauvres soit fort de
1994 à 1999, beaucoup plus faible ensuite (cf. sur ce point les commentaires 4 (DRDR) et 17 (zubin) sous le billet de Marginal
Revolution),
* Dans tous les cas, on comprend l’importance d’introduire des indices de prix à la consommation différents par catégorie de revenu, pour
savoir où on en est, et comment les choses évoluent. C’est une des préconisations pertinente de la
commission Quinet “mesure du pouvoir d’achat des ménages”.