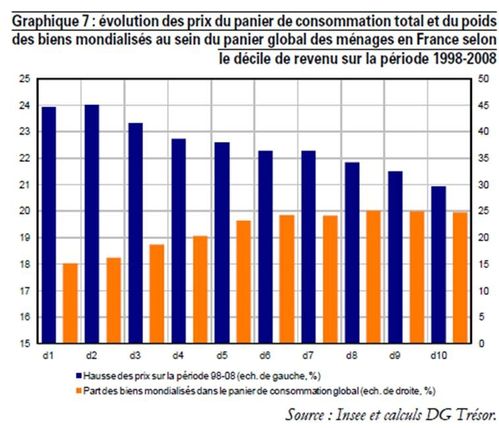Arnaud Montebourg, dans le cadre des primaires du parti socialiste, s’est fait le chantre de la démondialisation. Ce positionnement
politique est plutôt bien réparti sur l’échiquier politique, de Jean-Luc Mélanchon à Marine Le Pen, en passant par Arnaud Montebourg, donc, Nicolas Dupont-Aignan et j’en passe. En 2007, les deux
finalistes (Sarkozy et Royal) avaient tenu des propos plutôt anti-mondialistes (Ségolène Royal : il faut « taxer les entreprises qui délocalisent les emplois et taxer leurs produits
lorsqu’elles les réimportent » ; Nicolas Sarkozy : il faut trouver « Un chemin équilibré entre protection et protectionnisme »). Idem aux Etats-Unis avec Obama (le
protectionnisme serait « un mal nécessaire », propos repris par Christine Lagarde).
De manière générale, les sondages d’opinion le démontrent à l’envie : la mondialisation fait peur aux citoyens, les politiques ont
stratégiquement intérêt à « caresser les citoyens dans le sens de leur peur » (formule reprise de François Héran, le Temps des
immigrés, Seuil-La République des Idées), ils adoptent donc de manière préférentielle des positionnements plutôt frileux, voir très anti, vis-à-vis de la mondialisation.
Récemment, Frédéric Lordon s’est énervé contre les attaques virulentes faites aux partisans de la démondialisation (voir ici). Son argumentation : ce n’est pas parce que la démondialisation est au programme du FN
qu’on ne peut pas réfléchir à cette notion, qu’elle n’est pas digne de débat. Si l’on s’interdit d’en parler, tout débat risque d’être impossible, car potentiellement récupérable par le FN. Je
suis totalement d’accord avec ce positionnement : on ne peut pas critiquer les partisans de la démondialisation sous ce prétexte. Il convient plutôt d’argumenter, d’avancer des éléments de
preuve sur les avantages/coûts d’une telle stratégie, puis d’en tirer les conséquences en termes d’action publique.
Dans cette perspective, je vous propose de développer deux idées pour alimenter le débat. La première est assez connue. La deuxième
résulte de considérations plus récentes.
1. Les économistes sont de mauvais pédagogues
Quand on leur parle de mondialisation, la plupart des économistes expliqueront que c’est un jeu gagnant-gagnant, un « win-win
game » in english. Ce qui a valu a Greg Mankiw de se faire traiter de « Alice au pays des Merveilles » par un sénateur démocrate. Il
faut dire que l’expression est particulièrement maladroite : quand les économistes disent que la mondialisation est un jeu gagnant-gagnant, ils ne veulent pas dire qu’il n’y a pas de
perdants. Car il y a des perdants en fait…
Ca vous semble paradoxal ? Ben non… J’illustre de manière (j’espère) pédagogique. Intéressons-nous au cas de deux pays A et B. Ce
qu’enseigne l’économie, c’est que si ces deux pays s’insèrent dans la mondialisation, ils vont réaliser des gains nets
positifs :
A : Gains – Pertes > 0
B : Gains – Pertes > 0
D’un point de vue macro-économique, donc, les deux réalisent des gains. Mais ces gains nets correspondent à la différence entre des
gains et des pertes. Les perdants sont d’une part des entreprises qui se trouvent évincées du marché par la concurrence étrangère et d’autre part les salariés qui perdent leur emploi suite à la
disparation ou à la réduction de la production de ces entreprises. Il convient donc de distinguer ce qui se passe à l’échelle macro-économique et ce qui se passe au niveau d’une entreprise (quand
une entreprise ferme, les salariés souffrent) ou d’un territoire.
Si l’on considère que, globalement, les pays gagnent à la mondialisation, la question est déplacée : il ne s’agit plus d’accuser
l’autre (le pays étranger) de nos maux, mais de s’interroger sur notre capacité à « dédommager » les perdants : comment faire en sorte que les personnes essuyant les pertes (les
personnes peu qualifiées pour l’essentiel) parviennent à retrouver rapidement un emploi ? Il ne s’agit donc plus de prôner une politique de protectionnisme commercial, mais une politique de
protection sociale, qui passe, notamment, par des politiques de formation des personnes les moins qualifiées (quand je dis cela, je ne dis pas que l’avenir de tous les jeunes français passe par
l’obtention d’un diplôme d’école d’ingénieur, d’un Master ou d’un doctorat : il y a de nombreux besoins non couverts dans des entreprises industrielles qui sont à la recherche de diplômés de
CAP/BEP/Bac pro dans des filières de formation désertées, pour des raisons bien connues mais difficiles à combattre). Ainsi qu’une politique industrielle (avec un volet essentiel en termes
d’innovation) pour travailler à la spécialisation de l’économie française.
En clair : arrêtons d’externaliser la faute (le méchant chinois, polonais, indien, etc.), prônons plutôt un travail
d’introspection (où sont les défaillances dans nos politiques publiques).
(Précision importante, en passant : les propos ci-dessus ne visent pas à prôner un libre-échangisme effréné. Nous sommes dans un
système économique plutôt favorable aux échanges de biens, à la mobilité du capital et du travail. Je dis bien plutôt favorable, car il existe tout un ensemble de règles qui freinent ces
circulations (notamment du travail). Ce que je veux dire, c’est que l’enjeu essentiel n’est pas de modifier radicalement et rapidement cet ensemble de règles cadrant les relations
internationales, mais de s’interroger sur l’ensemble de règles internes qui cadrent les comportements en termes de formation des personnes et d’innovation des entreprises).
2. Taxer les pays étrangers, c’est, pour beaucoup, taxer les entreprises françaises
Deuxième idée essentielle, plus récemment mise en évidence : les discours sur la mondialisation sont développés en considérant, à
la base, que nous sommes dans une espèce de confrontation entre pays. Nous regardons donc ce qu’exporte la France, ce qu’elle importe, on se réjouit dans le premier cas, on se désespère dans le
deuxième cas.
On procède de même pour l’ensemble des pays, ce qui laisse dire à beaucoup que l’industrie n’a plus d’avenir dans les pays développés,
que la Chine, notamment, est devenue l’atelier du monde, que la désindustrialisation des pays développés est en marche. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet, voir ce billet par exemple, qui montre que la baisse des effectifs industriels en France a beaucoup à voir
avec des mécanismes qui ont peu à voir avec la mondialisation. Mais il y a un autre élément important.
Cet élément a été avancé sur un cas simple, celui de la production de l’iPod. Si vous regardez les flux d’importation/exportation de ce
produit, vous constaterez assez vite que, pour l’essentiel, on observe des exportations de iPod de la Chine (principal producteur) vers les Etats-Unis (principal consommateur). Ce qui semble
valider la thèse de la désindustrialisation des pays développés au profit des pays à bas coût.
Sauf que : pour exporter un iPod, la Chine importe beaucoup de composants. D’Allemagne, du Japon, de Corée du Sud, etc. Ce que la
Chine récupère, ce sont donc les dollars qu’elle perçoit de ses importateurs d’Amérique du Nord, moins ce qu’elle reverse à ses fournisseurs. Quel est le bilan ? En gros, sur 100 perçus des
Etats-Unis, elle en reverse 97 à ses fournisseurs. La richesse récupérée en Chine est donc de 3%. La Chine n’est pas l’usine du monde, elle est l’assembleur du monde. Elle s’occupe, dans de
nombreux cas, de la dernière étape avant distribution des produits. En localisant toute la valeur créée à cette dernière étape (approche retenue dans les statistiques traditionnelles du commerce
mondial), on en arrive à une vision très erronée de la géographie de la création de richesse.
On trouve des exemples similaires pour la France : « l’entreprise Bonduelle exporte depuis la France des poêlées de légumes
surgelés. Il ne s’agit toutefois pas d’exportations entièrement françaises puisque les choux-fleurs peuvent venir de Pologne, les choux de Bruxelles, du Guatemala, etc. À la limite, Bonduelle
n’exporte depuis la France que des services de conception, de marketing et d’emballage. De même, l’entreprise Conserves de Provence transforme et conditionne du concentré de tomates chinoises
pour le revendre en Europe. À l’inverse, des flacons de parfum français font l’aller-retour entre la France et Shanghai pour être décorés d’un motif écossais. On ne peut pas dire pour autant que
la France importe des parfums de Chine. C’est pourtant ce que suggèrent les statistiques de commerce extérieur » (source ici, p. 130).
Ce mécanisme joue pour tous les pays. Il illustre les limites des statistiques sur les exportations et la nécessité de raisonner sur la
valeur ajoutée : que récupère-t-on dans le pays A une fois payés les fournisseurs des pays B, C, D, etc. ? Pour la Chine, en moyenne, c’est près de 50% de la valeur des exportations
chinoises qui vont à des fournisseurs étrangers en 2005. Pour la France, c’est près de 30%. Idem pour l’Allemagne. Le pompon va au Luxembourg, avec près de 60% (voir cette étude trouvée via ce billet).
Revenons, donc, à la proposition de « démondialiser » l’économie. Imaginons que, pour ce faire, on taxe de x% les produits
importés de l’étranger. Il faudrait déjà savoir si l’on taxe hors Europe ou en Europe aussi. Car la France importe des produits, à hauteur des 2/3, de l’Union Européenne. Imaginons que l’on taxe
tous les pays. Négligeons d’éventuelles mesures de rétorsion. Mécaniquement, ceci conduira, en moyenne, à accroître de (x/3)% le coût des produits français, via l’accroissement du prix des
produits intermédiaires importés.
Taxer les pays étrangers, c’est donc, aussi, et pour une part non négligeable, taxer les entreprises françaises. Je ne suis pas sûr
qu’il s’agisse de la plus grande urgence en termes de politique publique. Et j’euphémise…