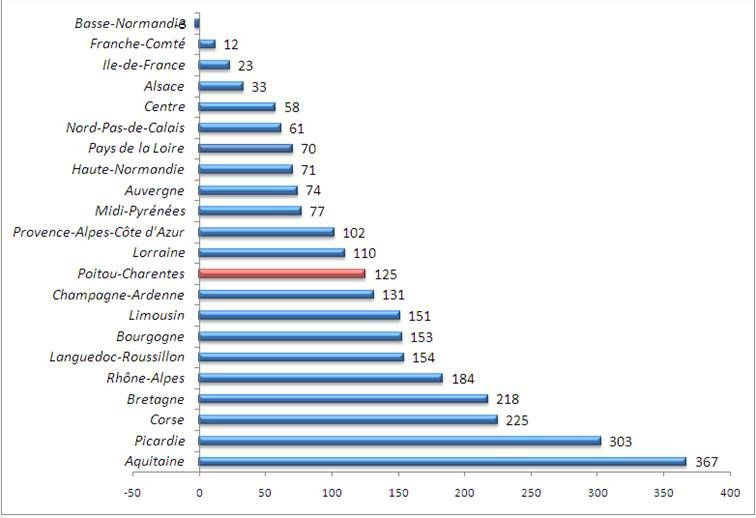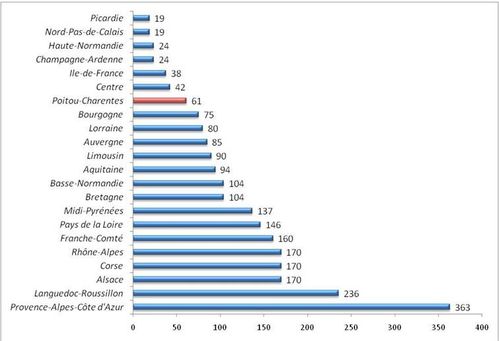Le rapport Rocard sur l’instauration d’une taxe carbone en France sera remis demain. La Polémique monte sur ce qui
apparaît comme un nouvel impôt sur les ménages. Pour éviter l’usine à gaz, la généralisation d’un système de quotas-avec-marché serait une bonne solution.
Dans son discours du 22 juin devant le Congrès, le président de la République a affirmé son soutien à la mise en
place d’une taxe carbone, dite “contribution climat-énergie” pour limiter les émissions françaises de CO2 liées au transport et à l’habitat. L’intention est louable, mais on peut redouter qu’il
ne s’agisse pas du meilleur choix.
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les émissions de CO2 des grands établissements industriels
sont réglementées au niveau européen. Pour une période donnée, ils reçoivent chacun, ou bien doivent acheter aux enchères, un certain nombre de “permis à polluer”, titres qu’ils peuvent ensuite
vendre ou acheter sur un marché, si leurs émissions polluantes sont inférieures ou supérieures aux quotas qui leur ont été fixés au départ. Ce schéma couvre un tiers environ des émissions
globales européennes de CO2. Il aurait été souhaitable, selon nous, d’utiliser un système analogue et non une taxe pour limiter en France les émissions de CO2 liées au transport et à l’habitat
(les deux autres tiers).
Contrairement à ce que certains prétendent, un tel système de quotas-avec-marché ne serait pas beaucoup plus compliqué à
mettre en œuvre qu’une taxe carbone prélevée au moment de la vente d’hydrocarbures. Personne n’envisage de contraindre les automobilistes à se procurer des permis à polluer pour chaque kilomètre
parcouru. Ce sont les producteurs et distributeurs d’énergie qui devront acquérir ces permis de polluer en fonction de leur volume de vente annuel. Et un tel système présente trois avantages
notables par rapport à une taxe carbone. Pour réduire les émissions de CO2 au moindre coût, il faut que les pollueurs qui peuvent le plus facilement diminuer leurs émissions de gaz le fassent
d’abord, en permettant à ceux pour qui c’est le plus onéreux de s’y mettre plus tard. Si l’aciérie Dupont doit dépenser 40 euros pour éviter d’émettre une tonne de CO2 supplémentaire, alors que
le chalutier Rossi ne doit dépenser que 30 euros pour un même résultat, on peut économiser 10 euros en demandant à Rossi de réduire d’une tonne ses émissions et en permettant à Dupont d’émettre
une tonne de plus. Cette économie peut être obtenue avec une taxe aussi bien qu’avec un système de quotas-avec-marché, mais il est fondamental que tous les acteurs économiques soient confrontés à
un prix unique de la tonne de CO2, sans quoi limiter la pollution reviendra plus cher.
Or, de ce point de vue, la coexistence prévue entre les quotas-avec-marché pour les secteurs couverts par le système
européen et d’une taxe carbone pour le reste de l’économie française implique la présence d’au moins deux prix différents : la taxe pour certains, le prix du permis pour d’autres. Si l’on
adoptait un système de quotas-avec-marché pour limiter les émissions de CO2 des secteurs du transport et de l’habitat, il serait possible à l’inverse de relier ce marché français avec le marché
européen, en permettant ainsi l’émergence d’un prix unique du CO2 au niveau européen, le gage d’une politique véritablement cohérente.
Il faut ensuite reconnaître que toute réglementation environnementale est sujette à de nombreuses pressions de groupes
d’intérêt ou de couches électorales pivots. Dans le cas d’une taxe carbone, il est vraisemblable que ces pressions donnent lieu à une panoplie d’exonérations et à l’application de niveaux de
taxation réduits. Dans le cas d’un quota-avec-marché, les mêmes pressions donneraient lieu probablement à des allocations trop abondantes et gratuites de permis à polluer, mais ne porteraient pas
atteinte à l’unicité du prix de la tonne de CO2.
La pérennité de l’effort entrepris serait aussi plus probable. Les supporters de la taxe carbone ont raison de
vouloir la mettre en œuvre très rapidement. En effet, la question climatique est urgente, et le contexte politique actuel apparaît particulièrement favorable à la mise en place d’une telle taxe.
Le score des Verts aux dernières élections et les sondages d’opinion indiquent qu’un grand nombre de Français sont prêts à accepter un coût accru de leurs consommations d’énergie. On ne peut
néanmoins pas être sûr que cette préoccupation pour le climat conserve longtemps sa prééminence face aux questions de revenu, de pouvoir d’achat et d’emploi. Il est possible que, même si une taxe
carbone est aujourd’hui mise en place, elle puisse ensuite être édulcorée. En revanche, avec un système de quotas-avec-marché, les hommes politiques doivent convaincre les électeurs d’adopter un
objectif environnemental, le quota global d’émissions autorisé, et cet engagement pourra être plus largement partagé sur des bases éthiques que la levée d’une taxe sur les consommations
énergétiques.
Francesco Ricci, chercheur à l’école d’économie de Toulouse (TSE) et à l’université de Poitiers