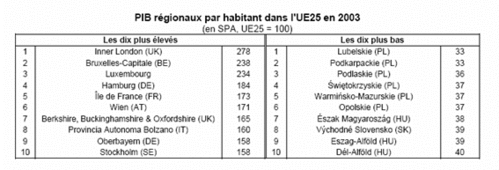C’est la rentrée à la Faculté de Sciences Economiques de Poitiers, pour les 1ères années jeudi dernier (7 septembre), et aujourd’hui 11 septembre pour les autres années (information importante pour ceux qui pensent encore, peut-être, que l’année universitaire commence en novembre…)
Ce matin, j’ai démarré avec les 3ème années de la Licence d’Economie Appliquée. La réunion de rentrée a été l’occasion de présenter aux étudiants un travail d’enquête qu’ils doivent réaliser par groupes de 4 : définition d’une problématique, rédaction d’un questionnaire, production des résultats statistiques sous Spad, analyse et interprétation des résultats. Ce travail doit faire l’objet d’une restitution écrite sous forme de dossier et d’une restitution orale – utilisation impérative d’un diaporama (Information importante pour ceux qui pensent encore, peut-être, qu’à l’Université on ne fait que de l’abstraction pure…)
Le choix du sujet est libre. J’ai cependant suggéré une ou deux idées (je ne sais pas si elles trouveront preneurs), notamment l’une portant sur le profil des lecteurs de blogs d’économie. Si un groupe est intéressé, je vous en reparlerais, puisque le questionnaire serait transmis via mon blog. Si certains économistes bloggeurs sont intéressés (econoclaste? ceteris paribus? leconomiste? etc…), n’hésitez pas à me contacter par mail ou via un commentaire, on pourrait échanger sur la définition du questionnaire par exemple. Autre suggestion formulée : enquête sur les connaissances en économie soit auprès d’étudiants de différentes filières, soit auprès d’une population plus large. En évitant les travers de l’enquête du Codice dénoncés par Econoclaste…
Enfin, premier cours de Stratégies de localisation, avec présentation de faits stylisés relatifs à l’ampleur et l’évolution des disparités spatiales et la tendance à l’agglomération des activités économiques. Et ce à différentes échelles spatiales : Monde (via gapminder, dont j’ai déjà parlé ici), Europe (statistiques Eurostat) et France (statistiques Insee).
Juste un résultat ici : les disparités régionales dans l’Europe à 25, mesurées par le PIB par habitant des régions en 2003 (source Eurostat, voir ce document pour la liste complète) :
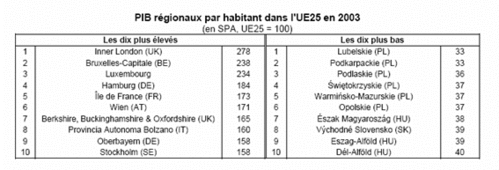
Sans surprise, les 10 régions les plus "riches" sont en Europe de l’Ouest, les 10 régions les plus "pauvres" dans les Pays d’Europe Centrale et Orientale. Le rapport entre la région la plus riche (Inner London, UK) et la région la plus pauvre (Lubelskie, Pologne) est d’environ 8,5 pour 1. Pour se donner un ordre de grandeur, le rapport du PIB/H des Etats-Unis et de la Chine est de 7/1. Il y a donc quelque chose qui ressemble à un problème régional en Europe…
Autre résultat important, insuffisamment pris en compte dans la réflexion, y compris des économistes : la tendance à la convergence des PIB par habitant des pays de l’UE à 25, d’un côté, et au maintien, voire à l’accroissement, des disparités entre régions, toujours en termes de PIB par habitant, d’autre part. Bref, un double processus de convergence et d’agglomération, coeur du problème que doit traiter l’économie spatiale (voir ce document de travail de Geppert et al. (2005) pour des précisions sur les méthodes statistiques mobilisables et les résultats obtenus pour l’UE25).