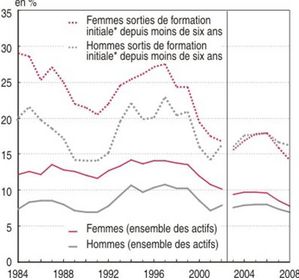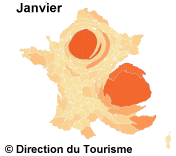El Mouhoud dans le Monde, découverte via le Blog de Philippe Moati. Extrait :
Depuis trente ans, les politiques publiques interviennent pour sauver les territoires une fois la délocalisation ou
la restructuration effectuées. Une intervention après coup en aidant les entreprises (exonérations de taxes, subventions,…) a pour effet de verrouiller le territoire dans ses difficultés au
lieu de l’aider à se diversifier. Les leçons du passé n’ont pas été tirées. Le paradoxe est que les aides se concentrent sur les mobiles (entreprises) et laissent de côté les immobiles,
c’est-à-dire les hommes et les femmes qui vivent sur les territoires vulnérables à la mondialisation et à la délocalisation.
Une politique plus offensive consisterait à anticiper les chocs de la délocalisation en concentrant les aides sur les
personnes pour favoriser leur qualification, leur formation et leur mobilité et en s’appuyant sur les infrastructures du territoire lui-même. Ce type d’avantage compétitif est susceptible
d’attirer les entreprises dont la vocation à l’ancrage territorial est plus forte, c’est-à-dire celles qui tirent leurs avantages de la qualité du territoire et des hommes et femmes qui y vivent
et y travaillent.
Sur la taxe carbone, voir cette tribune d’Hyppolyte d’Albis, titrée “Idiote taxe carbone
européenne”. Extrait :
Une taxe carbone aux frontières n’a tout simplement pas de sens, car, lorsqu’on importe un bien étranger, on ignore
son contenu en carbone. On ne connaît pas la quantité d’énergies fossiles nécessaire pour le produire, et encore moins la quantité de gaz à effet de serre qui a été émise lors de sa production.
(…)
On pourrait imaginer que des taux de taxation soient définis pour chaque bien ou pour chaque secteur en fonction, par
exemple, de la consommation moyenne d’énergie fossile. Mais cela reviendrait à favoriser, parmi les entreprises étrangères, celles qui ne font aucun investissement dans des technologies propres.
Les entreprises les plus polluantes auraient donc un accès privilégié au marché européen ! Une autre solution consisterait en une obligation de déclaration des consommations d’énergie aux
douanes. Outre le fait qu’une nouvelle formalité viendrait s’ajouter aux procédures d’importation déjà complexes, ces déclarations seraient invérifiables. Cela reviendrait à favoriser
implicitement les entreprises produisant de fausses déclarations.