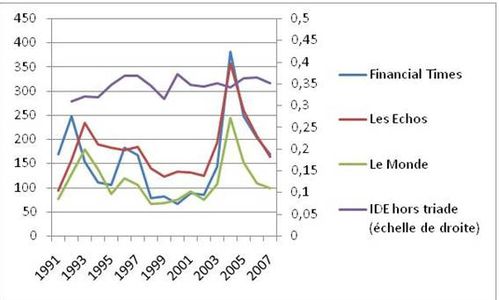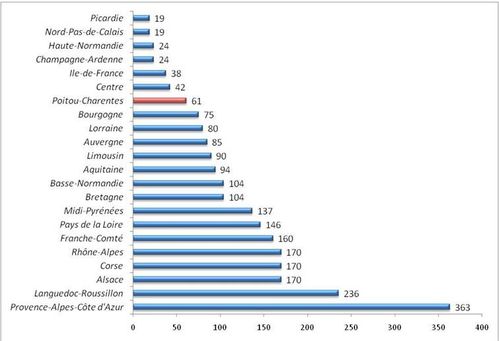Les pays low cost sont confrontés à quelque chose qui ressemble à une contradiction interne : ils disposent d’un avantage en termes de
coût du travail, qui permet un développement rapide, attire de l’investissement étranger, mais ce supplément de création de richesse conduit à une élévation des salaires et donc à une réduction
progressive de leur avantage initial.
J’explique souvent ce processus en m’appuyant sur une comparaison France/Tchéquie : en 1996, le coût de l’heure de travail était 8 fois
plus important en France, la productivité du travail était 2 fois plus forte, le coût salarial unitaire, rapport du coût de l’heure de travail et de la productivité horaire du travail, était donc
4 fois plus important en France qu’en République Tchèque. En 2002, soit 6 ans plus tard, ce rapport de 4/1 était tombé à 2,5/1. Pourquoi? Le différentiel de productivité a peu évolué sur la
période, c’est du côté des salaires que les choses ont bougé, le rapport entre le coût de l’heure de travail entre les deux pays passant de 8/1 à 5/1.
Cette mécanique n’a cependant rien de naturel : son ampleur et son rythme dépendent notamment des rapports de force entre les
collectifs d’acteurs, les salariés ayant des marges de manoeuvre plus ou moins importantes pour négocier des augmentations de salaire (d’où des interrogations sur l’ampleur de cette dynamique
pour un pays comme la Chine, compte tenu du régime politique en place et de “l’armée de réserve” sur laquelle peuvent compter les entreprises…).
L’organisation International du Travail vient de livrer un ensemble de statistiques particulièrement
intéressantes sur ce sujet. On y découvre notamment ce tableau (page 16) :
| 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Pays avancés | 100 | 104.2 | 105 | 104.5 | 105.2 |
| Europe centrale et orientale | 100 | 144.8 | 154.4 | 161.4 | 161.3 |
| Europe orientiale et Asie centrale | 100 | 264.1 | 308.9 | 341.6 | 334.1 |
| Asie | 100 | 168.8 | 180.9 | 193.8 | 209.3 |
| Amérique latine et Caraîbes | 100 | 106.7 | 110.3 | 112.4 | 114.8 |
| Afrique | 100 | 111.2 | 112.8 | 113.4 | 116.1 |
| Monde | 100 | 115.6 | 118.9 | 120.7 | 122.6 |
Les salaires ont peu évolué dans les pays avancés (multiplication par 1,05 sur 10 ans), alors qu’ils ont fortement évolué en Asie
(multiplication par plus de 2). On peut compléter grace aux données en annexe. Je reprend ici les chiffres pour la Chine et la France :
| 2000-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| France | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | -0.8 |
| Chine | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 11.7 | 12.8 |
La Chine n’échappe donc pas à la mécanique rappelée plus haut.
S’agissant du rôle des rapports de force entre collectifs d’acteurs, le rapport nous apprend que “les salaires sont mieux alignés sur la productivité dans les pays où la négociation collective couvre plus de 30 pour cent des employés”.
Je vous laisse découvrir les autres éléments qui figurent dans ce rapport, vraiment instructif sur de nombreux aspects.