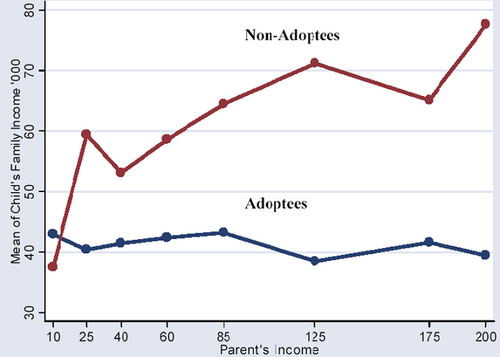Hirschman a développé en 1970 un modèle aussi simple que puissant, qualifié de modèle exit-voice, auquel il a apporté quelques compléments/précisions en 1986. Modèle à mon humble avis sous-utilisé en économie, sur lequel nous travaillons dans notre labo pour traiter des modalités de résolution des conflits d’usage et de voisinage observés sur le littoral picto-charentais (avec un article à paraître fin 2009 dans la revue Natures Sciences et Sociétés). L’objectif ici est de montrer en quoi il permet d’analyser les conflits observés au sein du Parti Socialiste…
1. Exit, voice et loyalty
Dans son modèle, Hirschman s’intéresse de manière générale aux modalités de résolution des dysfonctionnements observés dans une organisation : un consommateur insatisfait par la qualité du produit vendu par une entreprise, un citoyen mécontent de la politique de son gouvernement, un salarié insatisfait de ses conditions de travail, etc.
Il considère alors, en première analyse, que les acteurs peuvent apporter deux grands types de réponse aux dysfonctionnements constatés : soit ils adoptent un comportement de fuite (exit), soit ils prennent la parole (voice). Par exemple, les citoyens d’un État peuvent répondre à une répression politique par l’émigration (exit) ou par des manifestations (voice) ; les salariés d’une entreprise insatisfaits de leurs conditions de travail peuvent décider de quitter leur emploi (exit) ou d’exprimer leur mécontentement afin que la situation s’améliore (voice) ; des consommateurs déçus par la qualité d’un produit peuvent réagir en effectuant leurs achats ailleurs (exit), ou bien en se plaignant aux responsables de l’entreprise productrice (voice).
Dans certains cas, l’une des deux options, exit ou voice, est impossible et les deux solutions apparaissent alors complémentaires. Dans d’autres cas, exit et voice sont envisageables et apparaissent donc comme substituables. Hirschman (1986, p. 59) précise que le voice est souvent préférable, car l’exit est « un moyen puissant mais indirect et assez grossier de faire savoir à la direction que les choses ne vont pas » et il peut être à
l’origine d’un processus cumulatif de détérioration (par exemple, un quartier difficile, où sont localisées de nombreuses personnes pauvres, verra partir prioritairement celles qui disposent des moyens financiers les plus importants, et ainsi s’accentuer le phénomène de ghettoïsation).
En s’interrogeant sur les moyens de freiner l’exit et de favoriser le voice, Hirschman (1986) est amené à distinguer deux types de voice, correspondant à deux étapes différentes de la prise de parole des acteurs. La première, le voice horizontal, renvoie à l’organisation des acteurs en collectifs, qu’ils soient formels ou informels, dans le but de préparer l’action collective. Ce n’est qu’une fois cette étape réalisée que les acteurs peuvent, de manière efficace, prendre la parole face à l’autorité régulatrice, ceci marquant l’entrée dans la seconde étape, qualifiée de voice vertical.
Pour comprendre davantage l’arbitrage réalisé par les acteurs entre exit et voice, Hirschman introduit une troisième notion, le loyalty, qu’il relie à la confiance que les acteurs peuvent porter à l’organisation à laquelle ils appartiennent – sentiment de patriotisme dans le domaine politique, attachement des consommateurs à une marque dans le domaine économique. Dans les cas où exit et voice sont possibles, les individus opteront alors pour le voice soit s’ils sont loyaux, soit s’ils considèrent qu’ils peuvent influencer l’évolution de leur organisation. Ces deux conditions sont en fait interdépendantes et s’autorenforcent : les personnes loyales cherchent à gagner de l’influence et les personnes influentes sont de plus en plus attachées à l’organisation, persuadées de pouvoir la faire évoluer. Au total, le loyalty aurait donc tendance à freiner le recours à l’exit et à favoriser davantage le recours au voice.
2. Application au parti socialiste
Les applications peuvent être nombreuses, je me concentre ici sur les comportements récents de certains des ténors du parti. Etant entendu que je suis loin d’en disposer d’une connaissance précise, mais bon, n’hésitez pas à amender en commentaire…
Première idée, ont-ils intérêt à faire de l’exit ou du voice?
En règle générale, on peut considérer que pour les cadres d’un parti, faire de l’exit est particulièrement coûteux : ils ont dû investir pendant de longues années pour monter progressivement dans la hiérarchie d’une organisation qui dispose d’une puissance de frappe non négligeable pour atteindre à plus ou moins long terme l’objectif poursuivi par ces individus : obtenir le pouvoir. En France, on a depuis de longues années grosso modo deux partis qui trustent l’essentiel des postes, le PS et l’UMP, quitter l’un de ces partis pour s’aventurer dans une organisation moins bien implantée (NPA, Modem, …) n’est donc pas le meilleur moyen de décrocher rapidement un poste. A moins de ne plus avoir guère d’espoir en interne (Mélenchon?).
Jusqu’à récemment en tout cas, car depuis quelques temps, cela n’a échappé à personne, notre Président de la République a déployé une stratégie pas inintéressante pour faciliter l’exit de certains ténors du parti socialiste, en leur proposant de redéployer l’investissement effectué au PS au sein de l’UMP (Eric Besson) ou du gouvernement (Kouchner)… Et ça marche plutôt bien… Avec sans doute des effets en retour : d’autres ténors, non encore partis du parti, (si j’ose dire) peuvent en effet agiter une menace devenue crédible (“si vous ne répondez pas à mes demandes, je cours au gouvernement!”) pour obtenir plus que ce qu’ils pouvaient espérer auparavant (Jack Lang?).
Deuxième élément d’application, pour décrypter les comportements de Valls, Peillon et de Montebourg. Chacun déploie en fait une stratégie de voice assez différenciée.
Arnaud de Montebourg, d’abord, a pris la parole pour… menacer de partir si son projet était bloqué par la direction (voir sa tribune dans la nouvel obs).
“Or, je le dis tout net, je n’irai pas plus loin. S’il devait échouer, ce combat serait pour moi le dernier, au sein
d’un PS qui telle la vieille SFIO ne mériterait plus qu’on l’aide à survivre. Il y a dans ce parti trop de violence, trop de blocages, trop de poussières sous les tapis, trop de petits
calculs pour que le militant que je suis, fidèle à ses idées et fier de ses engagements, ne tente pas son dernier combat.”
En gros, l’idée est que si on ne l’écoute pas, il fera de l’exit. Le problème avec ce type de stratégie est de savoir si la menace est crédible… S’il part, c’est pour aller où? Et quel dommage pour l’organisation?
Deuxième stratégie mise en oeuvre ce week-end, celle de Vincent Peillon (voir ici par exemple), qui dirige le courant “l’espoir à gauche”, qu’il considère comme le «premier courant dans le parti». Peillon fait clairement du voice, mais plutôt du voice horizontal : il ne s’agit pas de se confronter directement à la direction du parti, mais de faire émerger, au préalable, un collectif intermédiaire, susceptible de prendre la parole, plus tard, face à la direction du parti, et d’imposer ses vues.
Troisième stratégie, enfin, celle de Manuel Valls (voir ici par exemple) : Manuel Valls s’est exprimé à plusieurs reprises sur le parti socialiste, en contestant son nom, en dénonçant la victoire d’Aubry contre Ségolène Royal, en affirmant surtout, plus récemment :
« Martine Aubry nous dit que le Parti socialiste est en ordre de marche pour affronter de nouvelles défaites. Tel le
chef d’orchestre sur le pont du Titanic, elle convie les socialistes à bien lire leur partition tout en leur cachant la vérité sur l’ampleur des voies d’eau constatées sur le navire.
(…)
Ce n’est pas en réinventant l’eau tiède des valeurs de la gauche que celle-ci a la moindre chance de reconquérir le
pouvoir. Martine Aubry se présente comme un adversaire résolu de Nicolas Sarkozy. Pourtant en la lisant, je crains que ce dernier ne se dise : avec une gauche comme celle-là, la droite a de
beaux jours devant elle ! »
Bref, lui aussi fait du voice, mais du voice moins consensuel, selon une logique de confrontation, et en se positionnant directement vis-à-vis de la première secrétaire. Du voice vertical sans voice horizontal préalable, donc… Peut-être est-ce là un signe que l’on peut inverser la logique mis en évidence par Hirschman? Valls fait du voice vertical en essayant de structurer autour de lui un autre courant au sein du PS (voir ici), autrement dit pour provoquer du voice horizontal? Cheminement inverse à celui de Peillon, donc.
Ce à quoi Aubry répond :
Si les propos que tu exprimes reflètent profondément ta pensée, alors tu dois en tirer pleinement les conséquences et
quitter le Parti socialiste.
Aubry demande à Valls de se taire ou de partir. D’arrêter le voice et de faire de l’exit. Ce qui n’est pas vraiment un signe de bonne santé pour une organisation, pas le signe, en tout cas, que cette organisation est prête à évoluer… En apparence, en tout cas, car les choses pourraient être moins simples. Avant cette formule, en effet, Martine Aubry avait pris soin de proposer à Manuel Valls de continuer à faire du voice, mais d’une autre manière, moins dans une logique de confrontation que de concertation :
Mon cher Manuel, s’il s’agit pour toi de tirer la sonnette d’alarme par rapport à un parti auquel tu tiens, alors tu
dois cesser ces propos publics et apporter en notre sein tes idées et ton engagement.
Tout l’enjeu est de savoir si une telle prise de parole en interne est susceptible de faire évoluer l’organisation… Valls doit penser que non.
Quelle est la meilleure stratégie? Montebourg et Valls doivent avoir un ego plus important que Peillon, puisqu’ils espèrent rassembler sous leur seul nom un nombre suffisant de personnes. Entre Montebourg et Valls, la stratégie du premier me semble plus hasardeuse, la menace de départ étant somme toute peu crédible… A moins, finalement, que ces stratégies ne soient complémentaires et plus ou moins coordonnées, car, sauf erreur de ma part, ces trois espoirs du parti ont soutenu plus ou moins fortement la candidature de Ségolène Royal… Il s’agirait alors de faire craquer la direction, en attaquant de tous les côtés?
Source :
Hirschman A.O., 1970, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hirschman, A.O., 1986. Vers une économie politique élargie, Paris, Éditions de Minuit.