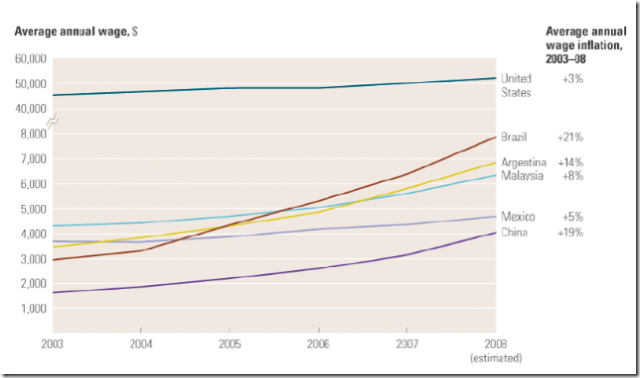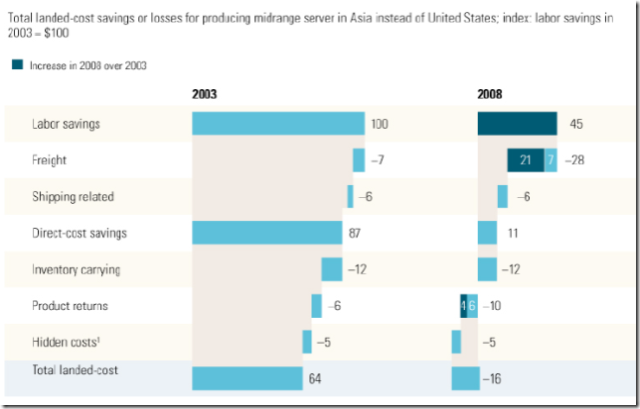Pour info, le classement des mines est disponible ici.
On me demande en commentaire : “en quoi la direction d’entreprises internationales, s’il s’agit bien d’entreprises
internationales, a-t-elle à voir avec le système de reproduction français des élites?”
Explication : effectivement, si on regarde les communiqués et les articles de presse, on se dit que nos grandes écoles
sont plutôt fortes, puisqu’elles arrivent à placer des dirigeants dans les 500 plus grandes entreprises mondiales. Sauf qu’il convient de vérifier dans quels pays précisément on les place…
Petit exercice auquel je me suis livré.
Précision préalable : on peut adopter 2 points d’entrée : i) on regarde les dirigeants d’entreprises françaises, et l’on
voit de quelle formation ils sont issus (française ou étrangère), ii) on regarde les formations françaises, et on voit quelles entreprises ils dirigent (francaise ou étrangère).
1er résultat : j’ai recensé 38 entreprises françaises dans le classement. Sur ces 38, 33 sont dirigés par une
personne issue de formations françaises, 3 de formations étrangères, 2 non renseignés. Le bon classement de HEC, Mines, ENA, … s’explique donc bien, pour une large part, par le fait que ces
écoles “trustent” les postes de dirigeants d’entreprises certes mondiales, mais avant tout françaises…
2ème résultat : si on regarde les dirigeants issus de formations françaises, on en dénombre 33 qui dirigent des
entreprises françaises (logique, même chiffre que précédemment), et 10 qui dirigent des entreprises étrangères. Ce dernier chiffre n’est pas inintéressant, puisqu’il renseigne en quelque sorte
sur la capacité d’exportation des formations. Si j’avais un conseil à donner à l’école des Mines, ce serait sans doute de construire un tel classement en termes de capacité d’exportation, qui
neutraliserait pour une bonne part les effets de reproduction sociale.
Pour une bonne part, mais pas totalement : dans les 10 entreprises étrangères concernées, certaines sont… moyennement
étrangères. On y trouve part exemple Nissan, entreprise japonaise, dirigée par Carlos Ghosn, polytechniques/Mines, qui parait-il à quelques liens avec Renault. Le fait qu’un dirigeant français
dirige cette entreprise étrangère n’est donc pas un bon indicateur de la capacité d’exportation de son école d’origine. Idem pour Louis Gallois, dirigeant d’une entreprise néerlandaise dénommée
… EADS. Bref, il faudrait regarder non seulement la nationalité de l’entreprise, mais aussi son actionnariat, pour mieux comprendre les résultats.