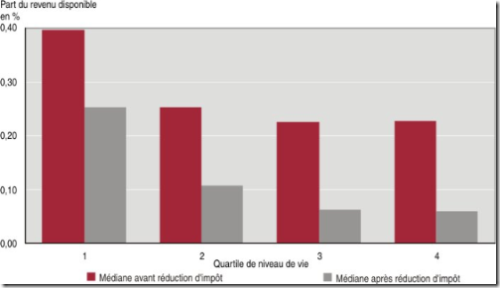Bravo à Shrat (commentaire 10) et à Veig (commentaire 19) pour les réponses. Le graphique suivant…

… représentait les flux migratoires par âge de l’Ile de France (très précisément : les quotients migratoires annuels moyens 1990-2005). Il
est tiré d’un article de Economie et Statistique qui vient de paraître : Léon Olivier, 2008, “Les projections
régionales de population 2005-2030″, Economie et Statistique, n°408, p. 137-152.
Voici le commentaire associé au graphique : “Enfin, L’Île-de-France constitue à elle seule une singularité. Elle accueille des étudiants et
des jeunes actifs, mais dès 30 ans, les fl ux migratoires s’inversent, notamment à l’âge de la retraite (cf. graphique III). L’excédent migratoire de jeunes se combine au déficit dans les âges
plus élevés pour limiter le vieillissement : l’âge moyen en 2030 en serait ainsi réduit de plus de trois ans par rapport au scénario sans migrations. La région capitale serait dans ces conditions
celle qui vieillirait le moins (de 2,6 ans), ce qui renforcerait sa position de région la plus jeune de France métropolitaine.” (p. 147)
Autre configuration pour l’Aquitaine par exemple :

On apprend plus généralement dans l’article que les “nouvelles projections rehaussent en général les populations régionales par rapport aux anciennes. C’est particulièrement net en Limousin, en
Midi-Pyrénées et en Poitou-Charentes, qui ont enregistré les plus fortes infl exions démographiques au cours des dernières années, avec une fécondité en nette hausse conjuguée à un regain
d’attractivité migratoire prononcé.”