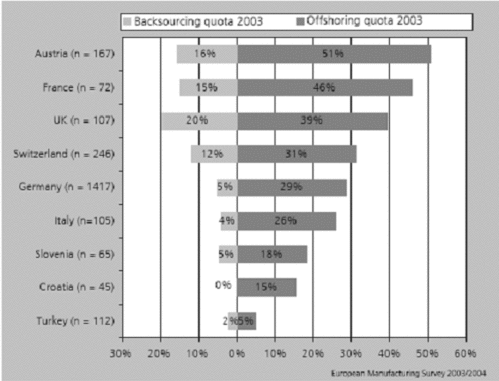Philippe Moati vient de mettre en ligne sur son blog une tribune en réponse à la chronique de Philippe Askenazy dans les Echos du 27 septembre. Je me permets de
reprendre les deux articles.
Texte de Philippe Askenazy, Directeur de recherche au CNRS, Ecole d’Economie de Paris :
Le président a marqué sa volonté d’une réforme majeure des régulations de la grande distribution en France. Pour comprendre sa démarche, il faut revenir onze ans
en arrière. En 1996, les groupes français de distribution continuent de développer leur parc de magasins alors qu’un nouveau format de vente – le hard-discount – connaît une croissance
exponentielle, portée par des opérateurs allemands, Lidl et Aldi. Cette situation menace les marges des distributeurs français. Sous couvert de défense du petit commerce, deux lois vont être
votées fort opportunément. La première est bien connue : confortant l’interdiction de la revente à perte, la loi Galland empêche les distributeurs de défalquer les marges arrière des prix. La
seconde, la loi Raffarin, renforce le contrôle des autorisations de grandes surfaces par les élus locaux et les représentants des distributeurs déjà en place. Elle l’étend aux surfaces de plus
de 300 mètres carrés pour l’alimentaire, le seuil de contrôle le plus bas en Europe. Ainsi, au moment même où le dynamisme de la grande distribution est un moteur essentiel de la croissance et
des créations d’emplois aux Etats-Unis, la France érige une législation restrictive anticoncurrentielle. La seconde loi limite la concurrence par l’offre, la première par les prix. La Bourse ne
s’y trompe pas, les actions des distributeurs s’envolent… avec les prix au détriment des consommateurs.
L’évolution des prix relatifs alimentaires est visuellement frappante. Alors qu’ils suivaient une évolution comparable à celle de nos voisins, dès l’automne 1996,
ils dérivent continûment, bien avant l’avènement de l’euro (qui ne semble pas avoir été plus inflationniste en France que dans les autres pays de la zone). Au total, les prix alimentaires se
retrouvent en 2004 au moins 7 % au-dessus de la tendance observée avant ces lois et même 10 % pour la viande. Le consommateur est en fait doublement perdant : la rareté des surfaces de vente
est criante dans certaines zones, et il n’est guère besoin de moderniser des magasins qui risquent peu de voir s’implanter un nouveau concurrent.
L’année 2004 marque cependant un tournant. Dans le sillage de plusieurs rapports sur la loi Galland, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Economie, convoque
bruyamment les distributeurs. Il obtiendra une modeste ristourne. Mais, parallèlement, les créations de grandes surfaces reprennent modérément à la suite d’un assouplissement de la loi Raffarin
par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; en août 2005, la loi Dutreil permet qu’une part des marges arrière soit intégrable dans les prix. Au total, entre la mi-2004 et juillet 2007, les prix
relatifs alimentaires décroissent de 2,5 % à 3 % par rapport à l’évolution européenne moyenne. Ils restent donc, uniquement pour l’alimentaire, potentiellement encore autour de 5 milliards
d’euros de pouvoir d’achat manquant pour les Français.
Théoriquement, la seconde phase de démantèlement du dispositif Galland impulsée par le président de la République et la réforme de la loi Raffarin devraient
mécaniquement rendre cette rente aux consommateurs.
Nicolas Sarkozy devrait ainsi satisfaire les consommateurs français au détriment des marges des grands distributeurs. Dans ce contexte, l’ouverture des commerces
le dimanche peut apparaître comme une compensation. Les salariés ne devraient guère en profiter. Mécaniquement, ils travailleront moins les autres jours de la semaine ; les heures bonifiées
généralement à 100 % lors d’une ouverture exceptionnelle le dimanche le sont rarement si l’ouverture est systématique. En revanche, les grands distributeurs pourront reprendre leur marche
d’écrasement des petits commerçants isolés. Pour ces commerçants, l’ouverture le dimanche matin est une bouée. Face à des géants ouverts tout le dimanche, pourront-ils sacrifier leur temps de
repos pour ouvrir aussi l’après-midi, comment feront-ils pour imposer à leurs éventuels salariés de travailler ? Environ un cinquième du chiffre d’affaires des grandes surfaces pourrait alors
être réalisé le dimanche. Plus utilisable, leur foncier sera revalorisé. Une bonne nouvelle pour la prochaine introduction en Bourse de la société foncière de Carrefour.
Texte de Philippe Moati, Professeur d’économie à l’Université
Paris-Diderot, directeur de recherche au Crédoc:
Dans sa chronique du 27 septembre, Philippe Askenazy apporte son soutien au Président de la République qui souhaite redonner
du pouvoir d’achat aux Français en relançant la concurrence dans la grande distribution. L’histoire doit cependant nous inciter à la plus extrême prudence : lorsqu’il a voulu intervenir
sur ce secteur, l’Etat a généralement manqué sa cible et généré des effets pervers. Méfions nous donc d’une dérégulation qui pourrait provoquer des réactions non contrôlées.
Commençons par la réglementation de l’urbanisme commercial, la loi Raffarin qui, si l’on en croit Askenazy, aurait été
responsable du tarissement des créations de surfaces alimentaires. Si le flux de nouveaux mètres carrés s’est effectivement réduit, c’est bien plus en raison de la saturation du potentiel de
croissance que d’un cadre réglementaire qui certes a accru les coûts de transaction, mais s’est montré en réalité bien peu dissuasif, comme en témoigne la proportion des projets finalement
autorisés. Ce qui est en cause est moins le cadre réglementaire que le caractère peu « contestable » du secteur : assurer la compétitivité d’un réseau implique que celui-ci
atteigne d’emblée une taille importante pour bénéficier d’économies d’échelle. Eu égard à la densité du parc, l’entrée d’un nouvel acteur semble aujourd’hui impossible en dehors du rachat d’un
réseau existant. La libéralisation totale des ouvertures aurait certainement pour premier effet d’attiser la soif d’expansion des groupes en place qui ont du mal à se résigner à un régime de
croissance ralenti. Une sur-production de mètres carrés serait alors à craindre ; elle simulerait sans doute la concurrence mais risquerait aussi de produire des friches aux conséquences
difficiles à évaluer.
Venons-en maintenant à la réforme de la loi Galland qui vise à permettre la répercussion des marges arrière sur les
prix aux consommateurs. L’amorce du démantèlement de la loi Galland (la loi Jacob-Dutreil) a affectivement permis de redonner du mordant aux politiques tarifaires des hypers et des supers et de
baisser les prix des grandes marques. Le risque que comporte une accélération du processus de libéralisation des prix, avec le passage au « triple net », est qu’elle pourrait
atteindre son but : déclencher une guerre des prix. Certes, elle aurait un effet direct immédiat (somme toute modeste) sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Mais il convient
d’anticiper les effets indirects. Sur le commerce de proximité d’abord qui s’était redressé à la faveur de la loi Galland et qui aurait bien du mal à résister au creusement de l’écart de prix
avec les grandes surfaces de périphérie. L’intensification de la concurrence par les prix encouragerait les distributeurs à rechercher des gains de productivité pour nourrir leur compétitivité
sans laminer leur rentabilité. Or, ils disposent actuellement de technologies leur permettant d’envisager des économies substantielles : l’adoption massive du « self chekout » et
du « self-scanning » (en attendant la RFID) permettrait potentiellement du supprimer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de caissières. Aujourd’hui, les distributeurs déclarent
vouloir n’avoir qu’un recours modéré et progressif à ces technologies et recycler une grande partie de la main-d’œuvre ainsi libérée dans l’amélioration du service aux clients. Le déclenchement
d’une guerre des prix remettrait en cause ce scénario optimiste. On peut aussi craindre que les distributeurs resserrent encore leur pression sur les fournisseurs, lesquels pour résister à
l’asphyxie seraient à leur tour condamnés à la productivité voire à la délocalisation.
La grande distribution française semble, enfin, en train de négocier un virage structurel l’amenant à adopter une logique
plus servicielle, plus adaptée aux nouveaux modes de consommation (voir les dernières réalisations de Champion, Monoprix, ou le nouvel hyper de Géant Casino). Une dérégulation incontrôlée
fait courir le risque d’encourager les états-majors à renouer avec l’orthodoxie du « discount à la française » qui avait fait leur succès : des prix bas certes, mais au détriment
de l’emploi.