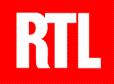Libération m’avait sollicité pour participer à un blog (en compagnie de Bruno Amable, Alexandre Delaigue et Peirre-Yves Géoffard) pendant la campagne
présidentielle (titre : La Campagne Déchiffrée). L’expérience continue avec un nouveau titre : “Les Eco-comparateurs”
et un nouveau sous-titre : “la vie économique française et le programme du gouvernement décryptés par des spécialistes”. Premier billet posté sur l’attractivité de la France. Je le poste
aussi ici, n’hésitez pas à réagir ici où là-bas.
Pour la cinquième année consécutive, Ernst & Young a présenté son étude sur l’attractivité européenne organisée selon deux axes : il s’agit
d’abord d’une mesure de l’image de l’Europe et de celle de ses concurrents perçue par 809 décideurs internationaux, et ensuite d’une analyse de la réalité des implantations internationales
recensées dans le « European Investment Monitor » d’Ernst & Young. J’avais commenté les résultats sur données 2005 dans ce billet. Je récidive aujourd’hui.
rattraper par ses concurrents », mais surtout pour la Tribune (€) : « Attractivité : la
France risque la relégation en deuxième division »… Damned, me suis-je alors exclamé, le problème doit être sérieux…
Et en effet, les chiffres sont édifiants :

La France, 2ème du classement en 2005, a dégringolé brutalement en 2006 à la … 2ème place, toujours derrière le Royaume-Uni, et toujours
devant l’Allemagne. En termes de créations d’emplois (20 509 emplois créés en 2006 dans l’hexagone), elle est 3ème derrière la Pologne (largement première : les PECO attirent
moins de projets, mais des projets de plus grande taille, plus intensifs en main d’œuvre) et le Royaume-Uni. On y apprend en outre que la France se caractérise par une « domination des
services aux entreprises et du secteur des logiciels (74 et 72 projets) » et qu’elle est « n°1 européen des implantations de fonctions industrielles ». Tout va mal,
donc…
Y a-t-il eu un bug dans la rédaction du titre de la Tribune ? Que nenni. Le titre se réfère non pas aux statistiques sur les projets effectivement réalisés,
mais à l’autre partie de l’étude, sur les discours des dirigeants. Pour ces derniers, si la France est appréciée pour son haut niveau technologique, son système éducatif et son système de santé,
elle serait pénalisée par « le niveau de croissance, le modèle social et l’environnement juridique et fiscal des entreprises » (la Tribune, p. 30). Marc L’Hermitte, associé chez Ernst
& Young, ne craint donc pas d’affirmer que « la France risque la relégation dans la deuxième division des pays attractifs » (même source). A moins, bien sûr, nous dit-on, qu’elle ne réponde aux deux premières exigences des dirigeants : en renforçant la flexibilité pour 47% d’entre eux, ou en simplifiant les procédures
administratives pour 44%.
Apparemment, ni les consultants d’Ernst & Young, ni les journalistes ne s’interrogent sur ce décalage entre discours et faits. Je pense qu’ils résolvent le paradoxe apparent
en considérant que les faits éclairent les tendances passées, alors que les discours anticipent sur les tendances futures. D’où la proposition suivante : jusqu’à présent, ça va, mais
attention, procédez aux réformes que l’on vous indique, sinon gare à vous.
Sauf que cette résolution du paradoxe ne tient pas trop la route. En effet, la rigidité supposée du marché du travail français et la complexité supposée de son administration ne
datent pas, me semble-t-il, de l’année 2005. On pourrait même poser l’hypothèse que les réformes économiques menées ces dernières années orientent plutôt le système français dans la direction
souhaitée par les dirigeants d’entreprise. Comment comprendre alors que l’attractivité du pays a été et reste bonne (dans les faits, pas dans les discours), en dépit de ces configurations
institutionnelles supposées néfastes? Les entreprises ayant investi en France seraient-elles donc à ce point irrationnelles? On peut s’interroger…
On peut s’interroger en se disant que c’est le mode de résolution du paradoxe qui n’est pas le bon. Hypothèse alternative, donc : les dirigeants
d’entreprises agissent en rationalité limitée. Ils développent, au fur et à mesure de leur activité, certaines représentations du monde (mon hypothèse pourrait être qualifiée de
Penrosienne). Représentations du monde plutôt convergentes, en raison de leurs interactions (au sein par exemple des instances patronales – le Medef en France), et parce qu’ils
partagent des sources d’information similaires (on peut supposer par exemple que les dirigeants français sont majoritairement abonnés au Figaro ou à la Tribune, qui relaient l’actualité
économique d’une certaine manière (cf. le titre de la Tribune supra), plutôt qu’à Libération ou à l’Humanité. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une hypothèse héroïque). Ils en viennent donc
à considérer qu’il existe un modèle optimal (forte flexibilité du travail, faible intervention de l’Etat, etc) et, logiquement, lorsqu’ils constatent que les caractéristiques du système
institutionnel français ne correspondent pas aux canons du modèle supposé optimal, ma foi, ils en déduisent logiquement que la France va souffrir en termes d’attractivité.
Ceci n’est pas nécessairement anodin : ces conventions partagées par les dirigeants d’entreprises peuvent influer sur leurs décisions. Si tous décident que la Chine est le nouvel Eldorado, et
vérifiant -ce qui est plutôt rassurant en incertitude radicale- que tous les autres dirigeants partagent le même sentiment, eh bien ils peuvent décider de s’y implanter, même si une analyse plus
poussée leur montrerait que ce choix n’est pas nécessairement optimal. Je ne dis pas que tous les investissements en Chine procèdent de cette logique conventionnelle, je ne dis pas qu’ils sont
nécessairement sous-optimaux, mais je pense sérieusement qu’elle explique certaines décisions d’investissement.
Conclusion? Il convient toujours de se méfier de l’analyse des discours. Non pas que leur analyse soit inutile : elle renseigne sur les représentations sociales des collectifs
d’acteurs, représentations qui influent ensuite (au moins partiellement, mais seulement partiellement : pour preuve le nombre de projets développés en France) sur leurs comportements. Mais il
convient de croiser l’analyse de ces représentations à l’analyse des faits économiques. On aurait pu souhaiter que la Tribune ou le Monde se livrent un tant soit peu à cet exercice, plutôt
que de prendre pour argent comptant les discours des dirigeants…