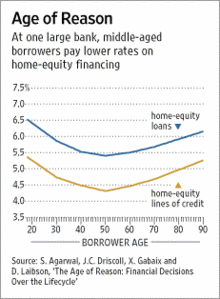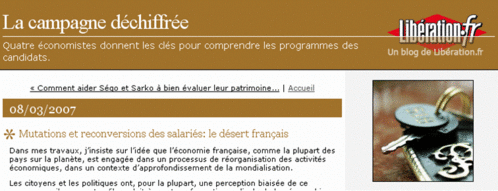Interview de François Bayrou dans Les Echos daté du lundi 26 mars 2007. A été évoquée notamment la question des délocalisations. Les questions sur ce sujet ont toutes été posées par Marie-Hélène Bourlard, presseuse et délégué CGT près de Valencienne. Extraits commentés…
MARIE-HÉLÈNE BOURLARD. Vous ne parlez pas beaucoup des délocalisations. Or cela fait des décennies qu’on allège les charges et que les délocalisations se poursuivent. Que comptez-vous faire pour régler cette question ?
Personne ne réglera le problème des délocalisations. Si quelqu’un vient à cette place et vous dit « J’ai la mesure qui va régler la question », il raconte des histoires. Moi, je ne veux pas raconter d’histoires aux gens. Je veux les aider. Qu’a- t-on comme possibilité ? A la vérité, il y en a deux. La première, c’est de réfléchir au coût du travail…
On aurait pu souhaiter que Bayrou recadre le problème, en évoquant le poids globalement faible des délocalisations. Bon, ceci dit, avec un conseiller spécial Mondialisation comme Arthuis… Sur le volet préconisation, Bayrou se focalise immédiatemment sur la question "coût du travail", ce qui n’est pas le problème essentiel.
M.-H. B.Quand on gagne 1.000 euros par mois comme moi, la priorité, c’est surtout d’augmenter les salaires.
Je pourrais aisément me rendre populaire à vos yeux en annonçant que je vais augmenter les salaires. Mais, dans une branche comme la vôtre, si vous augmentez le SMIC – comme certains le souhaitent -, vous avez une délocalisation immédiate. Et je ne connais pas un économiste de gauche qui soit en désaccord avec ça. C’est vrai que c’est dur de vivre comme cela ; je ne peux pas prétendre que ce soit bien payé ni même convenablement payé. Mais vous ne pouvez pas arrêter les délocalisations quand vous êtes un pays exportateur.
L’association hausse du SMIC – délocalisation est pour le moins discutable… Si la seule variable de choix était le différentiel de salaires, avec un rapport coût horaire du travail France-Chine de l’ordre de 30 pour 1, ce n’est pas une hausse du SMIC qui changera grand chose (ni une baisse du SMIC, d’ailleurs…).
Quand des économistes plaident pour un allègement des charges sur le travail peu qualifié, par exemple Salanié ici, ce n’est pas en accusant la mondialisation : "Le chômage s’est en conséquence particulièrement concentré sur les catégories moins qualifiées, et notamment les jeunes sans diplôme. Il n’y a là rien de bien mystérieux et la mondialisation n’est pas le principal ressort de cet effet, comme on l’entend parfois dire. Même si la France fermait ses frontières, les employeurs continueraient de conditionner leurs décisions d’embauche aux coûts du travail des différentes catégories de travailleurs." (souligné par moi. Voir aussi ici pour l’état des études empiriques sur le sujet et un avis plus nuancé que celui de Salanié sur l’intérêt des réductions de charge).
On peut compléter avec ce tableau repris par Askenazy, qui permet de bien situer la France par rapport à un ensemble de pays comparables (variable : coût horaire ouvrier, base 100 Etats-Unis) :

Conclusion d’Askenazy : "a. Il y a potentiellement une marge pour augmenter le coût travail en France (soit en bonifiant les salaires, soit en diminuant les allègements de charges, ce qui donnerait une marge de man?uvre au budget de l’Etat), b. Les difficultés de l’industrie française ne sont pas du coté du travail mais de l’incapacité de nos industriels à trouver leur place dans la division internationale du travail et à bénéficier du boom des économies émergentes, c. En tout état de cause, on peut douter que de nouveaux allègements de charge apportent autre chose qu’un effet d?aubaine"…
Sur la question compétitivité-coût de la France, je renvoie aussi à ce billet.
Il y a donc au moins un économiste de gauche qui est en désaccord avec ce que dit Bayrou… faudra les présenter.
M.-H. B.Instaurons des règles européennes !
La deuxième voie face à la mondialisation, c’est, en effet, que l’Europe accomplisse son travail pour que, au moins, la concurrence soit équitable. Qu’on ait la certitude que, quand on impose des règles aux uns en matière d’environnement, elles soient respectées par les autres. Qu’on essaie d’aller vers une harmonisation en matière sociale, qu’on protège ses sites, ses productions. Par exemple en s’intéressant au niveau des monnaies, parce que certaines – je pense à la monnaie chinoise – sont terriblement sous-évaluées. Le travail en Chine vaut 75 fois moins que le travail en France. L’action ne peut être que politique et européenne.
Mais il y a aussi des entreprises qu’une part de délocalisation sauve. J’ai visité à Marseille une PME de 60 salariés, leader européen dans le domaine des capteurs et régulateurs pour les moteurs Diesel de bateau, avec près de 20 % de parts de marché mondial. Si elle ne faisait pas la moitié de sa production en Tunisie, elle serait déjà morte. Il y a des délocalisations favorables et d’autres mortelles. Quand l’entreprise s’en va, c’est une perte sèche.
Sur la première partie, je crois deviner la patte d’Arthuis : si on souffre, c’est que la concurrence est déloyale… Bon, ok, le dumping fiscal et social, ca existe. Limiter les problèmes français à cet aspect est excessivement réducteur (je ne dis rien sur l’idée consistant à attendre que les pays pauvres s’alignent sur nos conditions de travail pour pouvoir commencer à exporter). Idem pour une explication en termes de taux de change. Plus généralement, cf. ce billet pour la peur de l’ouvrier chinois. Deuxième partie de la réponse plus surprenante, qui tranche avec les discours des autres candidats : les délocalisations peuvent sauver certaines entreprises. Suffisamment rare pour être souligné, ça mériterait des développements…
M.-H. B.Mais que faire dans ce cas ? A la fin de l’année, mon usine délocalisera, ça fera 147 chômeurs de plus, alors que LVMH, notre donneur d’ordres, a réalisé 1,9 milliard d’euros de bénéfice net en 2006. Il nous tue. Et qu’est-ce que vous faites ?
Et vous, qu’est-ce que vous faites ? La candidate à l’élection présidentielle que vous soutenez, qu’a-t-elle fait ? Le parti que vous soutenez, qui a été au gouvernement, qu’a-t-il fait contre les délocalisations ? J’ai vu, en Vendée, une entreprise qui fabrique des ordinateurs haut de gamme, pour les Airbus, les Boeing et même les trains de tige qui forent pour le pétrole. Entre 350 et 400 de ses salariés, sur un total de 500, sont issus des secteurs du textile et du cuir. Cette reconversion est une réussite.
Début de la réponse assez peu constructif, c’est le moins qu’on puisse dire. La suite est plus intéressante, car elle montre l’enjeu de l’accompagnement des salariés. Mais, là encore, on aurait aimé des préconisations (au moins une ou deux pistes) plus précises…
M.-H. B.J’habite dans le Nord, dans l’Avesnois. C’est une zone sinistrée. Il n’y a plus rien.
Peut-être peut-on implanter des entreprises nouvelles ? Je refuse de baisser les bras : je viendrai dans le sud de l’Avesnois.
François Bayrou viendra dans le sud de l’Avesnois : le sud de l’Avesnois est donc sauvé.
Bon, ce n’est ni vraiment pire, ni vraiment meilleur que ce qu’ont pu dire Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sur le sujet. Personnellement, j’en viens à me dire de plus en plus que ce n’est pas sur la base d’une comparaison des programmes économiques que je pourrais choisir entre les candidats… Ce qui m’embête encore plus, c’est que les problèmes économiques de la France ne semblent pas près d’être résolus…