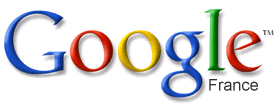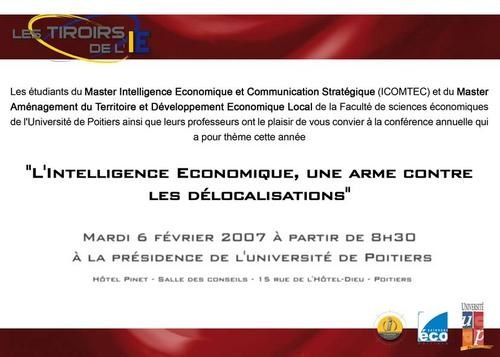Lorsqu’il s’agit de parler d’entreprise, les médias invitent souvent des chefs d’entreprises, à commencer par la "patronne des patrons", à savoir Laurence Parisot. Ce fut encore le cas lundi 6 février 2007 sur les ondes de France Inter. Non seulement on invite les responsables à s’exprimer sur l’entreprise, mais aussi, plus généralement, sur le fonctionnement du système économique et sur ce que devraient être les politiques économiques. A tel point que Laurence Parisot se propose de faire un exercice de pédagogie économique devant un aéropage de grands patrons, ou de commenter sur son blog les propositions de certains politiques (ici par exemple). A tel point, également, que certains responsables d’entreprise dénoncent la façon dont l’économie est enseignée dans les lycées, et se proposent de définir très précisément l’enseignement idéal (Pierre Bilger, par exemple – voir ma réponse sur mon blog et nos échanges dans les commentaires de son billet). D’où deux questions : les dirigeants d’entreprises sont-ils les mieux placés pour nous dire ce qu’est une bonne entreprise? Sont-ils également bien placés pour nous dire ce qu’est une bonne politique économique ou un bon enseignement d’économie? Quelques éléments de réflexion…
Les dirigeants d’entreprises sont-ils bien placés pour parler de l’entreprise?
Que les dirigeants soient interrogés pour parler d’entreprises, rien de choquant : ils sont à l’évidence bien placés pour pouvoir le faire. Le problème est que les médias ont tendance à réduire la figure éminement collective de l’entreprise à son seul dirigeant. Or, une entreprise est un collectif d’acteurs.
Concentrons-nous sur la figure dominante du capitalisme : les sociétés de capitaux (sociétés anonymes et sociétés anonymes à responsabilité limitée pour l’essentiel) qui assurent en France environ 80% de la création de richesses et d’emplois. Celles-ci se caractérisent par une dissociation entre les actionnaires, détenteurs du capital social de l’entreprise et les dirigeants, qui assurent au quotidien la gestion de l’entreprise. A minima, il n’y a donc pas qu’un collectif d’acteurs, mais deux : le collectif des actionnaires, d’une part, le collectif des dirigeants, d’autre part. Les objectifs de ces deux collectifs d’acteurs ne sont pas nécessairement les mêmes : des études réalisés dès les années 1960 (Williamson, 1963, "Managerial Discretion and Business Behavior", American Economic Rreview
par exemple) montrent que si les actionnaires ont un objectif de profit, les dirigeants ont comme objectifs prioritaires i) l’obtention de hauts revenus, ii) un besoin de sécurité, iii) un objectif de domination (statut, prestige, pouvoir) et iv) un objectif de compétences (le classement est hiérarchisé du plus au moins important). Et l’on sait, suite aux scandales Enron-Andersen, Parmalat, Worldcom, Vivendi, etc… que certains dirigeants, qui ont une meilleure information sur ce qui est fait dans l’entreprise, et qui disposent d’un pouvoir de décision délégué par les actionnaires, en profitent parfois pour atteindre leurs objectifs propres, ce qui conduit à léser les actionnaires.Toute la question de la gouvernance d’entreprise, telle qu’elle s’exprime en tout cas dans les rapports nationaux et internationaux, et telle qu’elle est mise en oeuvre dans les pays (loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, loi de sécurité financière en France, …), a pour objet de faire en sorte que cette divergence d’objectifs ne lèse pas les intérêts des actionnaires, considérés comme les vrais propriétaires de l’entreprise. Si l’on en reste à cette vision qualifiée de shareholder de la gouvernance d’entreprise, il conviendrait d’interroger dans les médias les représentants de ces deux collectifs…
On se doit aussi d’élargir l’analyse de la gouvernance d’entreprise, en prenant acte du fait que d’autres acteurs sont parties prenantes de l’entreprise (on passe alors à une vision qualifiée de stakeholder de la gouvernance d’entreprise) : le collectif des salariés (autres que les dirigeants), d’abord et le collectif des clients-fournisseurs, ensuite (voire l’ensemble des acteurs, potentiellement lésés par les externalités négatives que génèrent les entreprises ou au contraire bénéficiaires des externalités positives dont elles sont à l’orgine). On aboutit dès lors à une représentation plus complexe de l’entreprise, où quatre grands collectifs d’acteurs sont en interaction, les relations entre ces collectifs pouvant être qualifiées de rapports sociaux fondamentaux : rapport financier entre actionnaires et dirigeants, rapport salarial entre dirigeants et autres salariés, rapport marchand entre l’entreprise et ses clients-fournisseurs :
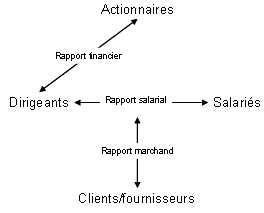
Selon ce schéma, l’entreprise est vue comme un système de coopération entre des acteurs porteurs de ressources, chacune des parties prenantes cospécialisant progressivement une partie de ses ressources lors du développement de l’activité. Qui, dès lors, doit parler de l’entreprise ? Qu’il s’agisse de parler d’un point particulier (rôle et place du salarié, du dirigeant, de l’actionnaire, etc…) ou qu’il s’agisse de parler de l’entreprise dans son ensemble, on se doit d’interroger, en toute logique, l’ensemble des parties prenantes.
Ajoutons que même un tel exercice (qu’on pourrait qualifier d’exercice de démocratie participative) n’est pas pleinement satisfaisant : on comprend bien que chacun des acteurs interrogés a une vision partielle et biaisée de l’entreprise, qu’il cherchera à défendre ses intérêts particuliers, au détriment, parfois, de l’intérêt général. Par exemple, demander à un dirigeant ce qu’il pense de la légitimité du niveau de rémunération des dirigeants est quelque peu sujet à caution. Pour faire image (image politiquement incorrecte, je le concède, je vois d’ici les commentaires), faut-il attendre de Pétain une analyse objective du régime de Vichy?
Thesmar et Landier tiennent des propos approchants dans leur dernier ouvrage :
D’où la nécessité d’interroger de manière complémentaire des experts, non partie prenante de l’entreprise. Je pense bien sûr à des économistes, gestionnaires, sociologues, historiens, juristes… spécialistes de la question. Curieusement, on les entends assez peu. Et lorsqu’on interroge un économiste, on se tourne plutôt vers des macro-économistes, rarement vers des spécialistes de l’économie de l’entreprise…
D’où la nécessité, également, que les politiques, porteurs théoriquement de l’intérêt général, se saisissent de la question, en proposant aux électeurs leur vision du monde et en son sein, compte tenu de l’importance des entreprises dans le processus de création de richesses et d’emplois, leur vision de l’entreprise. Dans cette perspective, on ne peut que déplorer la méconnaissance que la plupart des politiques ont de l’entité entreprise (méconnaissance particulièrement forte en France, ce que j’attribuerai notamment à un problème de formation économique quelque peu monolithique de nos élites).
Les dirigeants d’entreprises sont-ils bien placés pour parler d’économie?Les dirigeants ne parlent pas seulement de l’entreprise, ils se risquent souvent à parler de l’économie en général. Là encore, que chacun participe au débat, rien de plus naturel. La mode est, on le sait, aux citoyens experts. Qu’une partie de la population, en l’occurrence les dirigeants, soit considérée comme plus légitime, et soit donc plus souvent interrogée qu’à son tour, sur ce que devrait être une bonne politique économique, cela me semble moins naturel. Bien sûr, là encore, leur responsabilité n’est que très partielle : elle résulte plutôt de la tendance des médias à s’en référer trop exclusivement à leur analyse, et à la tendance des politiques à déserter le terrain (Cf. par exemple cet article des Echos). Que les dirigeants occupent l’espace qu’on leur laisse est parfaitement rationnel.
On peut cependant parfois s’interroger sur la pertinence de leurs propos… Focalisons-nous d’abord sur la leçon d’économie de Laurence Parisot. Elle commence par nous montrer que le taux de croissance de la France, par rapport à celui des Etats-Unis et du Royaume-Uni, était significativement supérieur pendant les années soixante-soixante dix, l’écart s’étant ensuite réduit, puis la relation s’étant inversée, sur les périodes plus récentes. Elle dresse donc un constat, mais un constat d’emblée biaisé : pourquoi comparer la France au Royaume-Uni et aux Etats-Unis? Pourquoi pas à l’Allemagne, au Japon, ou d’autres pays encore? Passons.
Deuxième temps, un graphique montrant la croissance du poids des prélèvements obligatoires dans l’économie française sur la même période. Pourquoi cet indicateur? On ne le saura pas. Laurence Parisot fait un lien implicite, qui visiblement n’a plus à être démontré, entre la "dégradation" (il y aurait beaucoup à en dire, mais là n’est pas le propos) des performances françaises et la montée de ces prélèvements. Exercice plutôt curieux, puisque n’importe quelle courbe d’allure croissante pourrait faire l’affaire. La montée de la part des travailleurs pauvres par exemple. Le nombre d’automobiles par habitant. L’évolution de l’activité solaire, pourquoi pas…
Plus loin elle récidive avec un exercice du même genre, en comparant le nombre d’heures travaillées de quelques pays. Elle montre notamment que ce nombre est supérieur en Suède, en insistant sur le fait que la Suède est prise comme modèle par les politiques. Mais là encore, pourquoi ces pays et pas d’autres?
Si elle avait retenu le Danemark dans son échantillon (autre pays souvent pris en exemple, plus souvent que la Suède, peut-être), elle aurait constaté que le nombre d’heures travaillées y est inférieur à ce que l’on observe en France (cf. ce billet, deuxième tableau)… De plus : quelle lien peut-on faire entre le nombre d’heures travaillées et la croissance? Rien sur le sujet.Des biais évidents de sélection, donc ; des tentatives très approximatives de corrélation sans aucune réflexion sur les liens de causalité, également : rien qui ressemble de près ou de loin à un exercice de pédagogie économique. A moins de considérer que la pédagogie consiste à montrer ce qu’il convient de ne pas faire…
On peut se dire que les dirigeants français ne sont peut-être pas de bons exemples. On peut alors s’en remettre au meilleur d’entre les meilleurs : Bill Gates. Celui-ci déclara lors d’une
conférence à Hanoï "with the internet having connected the world together, someone’s opportunity is not determined by geography" (trouvé via Econoclaste). Proposition qui semble frappée du coin du bon sens… mais qui est largement démentie par tous les économistes s’intéressant à la géographie des activités (voir par exemple ce document (en), ou ce que j’avais dit, sur une thématique approchante, de l’effet TGV) : la géographie n’est pas morte avec l’internet, elle semble au contraire compter de plus en plus, mais sous des formes renouvelées…Conclusion? Les dirigeants (certains d’entre eux, en tout cas, et pas les moins influents) sont parfois de mauvais économistes. Mais qu’ils se rassurent : la réciproque est au moins aussi vraie.