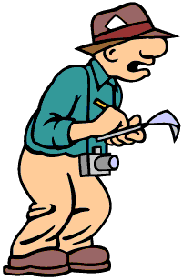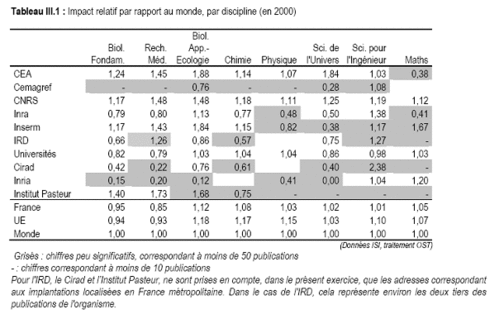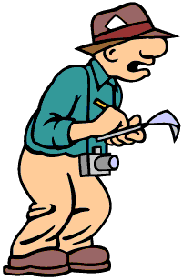
Alain Perez est journaliste aux Echos. Il vient de rédiger une série d’articles formidables autour de la recherche mondiale et de la place de la France dans le domaine. En voici les grandes lignes.
Premier article, lundi 8 janvier 2007 : « la science tourne a l’heure américaine ». S’appuyant sur le Science Citation Index, que l’on appelle aussi l’indice d’impact, et qui mesure le nombre de citations associées à un article, il affirme que « la France affiche de piètres résultats ». Certes, en nombre de citations, elle est à la 5ème place mondiale (il y a beaucoup de chercheurs français). Mais rapporté au nombre de publications, l’indice tombe à 9,91, contre 14,05 pour la Suisse (je ne sais pas si Johnny publie souvent. Si oui, on peut craindre que la France perde encore des places…), 13,36 pour les Etats-Unis, 11,76 pour l’Angleterre et 10,36 pour l’Allemagne.
Pourquoi de tels résultats ? « pour de nombreux experts (on n’a pas de nom dans son article, ni de référence plus précise…) le système français basé sur l’évaluation endogamique des travaux et la distribution récurrente de crédits publics non incitatifs est responsable de cet assoupissement ». La messe est dite. Pas beaucoup plus d’explications pour lundi.
Mardi, les choses se précisent. L’article est titré « France : la créativité scientifique en panne ». L’article commence par ces propos « un bilan tellement faible qu’on a du mal à le croire ». De qui ce commentaire ? Alain Perez nous dit que « ce commentaire a été arraché sous couvert d’anonymat »… Reprise des chiffres de la veille : avec un ratio de 9,91, la France navigue au-delà de la 20ème place mondiale, loin derrière, la Suisse, les Etats-Unis, etc…
Alain Perez concède qu’il existe de grandes disparités selon les disciplines : les mathématiques, les sciences de la terre et la physique tiennent leur rang, mais il insiste plutôt sur d’autres disciplines qui « plongent dans les profondeurs ». Il tire ensuite à boulet rouge sur l’Inria (Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique), dont les budgets n’ont cessé de progresser, mais qui a l’indice d’impact le plus faible des vingt premiers centres mondiaux de la discipline.
Il en remet ensuite une couche sur les raisons de ce déclin, en commençant par évacuer sans autre forme de procès d’éventuels opposants : « Selon les tenants de la pensée unique, la recherche publique ne souffre que de deux maux : un manque chronique d’effectifs et des crédits insuffisants ». Toujours pas de nom ni de source. Ce sont ensuite les syndicats qui sont accusés de refuser tout changement. S’ensuivent quelques chiffres montrant que d’autres pays dépensent moins (en pourcentage du Pib) et sont mieux classés, ainsi qu’une reprise des propos de Jean-François Dehecq, président de l’Association nationale de la recherche technique (ANRT), qui considère qu’il y a « trop de monde dans la recherche publique au regard des moyens que l’Etat peut y consacrer ».
Le pompon, c’est pour mercredi… Alain Perez commence par citer les propos de Sarkozy, qui plaide certes pour un accroissement de l’effort de recherche, mais à condition que cela s’accompagne d’une logique de financement sur projets, et que les chercheurs à fort potentiel puissent voir leurs revenus évoluer plus vite. Bref, un peu de rémunération au mérite. Toujours sans citer personne, Alain Perez nous dit qu’avec de telles déclarations, Nicolas Sarkozy va « ruiner son image dans la communauté scientifique hexagonale », puis qu’il « aggrave son cas en démolissant un autre tabou [la rémunération au mérite] », enfin, en affirmant que « c’est sûr, aucun des syndicats de chercheurs ne votera Sarkozy à la présidentielle ». Il affirme ensuite que la communauté scientifique vit dans la hantise de l’inégalité et de la précarité, que tout ce qui s’éloigne du « système de reconduction automatique et bienveillante de la manne publique » est perçu comme une dérive ultralibérale et une régression sociale, et que, pour les chercheurs français, « seul le doux oreiller de l’argent public serait compatible avec la recherche scientifique ».
Et là, apothéose, Alain Perez nous dit : « En fait, seule une minorité de chercheurs tient ce langage radical, qui semble sorti d’un autre âge » !!! Il passe un tiers de l’article à dénoncer les prétendus discours des chercheurs, sans que jamais, j’insiste, il ne produise un seul élément permettant de corroborer ses propos, pour finir par dire que, finalement, une minorité de chercheur tient ce langage radical, langage que, jusqu’à preuve du contraire, il est le seul à avoir tenu!
Mais , ouf !, c’est pour mieux se rattraper ensuite : « mais le discours de ces « ultras » très remuants pèse sur les direction des établissements » et, en gros, empêche toute réforme… Toujours pas de nom, toujours pas de source, de toute façon, si c’est écrit, c’est que c’est vrai…
Bon, je résume les trois premiers épisodes : sur la base du Science Citation Index, la recherche française est médiocre et déclinante. Cela s’explique par le fait que la recherche est noyautée par une minorité agissante qui contrôle les syndicats et empêche toute réforme.
jeudi 11 janvier. Dernier épisode de la série. Et là, ce n’est plus la recherche publique, mais la recherche des entreprises privées qui est analysée. Même démarche : on commence par présenter des résultats statistiques en s’appuyant sur un ou deux indicateurs permettant de mesurer l’effort de recherche des entreprises privées. On apprend que « dans tous les pays concurrents de la France la part des financements privés (…) est largement supérieure ». Mais cette fois, Alain Perez ne parle pas de "piètres résultats", il ne dit pas "qu’on a du mal à y croire", non : il parle de « résultats honorables » ! Pourquoi ? Parce qu’il a une bonne explication derrière :
Cette densité technologique, variable selon les secteurs, explique en grande partie les écarts. Dans la pharmacie, près de 23 % des effectifs sont affectés à des travaux de R&D. Dans le BTP ou les biens de consommation, ce ratio est inférieur à 2 %. " La dépense privée de R&D d’une économie donnée, qu’elle soit exprimée en volume ou en part de la valeur ajoutée, est fortement conditionnée par sa structure sectorielle ", souligne le rapport Futuris. En France, la production agricole et les industries agroalimentaires qui sont d’importants bassins d’emploi et de gros générateurs de chiffre d’affaires sont de petits acteurs en matière de dépenses de recherche et d’emplois scientifiques.
De même, le rapport entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les travaux de développement varient considérablement selon les branches. Alors que la chimie et la pharmacie sont preneurs de percées conceptuelles fondamentales pour ouvrir de nouvelles pistes, l’automobile " se contente " le plus souvent de travaux de développement technologique. Pour toutes ces raisons structurelles et historiques, la recherche industrielle française est donc moins bien placée que ses concurrents directs.
Très bien. Ce ne sont donc pas de méchants patrons voyous, de vilains actionnaires, ni de puissantes minorités contrôlant les syndicats patronaux qui sont désignés comme responsables de la situation. Ca ne serait pourtant pas très difficile de développer une argumentation de cet acabit, je vous le garanti. Avec, idem, des citations sans nom d’auteur et sans indication de source, bien sûr. Et quelques éléments à charge, genre : « le poids croissant des actionnaires favorise le court-termisme, et n’incite pas à investir dans l’innovation », m’a déclaré un patron influant sous couvert d’anonymat. Vous voyez le genre. Bref, non, ce n’est pas ça, le problème résulte d’effets de structure de spécialisation. Et je suis plutôt d’accord avec cette analyse.
Sauf que, là où il y a comme qui dirait un problème, c’est qu’Alain Perez ne s’est qu’à peine interrogé sur l’existence de tels effets de structures côté recherche publique… Or, si on regarde un peu dans cette direction, on s’aperçoit qu’il y a beaucoup à en dire. En s’appuyant sur les propos de Laurence Ertele, de l’OST, par exemple (ce qui a du sens, puisque c’est un travail de l’OST qui est la source principale des articles du journaliste) :
Cet indice d’impact est de fait très sensible à l’effet disciplinaire : ainsi les publications dans le domaine des sciences du vivant sont bien plus citées que celles en physique ou en mathématiques. Il convient donc d’être très attentif aux spécialisations d’un pays pour l’interpréter : une moindre spécialisation en biologie fondamentale va mécaniquement diminuer l’indice global (ce qui correspond à la situation française).
Il convient également, là encore, d’examiner, discipline par discipline, les évolutions : en biologie appliquée, l’indice d’impact est devenu très élevé, ceux de la recherche médicale et de la biologie fondamentale sont faibles en France bien que sensiblement égaux à la moyenne européenne. S’il y a un regard à porter en première intention, il serait donc sur les sciences du vivant en France ; leur part baisse légèrement et leur indice d’impact ne progresse guère pour un secteur qui est très visible et porteur. Si on ne peut parler de déclin (les évolutions ne sont pas statistiquement significatives), on peut évoquer leur stagnation. En somme, la France demeure peu spécialisée dans un domaine d’avenir.
Alain Perez aurait pu également regarder plus précisément les publications de l’OST, par exemple celle-ci, qui présente des résultats par institution et par domaine plutôt hétérogènes (dans le tableau, les chiffres pour le monde sont par définition égaux à 1. Un indice supérieur à 1 équivaut donc plutôt à un bon positionnement et réciproquement) :
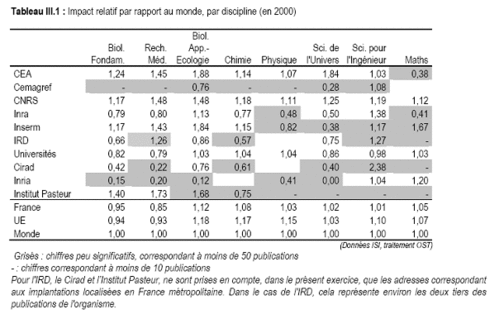
Il aurait pu également s’interroger sur la pertinence de l’indicateur (l’Allemagne a un indice d’impact plus faible que le Royaume-Uni, mais elle dépose plus de trois fois plus de brevets), sur des effets linguistiques (il y a pas mal de revues françaises, non incluses dans l’ISI, d’où un biais. Idem pour l’Allemagne, d’ailleurs), sur le pourquoi de la hausse du poids de la France dans les publications mondiales entre 1993 et 1999 avant la baisse entre 1999 et 2004 (le problème semble localisé à la fois dans l’espace des disciplines et dans le temps), etc…
Pour conclure, que l’on me comprenne bien. je ne dis pas que tout va bien dans la recherche publique et qu’il n’y a pas matière à évolutions. Mais ce n’est certainement pas en délivrant un diagnostic partiel, biaisé idéologiquement et non argumenté, de l’état de la recherche publique et de ses dysfonctionnements que l’on fera avancer les choses. Je me demande dans quelle école de journalisme a été formé Alain Perez… Vu son niveau, sans doute dans une école publique…
PS : le lecteur averti aura remarqué que j’ai "piqué" le titre d’une rubrique récurrente du blog de Brad DeLong (
Why oh why can’t we have a better press corps?).