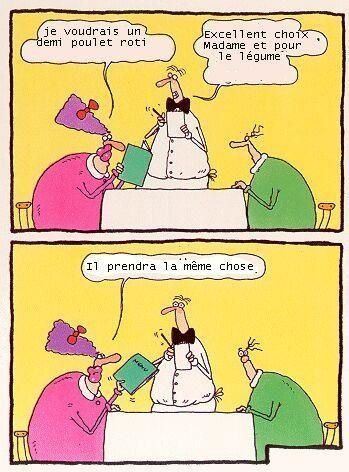J’avais évoqué dans un article précédent la question des coûts cachés : une entreprise s’interrogeant sur la meilleure solution entre délocaliser ou rester en France doit comparer non seulement le différentiel de coût du travail, mais aussi les différentiels de productivité, ainsi que les coûts de coordination sur les deux territoires :
* les coûts de la coordination à distance avec le sous-traitant étranger (problèmes éventuels de délai, de qualité, de fiabilité, de coût de transport, d’assurance, etc.). La non prise en compte de ces coûts par les entreprises explique largement les échecs rencontrés par certaines entreprises suite à leur engagement à l’international,
* les économies sur les coûts de la coordination que l’on peut réaliser en réorganisant localement le processus productif via, notamment, l’engagement dans la lean production (cf. l’article déjà cité).
Or, il semble que, sur ce dernier point, des progrès puissent être faits en France : l’Usine Nouvelle n°3032 du 23 au 29 novembre 2006 indique par exemple que dans l’automobile, 70% des problèmes de qualité constatés sur les véhicules sont localisés chez les sous-traitants.
Dans le même article, l’Usine Nouvelle développe un exemple intéressant de réorganisation locale. Il concerne l’entreprise Tokheim, fabricant de pompes à essence de Grentheville (Calvados) et son sous-traitant MPI, fournisseur de pièces en fonte. L’objectif : « réduire de 35% le prix de revient des 110 pièces produites par jour pour mettre le sous-traitant de Vire (Calvados) au niveau des concurrents chinois », ceci grâce au lean manufacturing
La méthode : formation des salariés afin d’accroître leur polyvalence, réaménagement de l’espace de travail, redéfinition du rôle des opérateurs, etc…
Le résultat : en juillet (l’opération a débuté en mars), l’objectif est atteint à 80%, le prix de revient par pièce ayant baissé de 20%.
D’autres cas sont évoqués dans l’article, notamment celui de l’équipementier de l’aéronautique DCN qui, en trois mois, a fait reculé la non-qualité chez ses sous-traitants de 15%, et parvient à gagner 400 000 euros par frégate construite. L’entreprise Delphi, autre exemple, est parvenu à faire « chuter les temps de changement d’outils chez l’un de ses sous-traitants de 5h à 1h20 ».
Solution efficace, donc, mais qui n’est pas sans soulever d’autres questions ou problèmes : on peut d’abord se demander qui récupère les gains de la réorganisation. L’article de l’Usine Nouvelle parle de « partage des gains ». Le responsable de Delphi affirme également « nous partageons les bénéfices ». On peut douter de la généralité de ce partage, compte tenu des rapports de force asymétriques entre donneurs d’ordre et sous-traitants. On remarque ensuite que les sous-traitants n’ont pas le choix (ce qui est à relier au point précédent), l’Usine Nouvelle citant le cas d’une entreprise ayant perdu son marché pour avoir refusé les services du consultant de son donneur d’ordre. On peut s’interroger enfin sur les conséquences en termes de condition de travail sur les salariés des différents sites.
Bref, la réorganisation sur place n’est pas la solution universelle à tous les problèmes, mais c’est sans conteste une piste à développer, d’autant plus quand le responsable de MPI affirme « nous nous sommes remis en question sur d’autres postes (…) et certains clients, déçus par les pays Low Cost, reviennent vers nous avec une philosophie proche de celle de Tokheim ».
Ceci n’est pas sans conséquence en termes d’action publique : nombre de PME pourraient sans doute bénéficier d’une réorganisation, mais la plupart n’ont ni les moyens, ni le temps de réfléchir à cette réorganisation. On peut dès lors se demander si un travail d’interfaçage ne pourrait pas être initié par certains acteurs locaux afin de les accompagner dans cette direction. Il s’agirait en quelque sorte de réfléchir non seulement à la question de la sécurisation des parcours professionnels des salariés, mais aussi à ce que j’appellerai la sécurisation des parcours organisationnels des entreprises, notamment des PME indépendantes.