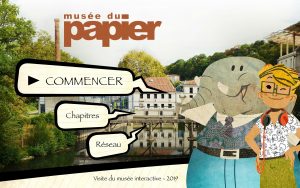En ce jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018, s’est tenu à la Cité la troisième édition des Rencontres nationales de la bande dessinée. Sous le titre bande dessinée et cinéma : du dessin à l’écran, l’édition 2018 est consacrée au phénomène des transpositions de bandes dessinées à l’écran.
Au cours de cette rencontre nous avons eu la chance d’assister à une intervention d’Harry Morgan, théoricien de la bande-dessinée, romancier et auteur de bande-dessinée français. Sous le thème « De Buck Rogers à Barbarella : la science-fiction de la case à l’écran », Harry Morgan nous explique les raisons pour laquelle il a choisi comme adaptation cinématographique les bandes dessinées de science-fiction Buck Rogers et Barbarella.
Tout d’abord, à l’instar de Buck Roger, Barbarella est une adaptation fidèle d’une bande dessinée. Mais, elles ont un point commun, c’est d’avoir reçu un accueil mitigé de la part des critiques. De plus, Harry Morgan souligne l’avantage de l’univers de science-fiction qui est un univers de pure imagination, il n’y a donc aucun risque de ressemblance accidentelle. Ainsi, par sa présentation Harry Morgan soulève plusieurs questions.
Quelles peuvent être les raisons de se détacher d’une bande-dessinée pour en faire une adaptation cinématographique ?
Buck Rogers in the 25th Century : un film produit par Glen A. Larson en 1979
Publié pour la première fois dans un journal le 7 janvier 1929 sous le nom de « Buck Rogers in the Year 2419 A.D », Buck Rogers est plongé dans un sommeil latent en 1929 après avoir inhalé des vapeurs d’une mine abandonnée. Quand il se réveille 500 ans après, soit en 2419, il fait la connaissance de Wilma Deering qui lui apprend que l’Amérique est envahie par les Mongols. L’Amérique des années 20 qu’il a connu est devenue une Amérique vieillie de 500 ans mais qui bénéficie de 500 ans de progrès technologique avant notamment les premiers pistolet à rayon laser désintégrateur.

Pour son adaptation cinématographique, l’enjeu était de coller parfaitement au genre de science-fiction qui connaissait un succès retentissant depuis 1977 avec la sortie du film « Star Wars : La Guerre des Etoiles ». Buck Rogers ne se réveille pas 500 ans après en Amérique mais au milieu de l’espace où après un phénomène inattendu il se fait cryogéniser. Attendre 1979 est également une date clé puisqu’il s’agit de l’anniversaire des 50 ans de la première publication du comic strip. La production de cette adaptation cinématographique a privilégié des enjeux commerciaux, au détriment même de la nature de la bande dessinée originale.
Pourquoi la retranscription fidèle de la bande-dessinée Barbarella n’est pas synonyme de bonne adaptation cinématographique ?
Barbarella : un film produit par Roger Vadim en 1968

Créée en 1962 par Jean-Claude Forest et parue dans les pages du V Magasine, Barabarella raconte les aventures d’une terrienne en exil qui explore les planètes de la galaxie.
Le film ne pouvait pas être plus fidèle à la bande-dessinée. La ressemblance frappante entre les acteurs et les personnages, l’intrigue, les décors, le scénario, tous les éléments y sont.
Mais, est-ce que cela suffit pour que cela fonctionne ?
A sa sortie, le film a reçu un avis mitigé le qualifiant par la presse anglaise de camp. Associé souvent au terme kitch, camp est défini comme quelque chose de tellement mauvais, que la seule réponse que l’on puisse faire c’est d’en rire. Une des principales raisons de cette qualification est dû à la maladresse de la retranscription de la narration qui, chez Forest, est le détachement ironique. Ainsi, dans le film, le second degré mal maîtrisé et volontairement exagéré qui ne fait qu’accentuer l’effet d’auto-parodie et fait donc cette adaptation cinématographique un échec.
Harry Morgan nous montre la difficulté de créer avec les moyens du cinéma une narration qui produise le même effet que la bande-dessinée. Ainsi, adapter une œuvre fidèlement avec l’exemple de Barbarella ou s’en détacher avec Buck Roger ne garantit en rien une adaptation réussie.
On pourrait alors se demander s’il existe une méthode parfaite pour faire d’une bande-dessinée une bonne adaptation cinématographique ? Malheureusement, il n’en existe pas !
Cependant, Sin City, Largo Winch, The Avengers, Snowpiercer… Il existe des adaptations cinématographies de bande-dessinées qui ont reçu un avis très favorable et qui sont devenus LES références en matière d’adaptation cinématographique. Alors quelle meilleure idée que de demander à John Whedon -réalisateur de deux films qui font partie des dix plus gros succès commerciaux de l’histoire du cinéma : Avengers et Avengers : l’Ere d’Ultron- de dévoiler son secret !
“It’s capturing the essence of the comic and being true to what’s wonderful about it, while remembering that it’s a movie and not a comic.” Sa réponse, bien qu’apparente évidente, devrait être entendue par tous ceux qui se sont déjà confrontés à l’adaptation cinématographique de bandes dessinées.
Par Yvanilde PANONT, étudiante en M2 MPJ