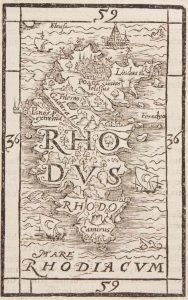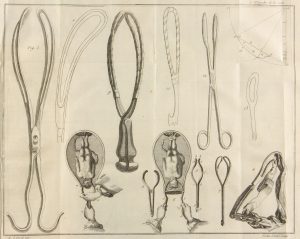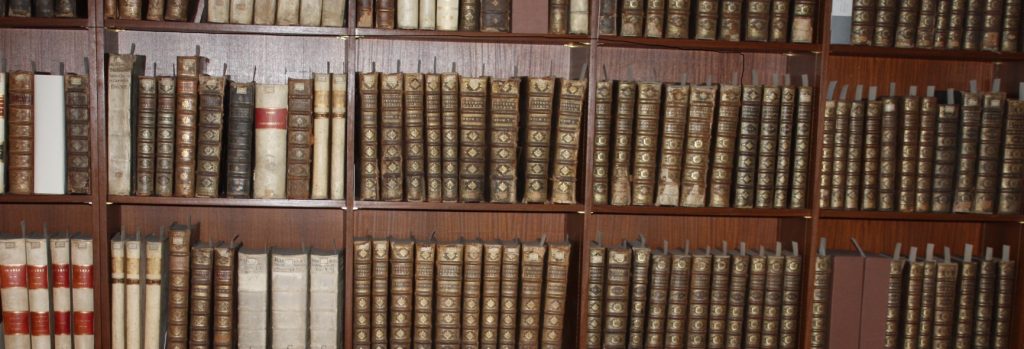Lucerna inquisitorum hæreticae pravitatis / Bernardo da Como. – Venise : Marco Antonio Zaltieri, 1596 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, XVI 795)
La prochaine Heure du Livre ancien, programmée au Fonds ancien les lundi 10 avril à 18h et vendredi 14 avril à 12h, sera consacrée aux marques d’imprimeurs-libraires. De quoi s’agit-il ?
Du colophon à la page de titre
Les marques de libraires et d’imprimeurs apparurent peu après l’invention de l’imprimerie. Placées sous le titre ou à la fin du livre, elles pouvaient être un simple signe analogue à celui que les imprimeurs mettaient sur les ballots de livre qu’ils expédiaient ou évoquer l’enseigne de l’imprimeur. Les premiers éléments de l’adresse, comme les lieu et date de l’impression, le nom de l’imprimeur-libraire, commencèrent à apparaître sous cette marque, sur la page de titre, à l’extrême fin du XVe siècle, alors qu’ils étaient jusque là placés à la fin de l’ouvrage, au colophon, selon l’usage en cours dans les manuscrits. Les marques permettaient de bien identifier l’imprimeur-libraire et les imprimés qu’il réalisaient. C’était également un moyen de lutter contre la contrefaçon. Elles se transmettaient souvent pour tout ou partie aux héritiers. Lire la suite