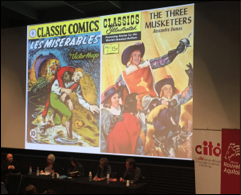Retour sur ces deux jours et focus sur la table ronde du vendredi 6 octobre 2017 – 17h15 ‘’À l’étranger‘’
 Du 5 au 6 octobre 2017 se tenaient à Angoulême les Rencontres Nationales de la Bande Dessinée, rassemblant professionnels du milieu de l’édition, auteurs et dessinateurs, académiciens, étudiants passionnés et autres néophytes curieux.
Du 5 au 6 octobre 2017 se tenaient à Angoulême les Rencontres Nationales de la Bande Dessinée, rassemblant professionnels du milieu de l’édition, auteurs et dessinateurs, académiciens, étudiants passionnés et autres néophytes curieux.
Au fil des jours et des conférences, un fois de plus Angoulême a su justifier son titre de capitale internationale de la bande dessinée. C’est au travers de plusieurs interventions et de différents angles d’approche que les auditeurs ont pu durant ces deux jours prendre conscience de l’impact de la bande dessinée dans de nombreux domaines tels que l’art, l’éducation ou encore les sciences humaines ainsi que de son caractère fédérateur.
Du processus d’artification de la bande dessinée appuyé par les théories sociologiques de Nathalie HEINICH jusqu’à sa valorisation au sein de l’éducation artistique et culturelle, il est aujourd’hui impossible de reléguer la bande dessinée au rang de simple activité de divertissement, puisque l’ensemble des conférenciers nous a prouvé qu’elle est désormais reconnue comme un réel instrument d’éducation et qu’elle est devenue une véritable forme d’art.
Focus sur la dernière table ronde du vendredi, ‘’À l’étranger ‘’, encadrée par Jean-Philippe MARTIN, où une fois de plus le rôle de la bande dessinée dans l’apprentissage était à l’honneur. Menée par Jean-Pierre MERCIER (Conseiller Scientifique de la Cité de la bande dessinée), par Edmond BAUDOIN (auteur et ancien professeur de bande dessinée), Ingeborg RABENSTEIN-MICHEL (spécialiste de la bande dessinée) et par Anouchka De OLIVEIRA (chargée de projets au département langue française, livre et savoirs de l’Institut Français), cette conférence nous a éclairé sur la portée éducative de la bande dessinée, et ce au travers d’exemples concrets.

L’intérêt éducatif de la bande dessinée n’est plus à prouver, les conférences précédentes l’ont bien démontré. Mais pour étayer ceci, la dernière table ronde des Rencontres nous invite à élargir notre horizon et prend appuie sur des exemples concrets d’utilisation de la bande dessinée dans l’éducation non plus en France mais dans le monde entier.
C’est Jean-Pierre MERCIER qui ouvre le débat et rappelle que depuis déjà plusieurs décennies, les Etats-Unis utilisent la vulgarisation des grands classiques de la littérature (surtout occidentale) pour les transposer dans l’univers de la bande dessinée, dite ‘’comics‘’ dans la culture américaine. Cette vulgarisation, permet selon lui un accès au plus grand nombre à la culture.
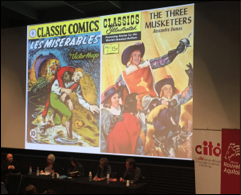 Plus loin que la simple vulgarisation de la littérature, la bande dessinée sait revêtir un aspect militant et éducatif, et devient alors un réel outil, vecteur d’apprentissage, appelé aux Etats-Unis les ‘’ Edu-comics ‘’. La largeur des thèmes abordés par les bandes dessinées aux Etats-Unis s’étend même jusqu’à l’Histoire. Et d’expérience, Jean-Pierre MERCIER nous affirme qu’une bande dessinée, qui par sa nature reste un support cours et qui se doit synthétique, peut tout à fait si cela est correctement orchestré, transmettre un savoir correct et fidèle à la vérité au même titre qu’un livre d’histoire.
Plus loin que la simple vulgarisation de la littérature, la bande dessinée sait revêtir un aspect militant et éducatif, et devient alors un réel outil, vecteur d’apprentissage, appelé aux Etats-Unis les ‘’ Edu-comics ‘’. La largeur des thèmes abordés par les bandes dessinées aux Etats-Unis s’étend même jusqu’à l’Histoire. Et d’expérience, Jean-Pierre MERCIER nous affirme qu’une bande dessinée, qui par sa nature reste un support cours et qui se doit synthétique, peut tout à fait si cela est correctement orchestré, transmettre un savoir correct et fidèle à la vérité au même titre qu’un livre d’histoire.
Il souligne alors le pouvoir de la bande dessinée à convaincre, en rappelant que ce support a su se transformer aux Etats-Unis en véritable outil de communication pour enrôler de nouvelles recrues, grâce aux manuels de maintenance de matériel militaire réalisé pour l’armée américaine.
Il définit alors pour finir la bande dessinée comme un média à la croisée du militantisme, de l’éducation et de l’art.
C’est ici qu’intervient Ingeborg RAVENSTEIN-MICHEL, qui rebondit sur les limites du caractère militant et communicant de la bande dessinée. En prenant exemple d’une série de 14 bandes dessinées commandées et diffusées il y a peu par l’Union Européenne elle-même, elle nous met en garde. Utilisant le terme de ‘’Media Séducteur ‘’, elle rappelle que si la bande dessinée peut effectivement devenir un outil de communication, il est bon de respecter une certaine éthique et une justesse dans les informations transmises aux lecteurs.
Cette série de bandes dessinées proposées par L’UE, abordant des sujets sérieux, d’actualité, avaient finalement pour but d’accroitre le nombre de militants et de volontaires désireux de s’engager pour des causes humanitaires. Cependant, derrière l’apparence divertissante de la bande dessinée, les sujets abordés (de la famine en Afrique aux guerres au Moyen-Orient) manquaient de réalisme dans les graphismes et minimisaient les risques, ce qui pouvaient biaiser l’appréciation des futurs militants. Ceci amenant la bande dessinée dite communicante, à la limite de la propagande.
Lorsqu’Anouchka De OLIVEIRA prend la parole, c’est pour montrer le fort potentiel éducatif de la bande dessinée. Après une rapide présentation du Département langue Française, livre et savoir de l’Institut Français, elle en explique les missions ; rendre le français attractif pour les jeunes générations et développer, dans cette optique, des dispositifs de formation et d’apprentissage innovants. À ce titre, elle nous présente une application foncièrement novatrice pour l’enseignement des langues et développée par l’Institut Français, LingoZING. Grâce à cette application il est possible d’améliorer son niveau de langue (en français, espagnol, portugais et anglais pour l’instant) au travers de la bande dessinée, en enrichissant son vocabulaire par la lecture et en corrigeant et/ou améliorant sa prononciation.
Il s’agit finalement ici de détourner la ‘’contrainte‘’ que représente un apprentissage traditionnel et de le transposer vers un média que les jeunes générations affectionnent plus particulièrement. C’est bien là que l’on a une preuve réelle (aux vues du succès de cette application) que la bande dessinée, si elle est certes un divertissement, peut devenir un véritable outil d’éducation. Pour conclure, Anouchka DE OLIVEIRA nous rappelle à juste titre que plaisir et éducation ne doivent être dissociés ; car en effet, lorsqu’on prend du plaisir à apprendre, on apprend par plaisir et non plus par obligation.
C’est Edmond BAUDOIN qui clôt cette table ronde et qui, pressé par le temps, nous propose rapidement son point de vue sur l’intérêt d’un système éducatif alternatif, entre deux anecdotes sur son expérience de professeur en bande dessinée au Québec. D’une certaine manière, son propos rejoint les allégations d’Anouchka De OLIVEIRA et affirme que de par son expérience, il est nécessaire de se diriger vers un système, vers des moyens d’enseigner aux jeunes générations qui soient alternatifs et innovant par rapport aux méthodes d’enseignement plus classiques.
Le mot de la fin pour Pierre LUNGHERETTI, directeur général de la Cité Internationale de la Bande Dessinée, qui clôt ces deux jours de rencontres par une synthèse des informations transmises tout au long des conférences.
 La bande dessinée est aujourd’hui reconnue comme un art et un vecteur efficace de transmission des savoirs. Preuve en est la présence des Ministres de la Culture et de L’Éducation Nationale, (Françoise NYSSEN et Jean-Michel BLANQUET) lors d’une allocution du jeudi, qui annoncent le soutient de l’état pour la création de projets autour de l’enseignement dans le milieu de la bande dessinée, par la mise à disposition future de ressources financières. Pierre LUNGHERETTI réussit finalement à résumer en une phrase ce qui aura été le leitmotiv de ces deux jours :
La bande dessinée est aujourd’hui reconnue comme un art et un vecteur efficace de transmission des savoirs. Preuve en est la présence des Ministres de la Culture et de L’Éducation Nationale, (Françoise NYSSEN et Jean-Michel BLANQUET) lors d’une allocution du jeudi, qui annoncent le soutient de l’état pour la création de projets autour de l’enseignement dans le milieu de la bande dessinée, par la mise à disposition future de ressources financières. Pierre LUNGHERETTI réussit finalement à résumer en une phrase ce qui aura été le leitmotiv de ces deux jours :
‘’ Tout en étant un art, la bande dessinée sait se prêter à des usages pédagogiques ‘’.
Mais maintenant apparaissent des enjeux pour l’avenir de l’industrie de la bande dessinée, comme le besoin d’un élargissement du lectorat et de la formation d’enseignants dans ce secteur en pleine évolution, ces enjeux soulevant une interrogation plus globale ;
Quel avenir de l’éducation artistique pour la bande dessinée ?
Compte rendu réalisé par Clayton Thibeaud, étudiant en Master 2 MMPJ