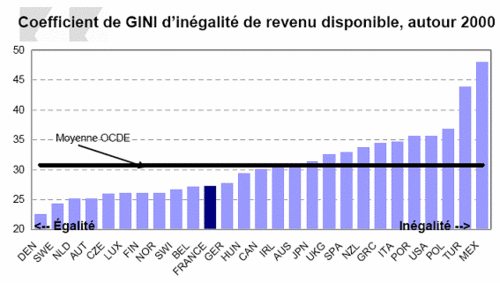
Premier graphique : les inégalités en termes de revenu disponible (ie après impôts et transferts) varient fortement d’un pays à l’autre. Les pays les plus égalitaires sont le Danemark, la Suède, les Pays-Bas ; les plus inégalitaires sont le Mexique, la Turquie, la Pologne et les Etats-Unis. La France est dans une situation intermédiaire, avec des inégalités plus faibles que dans la moyenne des pays de l’OCDE. On notera la proximité de la France, de l’Allemagne et de la Belgique.
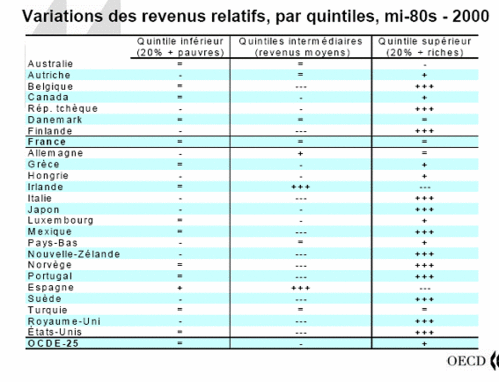
Deuxième graphique : l’évolution par quintile. L’idée est de décomposer la population en différentes classes : les "pauvres" (quintile inférieur), les "riches" (quintile supérieur), les classes moyennes (quintiles intermédiaires). On regarde ensuite la progression des revenus de chaque classe, on affecte des —, –, -, =, +, ++, +++ en fonction des évolutions. On retrouve le résultat rappelé plus haut : grande stabilité dans l’évolution des inégalités en France. Globalement, dans l’OCDE, on observe une stabilité dans la situation des pauvres, une détérioration de la situation des classes moyennes, une amélioration de la situation des plus riches. Je vous laisse observer les situations plus précises de chaque pays.
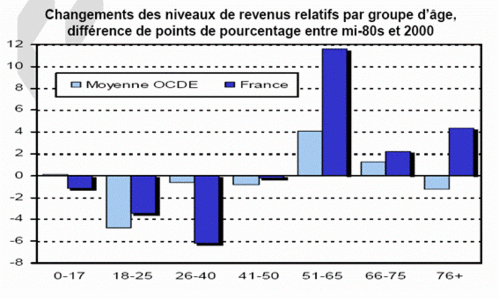
Troisième graphique : une nouvelle décomposition, non plus par classe de revenu, mais par âge. C’est sans doute le graphique le plus saisissant! La France se distingue par une évolution relative très défavorable des "jeunes" entre 26 et 40 ans (que personne ne me dise que les 26-40 ans ne sont plus jeunes 🙂 ) et particulièrement favorable des 51-65 ans et, dans une moinde mesure, des tranches d’âge encore supérieures. Bref, il fait bon être vieux dans notre doux pays!
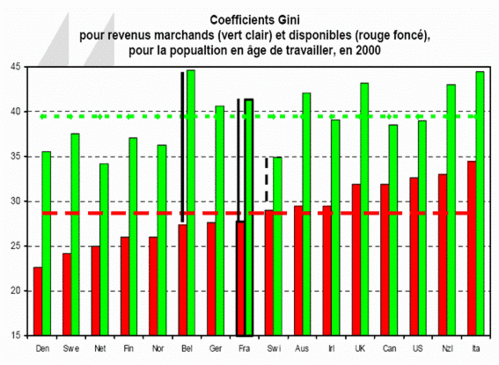
Quatrième graphique : la distinction revenu marchand (avant impôt/transfert) et revenu disponible (après impôt/transfert). Entre les deux, l’Etat (au sens large) est passé par là, pour faire de la redistribution. On observe, et c’est heureux!, que dans tous les cas, les inégalités après redistribution sont plus faibles qu’avant, signe que l’Etat "prend aux riches pour donner aux pauvres". Bon, mais plus ou moins cependant, selon les pays! Ca redistribue énormément au Danemark et en Suède, mais aussi en Belgique, et plutôt pas mal en France. Ce graphique est intéressant, car on constate qu’avant redistribution, les inégalités sont beaucoup plus faibles au Danemark (indice de 35 environ) qu’en Belgique par exemple (indice de 45). Les deux pays font un grand effort de redistribution, je dirais même un effort comparable, si bien que l’écart initial entre les deux pays demeure. On peut se dire que pour réduire encore les disparités, la Belgique a intérêt à agir en amont de la redistribution, au niveau de la distribution primaire des revenus. Idem pour la France, qui présente des inégalités avant redistribution somme toute assez fortes…
Complément au complément, maintenant, avec deux graphiques tirés d’une étude de Piketty. Celui-ci a collecté des stats sur la part dans les revenus (avant/après impôt) du décile / centile supérieur, et ce sur très longue période.
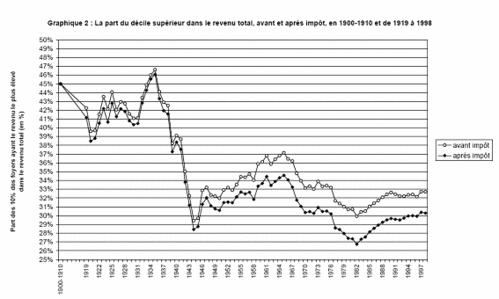
S’agissant du décile supérieur (les 10% des foyers les plus riches), on observe un accroissement de leur part dans le revenu total des années 40 au milieu des années 1960, une baisse ensuite jusqu’au début des années 1980, puis un accroissement depuis. Difficile de relier cela à la couleur politique des gouvernements, même si certains ne manqueront pas de souligner que le point de retournement (1982-1983) correspond à la mise en oeuvre de la politique de désinflation compétitive du gouvernement socialiste, politique toujours en vigueur depuis lors…
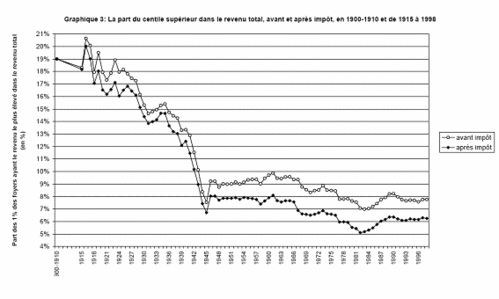
S’agissant du premier centile, c’est-à-dire vraiment les très très riches (les 1% les plus riches), on observe une stabilité/légère baisse de leur poids depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Leur poids a aussi augmenté, mais plus légèrement que pour le premier décile, de 1982 à 1990.
Pour en revenir au débat Krugman/Mankiw, ces deux derniers graphiques montrent la nécessité de distinguer, sans doute, entre l’analyse des 90/10 et celle des 99/1, comme le suggère aussi Josh Bivens.
Notons pour finir que les graphiques de Piketty ne permettent pas de saisir les effets générationnels, dont on a vu l’importance plus haut.


assez passionnant. Les deux derniers graphiques m’étonnent, je pensais bêtement que la baisse n’avait pas été aussi nette. Sinon bien contente d’apprendre que j’appartiens à la classe d’âge de plus en plus favorisée – le fait que mon dernier tiers provisionnel ait pris la forme d’un chèque important m’avait fait croire le contraire
Bonjour,une question : existe-t-il des stats sur le PIB/habitant dans chaque pays pour les 95% de revenus inférieurs (hors top 5% donc).ça peut être aussi un moyen de pondérer les comparaisons entre la richesse des nations apr un élément de répartition. Même si certains pourraient dire que l’inégalité de répartition permet d’accroître la voracité des "esprits animaux" et donc de dynamiser l’économie dans son ensemble etc…
Je suis dans la classe d’âge des niqués (26-40) et je veux bien parier que quand je serai dans la classe d’âge des favorisés, la tendance se sera renversée et que je continuerai à être dans les niqués. Putain de génération.
Flippant, tout ça…Un bon article suffisamment général et simple pour que tout le monde comprenne mais… enfin c’est pas rassurant quand même. :o)(En survolant l’actualité, bien entendu.)AJC
On m’a souvent posé la question : pourquoi l’economie des inégalités se focalise-t-elle à ce point sur les revenu du dernier décile ou du dernier centile ? Il s’agit en effet d’une population assez particulière, et on peut se demander dans quelle mesure ces revenus interviennent dans la formation de l’image des inégalités dans un pays donné. Ma meilleure réponse à l’heure actuelle est simplement que c’est pour cette population qu’on a les données les plus longues, l’impôt sur le revenu ayant commencé par ne concerner que les plus riches. Si vous avec d’autres explications, je suis preneur.
"une étude de Piketty", c’est limite mauvais camarade. LA thèse de Thomas Piketty, celle qui lui a vallu cette notoriété, de mon point de vue pas du tout pertinent, tout a fait justifiée. On pourrait ajouter, à l’usage de ceux qui sont trop radins pour acheter son ouvrage maintenant en poche, qu’il la condense sur une bonne centaine de pages dans un rapport du Conseil d’Analyse Economique, le n° 33 si ma mémoire est bonne. Quant à Vulgos, dont la position semble tout à fait réaliste, il pourra toujours ce consoler en pensant que, pour ceux qui lui succéderont, ce sera pire.
@Denys : stricto sensu, ce n’est pas la thèse de Piketty (je crois que sa thèse était sur un sujet de macro). C’est effectivement son étude sur les hauts revenus qui lui a valu une large partie de sa notoriété, mais il est intéressant de souligner les tournants de son itinéraire de matheux venu à l’économie empirique.
Je me pose la question suivante :Comment prendre en compte l\\\’effet "dette publique"? Le troisième graphique, en particulier, est assez frappant. Intuitivement, il le serait encore plus si on comparait l\\\’évolution des revenus ET de la quote-part de dette publique supportée par chaque tranche d\\\’âge.Imaginons deux entreprises dont les résultats croissent au même rythme. Mais, malgré leurs résultats comparables, la première a une dette stable tandis que l\\\’autre augmente sa dette plus vite que ses résultats. Certes, la comptabilité d\\\’une nation n\\\’est pas celle d\\\’une entreprise…Il est plus ou moins difficile à une entreprise de gonfler ses résultats en s\\\’endettant. Pour un pays, en revanche, il est très facile de s\\\’endetter en distribuant du revenu (direct ou indirect) aux citoyens. Il me semble que l\\\’on gagnerait encore en clarté si cet effet était pris en compte.Merci
"Bref, il fait bon être vieux dans notre doux pays!"Ce sont chiffres en relatif, quid de la situation initiale ?Heureusement que tu n’es pas étudiant :).
@ laurent Guerby : oui, le graphique montre l’évolution différentielle par tranche d’âge. On en déduit que les revenus des plus âgés ont augmenté plus vite que ceux des plus jeunes. Mais bon, c’est clair que leurs revenus étaient déjà supérieurs. d’où accroissement des inégalités inter-générationnelles. Mais bon, allez pas tuer les petits vieux quand même! @Denys et leconomiste : bon, Piketty doit pas attendre que je fasse sa pub, non? Pis y paraît qu’il veut faire une sorte de tour de babel sur Paris en enfermant dedans tous les économistes (les purs, les durs et les tatoués, hein!) pour que ca produise plus, alors comme je trouve ca débile, je mesure la publicité que je pourrais lui faire… @Vulgos : même chose pour moi (bien que je frôle la sortie). Même pronostique sur la suite… @leconomiste sur la focalisation sur le top décile/centile : je dirais d’abord que cela résulte du fait que les gens (et les économistes) se préoccupent beaucoup de l’évolution des revenus relatifs, plus (?) que de l’évolution des revenus absolus. D’où l’envie de savoir comment le revenu des autres augmente, notamment les extrèmes (plus pauvres/plus vieux). Car je ne suis pas sûr que l’éco des inégalités se focalise plus sur les plus riches que sur les plus pauvres, elle se focalise sur les extrêmes, non? Dans un pays comme la France où on est peut-être plus sensible qu’ailleurs à la notion d’égalité, logique qu’on regarde d’encore plus près où se situe les plus riches. Bon, ce sont des hypothèses…
Je précise : situation initiale France vs moyenne OCDE puisqu’on compare France et moyenne OCDE :).A l’intérieur de la France et d’autres pays, la courbe des revenus moyens par age est croissante en effet jusqu’assez tard (autour de 65 ans)Beaucoup d’études oublient de corriger (ou concluent en erreur) cet effet lors des comparaisons dans le temps, si la population vieillit a courbe de revenu par age constant le revenu moyen global va augmenter alors que ceteris paribus les gens ne sont pas plus riches !
Et même si je ne retrouve pas de référence, les inégalités de revenu abordées dans les billets précédants sont aussi croissantes par tranche d’age, ce qui rends moins pertinent la comparaison de revenus moyens et de leur évolution.
OBO :J’ai encore pêché un article lié… je viens de me rappeler que j’avais déjà lu un machin au sujet de tout cela…http://www.inegalites.fr/spip.php?article522Pompompom…Gu Si Fang :Personne te répond… (On peut se tutoyer ? C’est plus convivial. :o))Personnellement je ne comprends pas vraiment ton raisonnement ou tes questions…Si tu veux dire par là qu’en redistribuant plus, on accroit la dette publique, tu n’as qu’à regarder du côté des Etats-Unis où les inégalités sont très très très fortes, et où la dette s’accroît chaque année de manière dangereuse. Alors qu’en France, on peut dire qu’elle reste soutenable.Grosso-merdo… et si je dis des conneries, qu’on me rectifie… (Y’a plein de vrais spécialistes dans le coin. Moi je suis qu’étudiant.)Le gros problème des pays où les inégalités sont fortes, c’est le fait que les couches les plus "consommatrices" de la population sont obligées de s’endetter afin de consommer de plus en plus.Le meilleur exemple sont les Etats-Unis, où même les ménages se sur-endettent pour que l’économie marche.Alors qu’à la base, dans une majorité de nations développées (Voire dans toutes.), ce sont les entreprises, ainsi que l’Etat qui s’endettent, et cet endettement est financée en partie par les ménages et par les sociétés financières.C’est le cas en France, par exemple.La dette y reste franchement soutenable, et je pense qu’il faut arrêter de se focaliser autant dessus comme le font les médias ou notre Ministre de l’Economie. (Qui juste avant, a sacrément planté France Telecom.)On reste aussi sur le principe que les couches basses et moyennes de la population sont celles ayant la plus forte propension à consommer si on les compare aux couches riches… et que donc, c’est malin de leur refiler du pognon par la redistribution histoire de soutenir l’économie nationale.A moins que d’avoir pigé complètement de travers ton commentaire, il me semble que comparer la redistribution et la dette, ça me semble moyennement utile.Etant donné que la gestion de la dette diffère assez selon les pays, même si on tente de plus en plus à se calibrer…Me semble aussi que la droite désirant de moins en moins redistribuer, par la baisse de l’impôt sur le revenu par exemple, en arrive finalement à accroître le déficit.Quant à "l\\\’évolution des revenus ET de la quote-part de dette publique supportée par chaque tranche d\\\’âge."Heu ?Tu veux dire quoi, par là ?J’pige pas. Je dois vraiment être un boulet mais… j’pige vraiment pas.AJC
Pompompom… (Je passe distraitement.)Ça aussi c’est pas mal…http://www.inegalites.fr/article.php3?id_article=1Une synthèse de l’Observatoire des Inégalités (PUB : C’est comme le Plan B, Rezo ou Acrimed, c’est vachement cool !) sur les revenus en France.AJC
Heuuu… c’est le dernier commentaire à ce sujet, parce que le Flood, c’est Mal.Mais sur la pauvreté selon l’âge :http://www.inegalites.fr/spip.php?article373Je me dis que ça peut intéresser éventuellement les lecteurs de ce blog ou son rédacteur. :o)AJC
@AJC : merci pour ces liens, très intéressants. L’observatoire des inégalités regorge de ressources très utiles!@ Laurent Guerby: ok pour la question et la remarque. Trois hypothèses :1. la France partait d’une situation initiale comparable à celle des autres pays OCDE, l’évolution conduit à l’apparition d’inégalités intergénérationnelles plus fortes qu’ailleurs2. Les inégalités favorisaient déjà les "vieux", la situation s’aggrave3. les inégalités favorisaient les jeunes, il y a eu un effet rattrapage.Seule l’hypothèse H3 conduirait à nuancer le propos, je crois que c’est la moins crédible. A charge de trouver les données pour valider l’une des trois hypothèses, j’hésite entre H1 et H2, peut-être H1, puisque on était en 1980, les baby-boomers étaient en emploi.
A vrai dire, je ne m’étais jamais posé la question de savoir si l’ouvrage de Thomas Piketty sur les hauts revenus était bien tiré de sa thèse, tant il m’était apparu évident que, pour se taper le dépouillement d’un siècle de statistiques fiscales, il fallait être soit fou, soit doctorant. Sinon, attention au moment de se situer dans les groupes d’âges du graphique OCDE : les données, ou plutôt l’enquête revenu des ménages de l’INSEE, date de 2000. En raisonnant en cohortes, et en supposant que les données sont de cette même année 2000, les 26-40 sont nés entre 1960 et 1975, les 41-50 entre 1950 et 1959, et les 51-65 entre 1935 et 1949. Les classes ne sont pas homogènes, les intervalles sont trop larges, et l’effet du baby-boom qui commence en 1944 est en partie noyé dans la masse. Bref, y’a intérêt à affiner, même si ce que l’on voit là est cohérent avec ce que trouve le sociologue spécialiste des cohortes, Louis Chauvel : http://louis.chauvel.free.fr/index.htm
le troisième graphique est à mon sens le plus interessant et tellement d’actualité en cette période de réduction de fonctionnaire à des fins électorales.
Eh oui, ça sert à quelque chose la redistribution, encore faut-il collecter sur les bons….
Article très intéressant.
un webmaster sans-papires crée un site un peu bizarre un dictionnaire des sites français avec lequel il veut atteindre 1 million d’euro et devenir millionnaire voici son site :http://www.jeseraimillionnaire.com
un webmaster sans-papires crée un site un peu bizarre un dictionnaire des sites français avec lequel il veut atteindre 1 million d’euro et devenir millionnaire voici son site :http://www.jeseraimillionnaire.com