 Le 11 novembre 2018 a été l’occasion de clôturer un long cycle de commémorations de la Première Guerre mondiale, portée en grande partie par la Mission du Centenaire.
Le 11 novembre 2018 a été l’occasion de clôturer un long cycle de commémorations de la Première Guerre mondiale, portée en grande partie par la Mission du Centenaire.
Riche en émotions et en messages politiques liés davantage à l’actualité qu’au savoir historique, cette cérémonie est d’abord l’occasion de rappeler les différences entre histoire et mémoire. La retransmission télévisée de cet événement pouvait laisser l’impression au mieux d’un grand patchwork où co-existaient images d’archives (dont il faut rappeler que celles montrant des combats sont pour presque toutes des reconstitutions), discours et mises en scènes officiels, interviews d’historien.nes, reportages sur la perception de l’événement par des individus de la rue et commentaires journalistiques ; par moment, ces ingrédients ont pu se télescoper et même s’opposer, comme en témoigne par exemple cette émission de France Inter où la construction mémorielle est entrée en conflit avec la vérité historique.
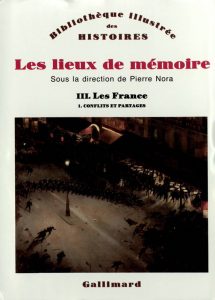 Pourtant, cette question de la place de la mémoire n’est pas nouvelle pour les historiens, à partir des années 1990 : on la trouve bien entendu dans la célèbre série des Lieux de Mémoire, dirigée par Pierre Nora (collection largement présente dans vos BU) et également dans des ouvrages généraux comme le classique L’histoire aujourd’hui, régulièrement republié depuis 1999 ou le plus récent Comment se fait l’histoire. Des ouvrages spécifiques continuent à être publiés sur le sujet, tels que Questions d’histoire contemporaine (2006), largement consacré au sujet ou bien Histoire et mémoires, conflits et alliance de P. Joutard en 2013 dont le titre résume bien la complexité des rapports entre un savoir scientifique d’une part et une (re)construction individuelle et/ou collective, largement affective et toujours liée aux problèmes qui traversent la société qui la produit d’autre part. Il n’est donc pas étonnant que « Mémoire » constitue une entrée à part entière dans Les mots de l’historien (sous la direction de Nicolas Offenstadt, 2004).
Pourtant, cette question de la place de la mémoire n’est pas nouvelle pour les historiens, à partir des années 1990 : on la trouve bien entendu dans la célèbre série des Lieux de Mémoire, dirigée par Pierre Nora (collection largement présente dans vos BU) et également dans des ouvrages généraux comme le classique L’histoire aujourd’hui, régulièrement republié depuis 1999 ou le plus récent Comment se fait l’histoire. Des ouvrages spécifiques continuent à être publiés sur le sujet, tels que Questions d’histoire contemporaine (2006), largement consacré au sujet ou bien Histoire et mémoires, conflits et alliance de P. Joutard en 2013 dont le titre résume bien la complexité des rapports entre un savoir scientifique d’une part et une (re)construction individuelle et/ou collective, largement affective et toujours liée aux problèmes qui traversent la société qui la produit d’autre part. Il n’est donc pas étonnant que « Mémoire » constitue une entrée à part entière dans Les mots de l’historien (sous la direction de Nicolas Offenstadt, 2004).
Il est d’ailleurs surprenant de constater que c’est précisément dans la décennie 1990 que le premier conflit mondial a fait irruption dans le champ de la mémoire collective. C’est d’ailleurs en 1992 qu’est inauguré l’Historial de la Grande Guerre à Peronne, à la muséographie si novatrice (la mise en parallèle systématique des objets des deux camps ennemis par exemple ou bien l’exposition des uniformes à plat, dans des fosses au sol, sans mannequin). Cela pourrait donner la fausse impression que 1914-1918 n’intéressait pas les historiens avant les années 1990. Comme le montre bien la synthèse d’Antoine Prost 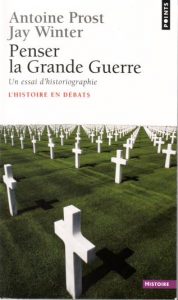 et de Jay Winter « Penser la grande guerre : un essai d’historiographie » (2004), le conflit n’a jamais cessé de susciter des travaux. Mais au cours du temps, l’angle a évolué : de purement militaire et diplomatique, les historiens ont investi les aspects économiques de la guerre, puis sociaux et enfin culturels. Il est ainsi possible de citer dans les débats celui du consentement des soldats à la guerre (porté par Stéphane Audouin-Rouzeau) ou celui d’un conflit qui aurait durablement « brutalisé » l’Europe, facilitant la mise en place des régimes totalitaires selon George Mosse. Aujourd’hui encore, la recherche est toujours féconde, réussissant à trouver de nouveaux champs d’étude comme le montre par exemple « Couples dans la grande guerre : le tragique et l’ordinaire du lien conjugal » de Clémentine Vidal-Naquet (2014). En 2018, la
et de Jay Winter « Penser la grande guerre : un essai d’historiographie » (2004), le conflit n’a jamais cessé de susciter des travaux. Mais au cours du temps, l’angle a évolué : de purement militaire et diplomatique, les historiens ont investi les aspects économiques de la guerre, puis sociaux et enfin culturels. Il est ainsi possible de citer dans les débats celui du consentement des soldats à la guerre (porté par Stéphane Audouin-Rouzeau) ou celui d’un conflit qui aurait durablement « brutalisé » l’Europe, facilitant la mise en place des régimes totalitaires selon George Mosse. Aujourd’hui encore, la recherche est toujours féconde, réussissant à trouver de nouveaux champs d’étude comme le montre par exemple « Couples dans la grande guerre : le tragique et l’ordinaire du lien conjugal » de Clémentine Vidal-Naquet (2014). En 2018, la 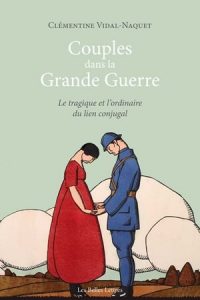 recherche avance : l’expression « après-guerre » est par exemple remplacée par celle de « sortie de guerre » car nous avions sans doute oublié que l’armistice du 11 novembre ne réglait pas grand chose, mis à part bien entendu le soulagement des soldats du front Ouest, et que de multiples conflits ont agité l’Europe et le monde jusqu’en 1923. C’était d’ailleurs le sujet d’un des derniers numéros de la revue L’Histoire (n°449-450 de juillet-août 2018), d’une formidable série d’émissions de France Inter « 1918 : un monde en révolutions« , toujours disponibles en podcasts et d’une exposition au Musée de l’Armée à Paris (« A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923« ).
recherche avance : l’expression « après-guerre » est par exemple remplacée par celle de « sortie de guerre » car nous avions sans doute oublié que l’armistice du 11 novembre ne réglait pas grand chose, mis à part bien entendu le soulagement des soldats du front Ouest, et que de multiples conflits ont agité l’Europe et le monde jusqu’en 1923. C’était d’ailleurs le sujet d’un des derniers numéros de la revue L’Histoire (n°449-450 de juillet-août 2018), d’une formidable série d’émissions de France Inter « 1918 : un monde en révolutions« , toujours disponibles en podcasts et d’une exposition au Musée de l’Armée à Paris (« A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923« ).
Pour terminer sur les rapports entre histoire et mémoire, il est bien évident que cette dernière est aujourd’hui portée par des médias culturels qui ne sont pas des travaux historiques. Le succès récent de l’adaptation en bande-dessinée et au cinéma de « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître en témoigne. La liste des bande dessinées récentes parues sur 1914-1918, compilée par la Cité de la BD d’Angoulême, est assez impressionnante. Vous en trouverez quelques titres à La Ruche (campus, bâtiment A2)  dans lesquels il faut citer par exemple celles de Tardi, qui prend le contre-pied de Stéphane Audouin-Rouzeau en cherchant à montrer à quel point la guerre n’a été qu’une contrainte violente sur une société entière, sans autre but que de perpétrer la domination des puissants. Cette image d’une guerre d’autant plus absurde qu’elle atteint des niveaux de violence inouïs et inédits domine dans la production culturelle grand public,depuis longtemps, y compris au cinéma (dont « Les sentiers de la gloire » de Kubrick sont l’exemple le plus connu au cinéma, alors que le film est en grande partie erroné historiquement). En vous replongeant dans les travaux des historiens, vous aurez sans doute une vision plus nuancée de la réalité.
dans lesquels il faut citer par exemple celles de Tardi, qui prend le contre-pied de Stéphane Audouin-Rouzeau en cherchant à montrer à quel point la guerre n’a été qu’une contrainte violente sur une société entière, sans autre but que de perpétrer la domination des puissants. Cette image d’une guerre d’autant plus absurde qu’elle atteint des niveaux de violence inouïs et inédits domine dans la production culturelle grand public,depuis longtemps, y compris au cinéma (dont « Les sentiers de la gloire » de Kubrick sont l’exemple le plus connu au cinéma, alors que le film est en grande partie erroné historiquement). En vous replongeant dans les travaux des historiens, vous aurez sans doute une vision plus nuancée de la réalité.
Et qui sait, en participant à la Grande Collecte ou bien en effectuant une recherche sur votre nom de famille dans la base Mémoire des hommes qui recense tous les soldats tués durant le conflit, vous pourrez également relier votre propre histoire à la grande…

