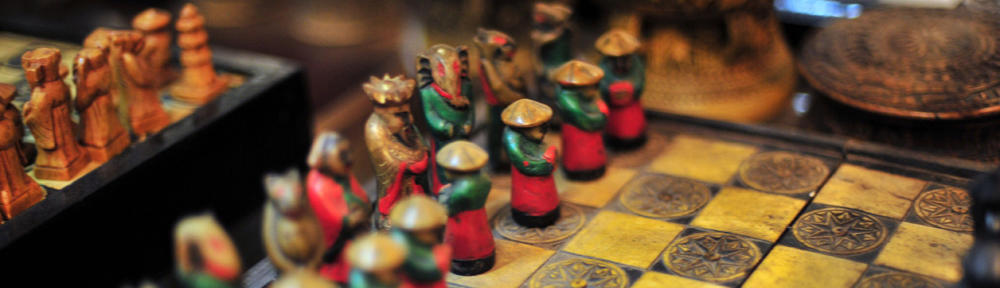On aura beaucoup parlé en France, au-delà du raisonnable, des élections américaines, mais la réciproque n’est pas vraie : il a été très peu question de l’Europe lors de ces élections ; le vieux continent en aura été un grand absent. Rien de surprenant à cela ; il ne s’agit que d’une pratique habituelle qui fait que la politique étrangère ne fait pas plus le résultat électoral aux Etats-Unis que dans n’importe quel autre pays dans le monde. Alors l’Europe, quand il y a la Chine, la Russie, la Syrie et l’Afghanistan, d’autres encore pour occuper le peu de place laissée au débat international ! Mais précisément cette faiblesse permet de mesurer la vision américaine de l’Europe et les causes de son oubli.
Cette omission tient d’abord à ce que l’Europe n’est pas un problème pour les Etats-Unis, au double sens du terme : trop peu importante pour être sujet de préoccupation ; suffisamment en phase avec eux, malgré quelques divergences secondaires, pour ne pas être un facteur de souci. Europe et Amérique se sont ainsi progressivement éloignées l’une de l’autre et les Etats-Unis se sentent davantage concernés par ce qu’ils analysent comme leur avenir dans le Pacifique que par leur passé certain dans l’Atlantique.
Le phénomène peut paraître vexatoire en Europe ; celle-ci se vit dès lors comme une maîtresse trop vieillie qui ne dispose plus des attraits d’autrefois, mais la situation peut présenter les avantages de la liberté. Par ce fait même, le regard et l’attention américains peuvent se faire plus lointains et laisser davantage de place à la défense des intérêts européens. Il ne faut cependant pas se faire trop d’illusions. Eloignement ne signifie pas désintérêt et si la laisse a gagné en élasticité, elle n’a pas disparu pour autant. Comme ils l’ont toujours fait depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis sauront reprendre la main lorsque leurs intérêts seront en jeu. L’indépendance juridique n’est pas nécessairement l’indépendance réelle et elle ne s’exerce qu’à la condition de ne pas entraver les intérêts américains. L’Europe ne disposera d’une véritable indépendance que si elle mène une politique volontariste et sait se constituer des points de force et les utiliser.
L’éloignement entre les deux continents se traduit également par le rôle de repoussoir qui a été attribué à l’Europe au cours de ces élections, surtout du côté républicain. Lorsqu’il s’est agi de dire tout le mal que l’on pouvait penser de la politique de Barack Obama, notamment en matière de protection sociale, l’Europe a été convoquée sur la scène, pour dénoncer ses défauts réels ou fantasmés : sa désuétude, son socialisme, le rôle de l’Etat et les atteintes aux libertés qui en découlaient. Etait-il question de déclin ? C’est une supposée ‘‘grêcisation’’ qui était assignée au tribunal électoral. A en croire les tenants de cette dénonciation, suivre une telle voie constitue une trahison du meilleur de l’Amérique et ouvre la porte à la chute de l’empire américain.
L’éloignement est désormais une donnée de la politique américaine et il n’existe aucune chance pour que la nouvelle administration Obama la modifie sensiblement car elle correspond à la manière dont les Etats-Unis comprennent leur destin ; elle dépasse les clivages partisans et Mitt Romney aurait-il été élu qu’il n’y aurait pas eu de modification en ce domaine. Tout au plus, aurait-on pu assister à quelques infléchissements dans les modalités de mise en oeuvre.
Affaires publiques et autres faits de société…
François Hervouët