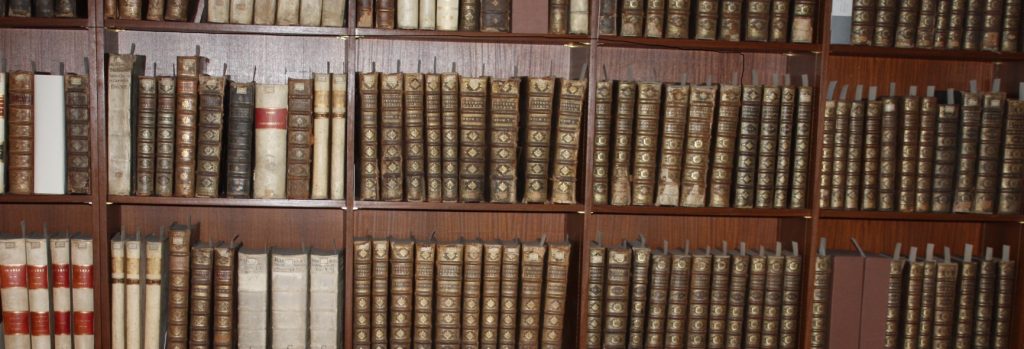 Tout au long de l’époque moderne, les ouvrages d’arithmétique traditionnelle furent publiés en nombre ; d’une grande variété, ils pouvaient être de simples exposés pratiques de base comme des manuels didactiques pour tous les niveaux. Les importantes découvertes faites dans le domaine de l’algèbre furent également diffusées par l’écrit. Les collections du Fonds ancien de l’Université de Poitiers contiennent plusieurs dizaines de livres anciens d’algèbre et d’arithmétique des 16e, 17e et 18e siècles et du début du 19e siècle. Le lundi 13 mars à 11h, à la BU du Futuroscope, une Heure du Livre ancien leur sera consacrée.
Tout au long de l’époque moderne, les ouvrages d’arithmétique traditionnelle furent publiés en nombre ; d’une grande variété, ils pouvaient être de simples exposés pratiques de base comme des manuels didactiques pour tous les niveaux. Les importantes découvertes faites dans le domaine de l’algèbre furent également diffusées par l’écrit. Les collections du Fonds ancien de l’Université de Poitiers contiennent plusieurs dizaines de livres anciens d’algèbre et d’arithmétique des 16e, 17e et 18e siècles et du début du 19e siècle. Le lundi 13 mars à 11h, à la BU du Futuroscope, une Heure du Livre ancien leur sera consacrée.
Partons à la découverte de ces collections…
Quels en sont les auteurs ?
Les auteurs des œuvres mathématiques conservées au Fonds ancien ont eu des parcours variés, représentatifs de ceux de leurs contemporains scientifiques :
- le vendéen François Viète (1540-1603),
- Joseph Lange (1570-1630), qui fut aussi philologue et pédagogue ; il fut professeur de grec, de logique et de rhétorique,
- Pierre de Fermat (1601-1665), qui fut conseiller au Parlement de Toulouse,
- le jésuite André Tacquet (1602-1660), professeur d’humanités, puis de mathématiques, à Louvain et à Anvers,
- l’Anglais John Wallis (1616-1703),
- François Barrême (1638-1703?), qui était aussi un financier,
- l’oratorien Bernard Lamy (1640-1715), qui fut également physicien et philosophe,
- l’oratorien Charles-René Reyneau (1656-1728), professeur de philosophie et de mathématiques,
- le petit-fils (ou fils) de François Barrême, Nicolas Barrême (1687-174.?), financier et économiste,
- le Suisse Leonhard Euler (1707-1783), également physicien, qui vécut avant tout en Russie et à Berlin,
- François Jacquier (1711-1788), qui fut aussi physicien,
- le polygraphe jésuite Jean-Joseph Rossignol (1726-1815), qui fut prêtre réfractaire,
- Étienne Bezout (1730-1783), qui fut membre de l’Académie des sciences de Paris,
- Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), d’origine italienne, qui fut membre des Académies des sciences de Paris, Berlin, Turin, et enseigna à l’École normale et à l’École polytechnique,
- Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), également chimiste, physicien et économiste, qui fut guillotiné sous la Révolution,
- Edme Marie Joseph Lemoine d’Essoies (1751-1816), qui était également géographe,
- Olry Terquem (1782-1862), qui fut élève, puis répétiteur à l’École polytechnique ; il enseigna à Mayence, fut bibliothécaire à l’École d’artillerie Saint-Thomas d’Aquin et fonda plusieurs revues de mathématiques.
Ces textes ont donc été écrits par des auteurs très divers. Certains étaient des ecclésiastiques, tandis que d’autres étaient des financiers. Quelques uns étaient également géographes, chimistes, économistes, philosophes ou physiciens. La majorité était française, mais l’un était suisse, l’autre anglais et un autre encore était d’origine italienne. Certains ont fait des découvertes, tandis que d’autres ont avant tout cherché à diffuser largement les savoirs et nouvelles connaissances. Beaucoup étaient membres d’une (ou de plusieurs) Académie(s) des sciences, en France ou à l’étranger.
Quelles en sont les provenances ?
Quelques ouvrages sont pratiques, d’autres sont théoriques. Certains sont des rééditions très postérieures à l’œuvre originale. Quelques mathématiciens eurent un tel rayonnement que leurs œuvres furent publiées dans plusieurs pays, loin de chez eux. Ainsi, des ouvrages ont été imprimés en Italie (Venise, Turin, Rome), en France (Toulouse, Paris, Lyon), aux Pays-Bas (Leyde), en Angleterre (Oxford) ou dans l’Allemagne actuelle (Fribourg-en-Brisgau).
En regardant leurs premières pages, nous pouvons retracer le parcours des livres. Par exemple, un ouvrage de François Jacquier a été détenu par le Petit Séminaire Saint-Charles de Poitiers, puis par le Grand Séminaire de cette même ville. Un certain nombre de ces ouvrages ont en effet fait partie de collections ecclésiastiques.
