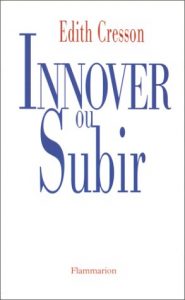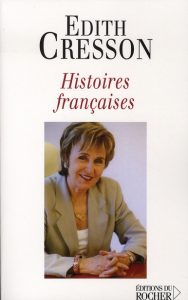Les politiques intéressés par l’intelligence économiques sont rares et encore plus rares lorsque paraît le rapport Martre en février 1994. Pourtant, une femme politique de premier rang va jouer un rôle clé dans son émergence : Édith Cresson. C’est elle qui contactera Christian Harbulot suite à la parution de son étude « Techniques offensives et guerre économique » (1989), une étude qu’elle a lu dans le détail (fait assez rare pour le souligner) et qui aboutira à la transformation de l’ADITECH en ADIT avec le succès que l’on sait. Jean-Louis Levet, acteur important de l’intelligence économique en France sera son chargé de mission aux questions industrielles à Matignon avant de rejoindre le Commissariat Général du Plan, institution qui lancera le groupe de travail du rapport Martre.
Élue de la Vienne (tout comme Jean-Pierre Raffarin qui commanditera dix ans plus tard un rapport sur l’IE au Député Bernard Carayon), j’ai eu la chance de la rencontrer à Poitiers à plusieurs reprises et de m’entretenir avec elle de ces questions.Voici le compte-rendu d’un de nos échanges qui permet de mieux cerner son implication et sa philosophie d’action.
Je rencontre Édith Cresson à Poitiers dans un restaurant québécois. Après que je lui ai offert un ouvrage sur l’intelligence économique, elle me demande si je connais l’histoire suivante. Et en guise d’apéritif, j’ai alors droit à un véritable cas d’école de guerre économique qui, loin de me couper l’appétit, va plutôt le renforcer dès lors qu’il est présenté par un décideur de tout premier plan. « Étant à la Commission européenne, confie-t-elle, je vois passer une affaire selon laquelle Michelin aurait porté atteinte à la concurrence en ne respectant pas une réglementation en vigueur. Soit. Mais, parallèlement, il se trouve que tout à fait par hasard (le monde est petit), je connaissais quelqu’un dont le petit cabinet en communication venait d’être racheté par des Américains. Or, un jour, cette personne reçoit une demande des nouveaux propriétaires de l’entreprise pour mettre en œuvre une opération de déstabilisation médiatique à l’encontre d’un groupe européen de pneumatique. Comprenant qu’il s’agit de Michelin, elle m’en informe. Et, dans le même temps, François Michelin me fait part d’une opération d’espionnage industriel qui vient d’avoir lieu dans un de ses ateliers. Ces trois attaques arrivées presque simultanément sont-elles des coïncidences ? Je ne le pense pas. Cela signifie que ces opérations sont le fruit d’une organisation à grande échelle qui vise à encercler une entreprise. Au-delà des discours lénifiants, nous sommes donc bien face à une guerre économique permanente dans laquelle nos principaux alliés sont très actifs… »
Et leurs actions sont d’autant plus efficaces que nous-mêmes sommes mal organisés, que nous n’entrons pas ensemble en stratégie pour reprendre la simple et belle définition de l’intelligence économique donnée un jour par Jacqueline Sala, la rédactrice en chef du magazine Veille. Édith Cresson acquiesce en souriant et, tandis que nous entamons notre repas, me raconte une petite histoire locale tout à fait symbolique (pour ne pas dire symptomatique) de ce différentiel d’intelligence. « Je suis récemment alerté par le premier vice-président de la Région sur une entreprise innovante de Bressuire qui a mis au point des pots de fleurs biodégradables. L’intérêt de ces pots est qu’ils se dégradent à des vitesses différentes une fois dans la terre. Or, j’avais été tout étonnée d’apprendre qu’une entreprise américaine venait de passer deux jours à Bressuire pour tenter d’acheter le brevet, d’abord soi-disant uniquement pour les États-Unis. Puis une entreprise hollandaise a fait la même chose. J’ai donc rencontré cet industriel et suis allée avec lui pour trouver des investisseurs publics français afin qu’il ait les moyens de développer sa technologie avant qu’une entreprise étrangère ne la récupère. C’est une innovation comme il y en a beaucoup en France, mais qui trop souvent passent à la trappe faute d’interlocuteurs. Et dans le cas que je viens de vous raconter, il est intéressant de noter que pour se retrouver à Bressuire, l’entreprise américaine dispose de réseaux étendus que n’ont même pas ceux qui sont censés développer leur propre territoire. »
Depuis un moment, une question me taraude. Alors je lui pose : « Mais pour quelle raison vous êtes-vous intéressé à l’intelligence économique quand la plupart des politiques – et en particulier socialistes – s’en désintéressaient autant ? »
Très ouverte et toujours souriante, Édith Cresson m’explique qu’elle va être très tôt sensibilisée à la question de l’information économique et bientôt à la culture du renseignement. Sortie d’HEC Jeunes Filles, et après quelques expériences qu’elle qualifie elle-même de peu gratifiantes, elle intègre l’unité de documentation et de synthèse de la Compagnie Française des Pétroles (l’ancien nom de Total, dont l’acronyme CFP fut un temps raillé par ses concurrents qui l’appelaient « Can’t Find Petroleum »). Elle est alors recrutée pour décrypter tout ce qui se publie dans les revues spécialisées sur le problème du pétrole, une ouverture sur le monde, mais surtout une initiation à ce qu’on appellera plus tard la veille et l’intelligence économique. Après un premier engagement politique, Édith Cresson prend un travail d’économiste dans un cabinet de consultants. Cette activité, me confie-t-elle, lui convenait parfaitement, car il fallait tenter de comprendre une situation, interroger les divers acteurs concernés pour avoir leur point de vue, établir des comparaisons avec des situations similaires et tirer des conclusions et suggestions : « Cela m’a appris à mieux connaître la réalité économique et sociale et les sujets que je traitais étaient variés, allant de la façon de réorganiser la formation des professionnels des métiers d’art (des tapissiers des Gobelins ou restaurateurs de peintures des musées) jusqu’aux méthodes à appliquer pour intéresser les industriels du Québec à l’économie française. »
Au début des années soixante, Édith Cresson soutient une thèse de doctorat de troisième cycle en démographie sur la condition féminine dans une commune rurale. Une formation par la recherche assez rare chez nos politiques plutôt formés aux certitudes qu’aux doutes. Là encore, ce travail lui permit, magnétophone en main, de rencontrer de nombreuses femmes d’agriculteurs et de saisir sur le terrain les problèmes de l’économie agricole. Avant 1981, en tant que responsable de l’agriculture et de l’environnement, elle continue de se renseigner à partir de travaux sérieux et d’échanges avec des spécialistes extérieurs. Loin de tout dogmatisme, elle n’hésite pas à rencontrer des économistes de toutes tendances.
Malheureusement, cette démarche d’intelligence économique sera de peu d’effet une fois ministre de l’Agriculture. Malgré quelques réussites, ce premier portefeuille sera surtout marqué par des logiques d’affrontements dans un monde où la nomination d’une femme aura été ressentie comme une provocation (c’était il y a vingt-cinq ans, une autre époque !). Non. C’est au Commerce extérieur qu’Édith Cresson va pouvoir démontrer toute sa valeur. Devant un déficit commercial gigantesque, elle se dit que s’occuper uniquement des grands contrats n’est pas suffisant. Elle demande donc aux directions régionales du commerce extérieur et de l’industrie d’identifier dans toute la France les PME (grandes oubliées du système français malgré les discours politiques qui se suivent et se ressemblent !) susceptibles d’exporter. Certaines d’entre elles pourront alors bénéficier des voyages ministériels. Et les résultats suivent logiquement.
Une anecdote lui revient. Courant les foires-expositions, un ministre russe de l’agriculture lui explique que ce ne sont pas de faibles récoltes qui causent les fréquentes pénuries de blé enrichi, mais le stockage et le transport. Or sur tous ces problèmes, des entreprises françaises ont du savoir-faire et il apparaît tout de suite à la ministre qu’il faut mettre en valeur les solutions qu’elle propose, par exemple des systèmes de ventilation pour les silos à blé. Toujours comme ministre du Commerce extérieur, Édith Cresson lance une innovation qui lui tient à cœur consistant à répertorier les anciens élèves étrangers passés par les grandes écoles et les universités françaises afin de conserver avec eux un lien, de les tenir au courant des évolutions du système d’enseignement supérieur, des orientations et des succès de nos industries. Mais aussi de leur permettre d’expliquer ce qu’ils étaient devenus sur le plan professionnel. Après un premier essai réussi au Mexique, le système fut généralisé et, comme toute bonne idée, abandonnée par le successeur. Aujourd’hui, me dit-elle, il faudrait reprendre cette idée en la confiant à un organisme extérieur muni d’une logistique suffisante avec l’appui des grandes écoles et des universités. Car les ministres passent et ce type d’innovation qui n’intéresse pas l’administration est perdu. Que n’a-t-elle raison et en me disant cela, je me souviens de ce recteur expliquant à une assemblée médusée que la sphère économique n’était pas de sa compétence…
Dans les années quatre-vingt-dix, décennie qui verra apparaître l’intelligence économique, la forte et rapide pénétration de voitures japonaises, moins chères et performantes, menace l’industrie française. Il faut donc gagner du temps afin de rattraper le retard. Après que Roger Fauroux, ministre de l’Industrie de Michel Rocard, ait publiquement dit que les voitures japonaises étaient les meilleures du monde et qu’il était donc normal qu’elles se vendent mieux, les constructeurs français demandent au Premier ministre de confier ce dossier à Édith Cresson. Devenue ministre des Affaires européennes, elle va négocier avec les ministres européens et la commission la limitation des entrées de voitures japonaises en Europe. Des négociations difficiles…
À la même époque, toujours dans un esprit d’intelligence économique, Édith Cresson met en place des groupes de travail baptisés Groupes d’Études et de Mobilisation (GEM) qui rassemblent des professionnels de toute la France par secteur. Responsables d’entreprises, élus locaux, syndicalistes travaillent ensemble gratuitement et rédigent des rapports contenant des informations et des conseils qui vont permettre par la suite d’impulser des actions utiles. L’idée part du constat que l’administration française, pour être excellente, ne comprend néanmoins pas toujours la réalité des entreprises et le contexte dans lequel elles évoluent. Mais aux affaires européennes, Édith Cresson s’ennuie. Si bien qu’après avoir marqué son souhait pour la France d’un grand ministère de l’économie regroupant le commerce extérieur et l’industrie (un équivalent du MITI japonais), elle annonce le 3 octobre 1990 : « je démissionne du gouvernement parce que la puissance politique de la France risque de s’affaiblir faute d’une mobilisation industrielle. »
Appelée à Matignon par François Mitterrand, l’épreuve sera rude. Outre les manœuvres de certains éléphants socialistes, Édith Cresson comprend vite qu’elle part avec un lourd handicap : ne pas connaître les réseaux très anciens que certains ont bâtis avec la presse. Néanmoins, elle continue à innover et apprend beaucoup de choses. En se fondant sur ses GEM, elle découvre, par exemple, qu’il est moins onéreux pour un viticulteur du bordelais d’expédier le vin par Amsterdam que par Bordeaux, que la France forme chaque année moitié moins d’ingénieurs que les Allemands, ou que les délais de paiement pour les petites entreprises étaient en France beaucoup plus longs qu’ailleurs… Mais à l’époque, elle s’entend répondre qu’il s’agit là de détails. Ah ce culte sacro-saint voué à la macro-économie. Or, pour Édith Cresson, il n’y a alors pas d’autre chance de s’en sortir qu’en accroissant la compétitivité des entreprises par la formation, la recherche, les mesures fiscales, et tous les moyens nécessaires à la guerre économique. Et que la première des injustices sociales, c’est le chômage. Un discours qui ne plaît évidemment pas aux socialistes, du moins à l’époque ! Puis, victime d’une véritable guerre de l’information, Édith Cresson devra bientôt quitter Matignon. Elle fera désormais sienne cette phrase de Laurent Joffrin : « la particularité de la démocratie est que le coup d’État est remplacé par le coup bas ».
Quelques années après son départ de l’enfer de Matignon, Édith Cresson devient commissaire européen en charge de l’éducation, de la jeunesse et de la recherche. Elle dispose alors du troisième budget de l’Union et dirige 4800 fonctionnaires. Nous sommes en 1994, année du rapport Martre fondateur de l’intelligence économique en France. Et parmi les nombreuses actions mises en œuvre, il y aura notamment le livre blanc « Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive. » où l’on peut lire cette conclusion : « Face à l’Amérique, face au Japon, demain face à la Chine, l’Europe doit avoir la masse économiquement, démographiquement et politiquement capable d’assurer son indépendance (…) La principale matière première de l’Europe est sans doute la matière grise. » Et le livre vert sur l’innovation introduit pour la première fois dans l’Union Européenne la notion d’intelligence économique. Une tentative vouée à l’échec dans une Europe néo-libérale où les Anglais s’évertuent à empêcher toute stratégie supranationale.
Au-delà du discours, c’est à cette période qu’Édith Cresson lance le réseau des écoles de la deuxième chance destinées à rattraper les jeunes sortis du système classique sans diplôme et sans possibilité de trouver un emploi, avec le rattrapage des savoirs de base et des stages en alternance dans les entreprises, un suivi très individualisé et l’usage des nouvelles technologies de l’information. Les « net-days » permettent, quant à eux, aux élèves d’écoles de pays différents d’échanger leurs expériences afin de rapprocher les cultures et de renforcer l’intégration européenne grâce aux nouvelles technologies. Pragmatique, la commissaire fait également en sorte que les PME soient mieux prises en compte dans les projets du programme-cadre de recherche et que les fonds structurels de la politique régionale commune soient plus orientés vers l’innovation.
Mais, en 1998, les circonstances ne tardent pas à changer brutalement. Un débat très houleux intervient sur la fusion Boeing – McDonnell-Douglas. Près de la moitié des commissaires s’élève alors contre la décision d’autorisation sans condition de ce mariage qui permet à Boeing de bénéficier de crédits militaires. Édith Cresson explique en garder une impression étrange. Et d’autant plus étrange que la commission, qui émet fréquemment le point de vue selon lequel il ne faut pas de « champions nationaux » ni même de « champions européens », interdit la fusion Schneider-Legrand. Une position qui sera cassée par la Cour européenne de justice plusieurs années après. Trop tard cependant !
Épilogue. Qui veut tuer son chien l’accuse de la rage. La droite allemande qui veut la tête de certains commissaires socialistes cherche des failles pour renverser la commission présidée par Jacques Santer. Pour Édith Cresson, elle en trouve une dans le recrutement d’un stomatologue de Châtellerault, ancien expert pour l’ANVAR (devenue OSÉO), mais présenté de manière simpliste comme son dentiste personnel. Une véritable guerre de l’information est engagée et le bureau d’Édith Cresson à Paris est même visité de nuit. Malgré un premier non-lieu prononcé par la justice belge, les poursuites continuent. La commission Santer démissionnera en bloc au printemps 1999. Concernant Édith Cresson, la Cour européenne de justice ne se prononcera que sept ans plus tard ! L’arrêté rendu stipule que si le recrutement de son collaborateur n’aurait pas dû avoir lieu sous le couvert du statut retenu, la réalité de ses prestations avait été démontrée et qu’il n’avait donc pas bénéficié d’un emploi de pure complaisance. Aucune sanction ne sera donc retenue contre l’ancien commissaire ! Mais dans la guerre de l’information, la prime revient (presque) toujours à l’attaquant. Vous-mêmes, lecteur, lisez-vous souvent les rectificatifs ? Sous forme d’encarts ou de petits textes, ils sont censés rétablir en quelques mots les « inexactitudes » souvent diffusées pendant des jours de manière parfois massive. Oui, censés…
Pour nous, l’essentiel est qu’Édith Cresson a joué un rôle majeur dans l’émergence de l’intelligence économique en France. Après sa vie politique, elle conseillera nombre de décideurs économiques et notamment l’ADIT. Et comme d’autres femmes qui se sont battues pour des idées, elle a su faire sienne les vers de René Char : “Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront.”